

Jessica Da Silva / Adaptation: Carole Pirker
Docteur en philosophie à l’Université de Lausanne, Maël Goarzin découvre le stoïcisme en lisant le Manuel d’Epictète, un philosophe grec né au 1er siècle de notre ère. En lisant que l’on peut vivre mieux si l’on apprend à distinguer ce qui dépend ou pas de nous, il découvre une philosophie antique qui permet d’atteindre la tranquillité intérieure face aux aléas de la vie.
Depuis, il réfléchit à la manière de rendre compatible christianisme et stoïcisme. En 2017, il cofonde à Lausanne l’association Stoa Gallica (voir encadré), qui promeut la pertinence d’un stoïcisme contemporain, avant de diriger en 2024 un livre collectif sur le sujet. Car le stoïcisme a le vent en poupe. Il inspire aujourd’hui jusqu’aux adeptes du développement personnel. Au risque, prévient-il, de réduire sa richesse à une série de trucs et astuces de simple bien-être…
Vous vous dites stoïcien et chrétien. Comment conciliez-vous philosophie stoïcienne et christianisme?
Maël Goarzin: Je dirais que je suis d’abord chrétien. Je m’inspire de la tradition stoïcienne pour ses exercices spirituels, comme distinguer ce qui dépend ou pas de nous. La maîtrise de soi et la méditation sur la mort sont aussi très inspirantes. Les stoïciens sont allés très loin dans la pratique de ces exercices. En tant que chrétien, il me semble que l’on peut utiliser cette tradition pour enrichir notre pratique, sans pour autant prendre pour soi certains principes stoïciens incompatibles avec le christianisme.
Avez-vous justement un exemple concret où le stoïcisme vous a aidé?
Je dirais que tous les moments difficiles de l’existence sont adoucis par le stoïcisme. Il m’a beaucoup aidé pour accompagner mon père, qui est actuellement en réanimation, et cela, tout en étant dans la gratitude, la reconnaissance et l’acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, mais de la volonté de Dieu.
«Je dirais que tous les moments difficiles de l’existence sont adoucis par le stoïcisme.»
Justement, quels sont les points communs et les différences entre stoïcisme et christianisme?
On a d’abord un même ascétisme moral, une même recherche de la vertu et une même attention à la vie de l’âme, par opposition à la vie du corps, aux biens extérieurs et à l’attrait des richesses. L’ascèse constitue donc un aspect important et commun entre ces deux traditions, notamment par la présence des quatre vertus cardinales : la justice, la sagesse, le courage et la tempérance. A cela s’ajoute l’intérêt commun pour les exercices spirituels, que l’ascétique chrétienne a repris du stoïcisme. On pense par exemple à l’examen de conscience, à la méditation sur la mort, ou au regard d’en haut.
De quoi s’agit-il?
C’est un exercice qui consiste à prendre de la hauteur, à la manière d’un cosmonaute qui regarde la terre d’en haut. Il s’agit de prendre du recul pour adopter cette vision, lorsqu’on considère des guerres ou des événements plus personnels qui nous arrivent, que ce soit un conflit au travail ou dans la famille. La lutte contre les passions est aussi un point commun entre les deux traditions, car la distinction entre ce qui dépend ou pas de nous est reprise par les chrétiens. Il y a donc une certaine spiritualité stoïcienne présente dans l’ascèse chrétienne.
Et les différences?
Le stoïcisme a un fondement basé sur la raison, alors dans le christianisme, le fondement, basé sur la révélation, est surnaturel. Raison et grâce peuvent aller de pair, bien sûr, et c’est le cas dans le christianisme, mais le stoïcisme compte sur la raison seule : l’homme peut se sauver par lui-même. Ce n’est pas le cas dans le christianisme.
«Le stoïcisme a un fondement basé sur la raison, alors dans le christianisme, le fondement, basé sur la révélation, est surnaturel.»
Le philosophe Blaise Pascal accuse les stoïciens de pouvoir se sauver eux-mêmes…
Oui, pour reprendre les termes de Pascal, il y a une certaine arrogance du stoïcisme à penser pouvoir se sauver par soi-même, sans l’aide de la grâce. C’est en fait la grande différence entre stoïcisme et christianisme. Les deux traditions ont des buts différents : la vie surnaturelle et le bonheur éternel, après la mort, pour les chrétiens, et le bonheur terrestre pour les stoïciens, en recherchant ici-bas la tranquillité de l’âme, l’ataraxie. On a donc des buts mais aussi des moyens différents d’atteindre le bonheur. Pour les stoïciens, par la raison seule et par leurs propres moyens. Pour les chrétiens, par la grâce et les sacrements, à commencer par celui du baptême, qui nous fait entrer dans la vie surnaturelle. Sans cette grâce et ces sacrements, le chrétien ne peut pas atteindre par lui-même le bonheur éternel. On a donc une même ascèse, mais avec deux fins et deux moyens différents.
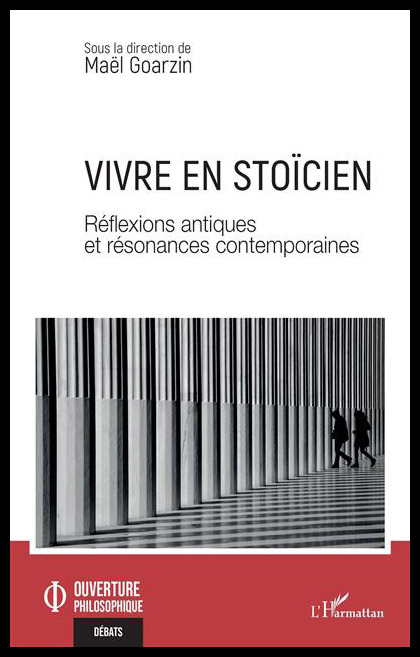
Et ce sont les seules différences?
Non, la foi ou la confiance n’existent pas chez les stoïciens, puisque le surnaturel ne fait pas partie de leur monde. Les stoïciens comptent uniquement sur les vertus naturelles, soit les quatre vertus cardinales (ndlr. justice, sagesse, courage et tempérance). Dans le christianisme, les vertus surnaturelles ou théologales nous sont données par Dieu, par les sacrements et il s’agit de les faire fructifier. Ce sont elles qui apportent cette dimension surnaturelle.
Le stoïcisme est donc surtout une éthique qui prône la vertu, la maîtrise de soi et la recherche de la sagesse, pour atteindre la tranquillité de l’âme?
Oui, c’est une philosophie hédoniste qui cherche à atteindre le bonheur par une vie en accord avec la nature, c’est à dire avec le Dieu conçu comme le logos, la raison universelle. Il s’agit de vivre en accord avec la nature qui nous environne et avec notre propre nature, qui est pour les stoïciens raisonnable et sociable. C’est une vie vertueuse et heureuse tournée vers le bien commun, qui se concrétise par la pratique des quatre vertus cardinales.
L’autre concept clé est cette distinction entre ce qui dépend, ou non, de nous. Nos jugements, nos désirs et aversions et notre impulsion à agir, ou pas, dépendent de nous. Toute l’activité philosophique consiste donc à travailler sur ces trois mouvements de l’âme que sont nos jugements, nos désirs et nos actions, pour atteindre l’excellence dans chacun de ces trois domaines. Accepter notre destin, soit ce qui ne dépend pas de nous, avec gratitude et reconnaissance peut nous apporter la tranquillité de l’âme. Mais cette discipline du désir est à la fois la partie la plus difficile et la plus forte de la philosophie stoïcienne.
C’est donc surtout une philosophie pratique?
Oui, car il ne s’agit pas seulement de penser en philosophe mais de vivre en philosophe, pour transformer toutes les dimensions de son existence. Le stoïcisme propose des exercices quotidiens comme l’examen de soi, l’examen de conscience, la réflexion sur les différents rôles que nous assumons dans notre existence. L’objectif est d’apprendre à agir de la bonne manière, soit selon les stoïciens, avec bienveillance, générosité et acceptation.
Retrouvez Maël Goarzin dans l’émission radio Babel, en podcast sur RTS religion ou via l’App Play RTS, sur smartphone.
On fait aujourd’hui souvent référence au stoïcisme dans le coaching et le développement personnel. Avec quel risque, selon vous?
Celui de réduire la richesse de la philosophie stoïcienne à une série de trucs et astuces que l’on peut appliquer pour, dès le lendemain, aller mieux ! Or le bonheur qu’elle promet n’est pas un simple bien-être, mais une vie en accord avec soi-même, les autres et le monde. Cela demande un travail quotidien, sur le temps long. La dimension sociale du stoïcisme, celle de la réalisation de soi par l’engagement social et politique, est par ailleurs souvent absente du coaching et du développement personnel.
Parce que l’engagement social et politique est important dans le stoïcisme?
Il au cœur du mode de vie stoïcien ! Il découle de la nature sociable de l’homme. Sénèque parlait d’un engagement politique pour le bien commun qui passe par l’enseignement de la philosophie, l’organisation de rencontres philosophiques ou encore l’écriture de livres, pour essayer peut-être de changer le monde à travers les générations futures. (cath.ch/jd/cp/bh)
Vivre en stoïcien. Réflexions antiques et résonances contemporaines, sous la direction de Maël Goarzin, Ed. l’Harmattan, 2024, 226p
Stoïcisme et christianisme
Fondé à Athènes au 3ème siècle avant J.-C. par Zénon de Kition, le stoïcisme se développe durant cinq siècles. Il est marqué par des auteurs comme Sénèque, Épictète et l’empereur philosophe Marc-Aurèle, considéré comme le dernier stoïcien antique, mort en 108 ans après J.-C.Historiquement, stoïcisme et christianisme ont ainsi coexisté pendant les deux premiers siècles de notre ère. Les Pères de l’Église vont leur emprunter divers éléments comme le concept de logos et les premiers chrétiens les exercices spirituels stoïciens. Dans les Actes des Apôtres, Paul présente l’Évangile comme l’accomplissement de la philosophie et de la religion païenne. Il affirme que le Dieu des chrétiens est celui que les Grecs adorent sans le connaître. Enfin, Thomas d’Aquin (1225-1274) utilisera la philosophie grecque, dont le stoïcisme fait partie, pour démontrer que la raison peut comprendre Dieu et son univers. CP
Quel objectif poursuit l’association Stoa Gallica?
Nous créons des contenus pour diffuser le stoïcisme le plus largement possible et nous organisons des rencontres physiques ou virtuelles pour échanger sur ces problématiques contemporaines. Nous avons mis sur pied des lieux d’échanges comme un groupe Facebook, un site internet, un podcast, une chaîne YouTube, et aussi des cafés et des apéros philo à Lausanne. Le but est d’échanger sans être dogmatique, et sans reprendre nécessairement l’ensemble du système philosophique stoïcien, mais avec l’idée que certains exercices spirituels qu’il propose sont encore utiles aujourd’hui. JD
Rédaction
Portail catholique suisse