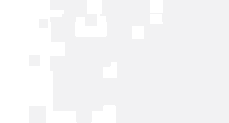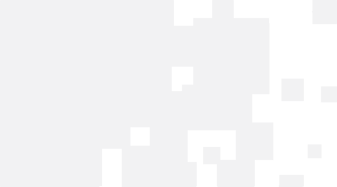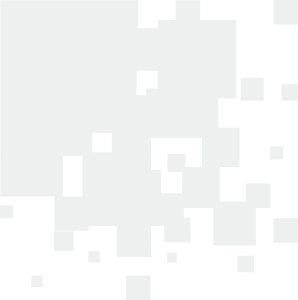«Voir l’invisible» au Mir et faire l’expérience de l’altérité avec l’art brut
Partout dans le monde, l’au-delà est source d’inspiration pour les créateurs. Interrogeant notre rapport à la mort et à l’indicible, une centaine d’œuvres de 14 auteurs et autrices d’art brut sont présentées au Musée international de la Réforme (MIR). Visite guidée avec Lucienne Peiry, commissaire de l’exposition, pour qui «l’étrangeté qui traverse les œuvres d’art brut nous renvoie à la nôtre».
«Ils éprouvent une nécessité intérieure très profonde d’entrer en contact avec ce qu’ils appellent parfois l’invisible, d’autres fois des forces supérieures, des esprits ou des défunts, Et leurs œuvres, qu’eux-mêmes disent inspirées, retracent leurs expériences.»
Ancienne directrice de la Collection de l’Art Brut de Lausanne, Lucienne Peiry a sélectionné les créateurs présentés au MIR, originaires de dix pays différents: Chine, France, Pologne, États-Unis, Ghana, Italie, Indonésie et Tchéquie.
Les artistes exposés au MIR sont convaincus d’avoir un rapport privilégié avec l’au-delà. Au fil de leur rencontre, au travers des cinq salles d’exposition et à la faveur de la scénographie toute en sensibilité de Sarah Nedir, le visiteur se laisse imprégner par leur rapport à la transcendance, à l’altérité.
Du matériel de récupération
Certains des exposants sont déjà connus. D’autres ont été repérés par Lucienne Peiry, qui s’est entretenue avec plusieurs d’entre eux sur leur lieu de vie et de création. Quand l’historienne de l’Art rencontre à Bali Ni Tanjung (1930-2020), «dans sa petite chambre borgne où il n’y a qu’une petite lampe»,celle-ci a déjà 80 ans passés. L’Indonésienne est entourée d’assemblages arborescents, «comme des arbres composés de visages, vraisemblablement ses ancêtres». Cet autel privé lui permet d’entretenir une relation avec l’invisible.
L’accrochage imaginé par Sarah Nedir et la commissaire de l’exposition, composé de papier brillants, dorés ou bleus, et de tiges en bois (salle 1), permet de saisir la fragilité des œuvres de Ni Tanjung, confectionnées avec des matériaux de récupération. Car les créateurs d’art brut vivent souvent dans l’indigence. La plupart ont été mis à l’écart de la société, ou sont même pris pour des déséquilibrés. Poussés par un sentiment d’urgence, par ce qu’ils identifient comme un ›appel’, ils cherchent coûte que coûte à créer. Ils récupèrent alors tous les matériaux qui tombent entre leurs mains.

Ainsi de Marie Lieb (1844-1917). Internée de force à l’âge de 42 ans pour le restant de sa vie, cette paysanne allemande va utiliser les seuls matériaux à sa disposition: des cadavres de mouche ou des restes de nourriture, preuves poignantes du terrible isolement et enfermement qui est le sien, et surtout des draps, qu’elle déchire et avec lesquels elle fabrique des bandes de tissus pour créer, sur le sol de sa chambre, de grands paysages célestes.
Démurges de leurs propres mondes
Elle y «déroule» ainsi son univers, porte ouverte sur son espace intérieur et sur le Ciel. Elle renouvellera à plusieurs reprises cette expérience rituelle à laquelle elle semblait conférer une valeur sacrée. Très fidèlement et précisément reconstituée par l’artiste suisse Malie Genest, sur la base d’une des rares photographies (exposée d’ailleurs au MIR) de la patiente et de ses œuvres, une constellation blanche sur sol noir attend ainsi le visiteur.
«Ces créateurs et créatrices ont décidé d’utiliser leur mise à l’écart pour créer leur propre monde, devenir les architectes de leur univers, commente Lucienne Peiry. Ils n’ont pas besoin d’approbation sociale.»
Une chaîne de sentinelles
Ils ne se considèrent pas comme des artistes, mais comme des messagers, des intermédiaires entre l’ici-bas et l’au-delà. «En lien avec des entités spirituelles ou des forces supérieures, ils leur abandonnent une partie, voire la totalité, de la paternité de leurs œuvres», souligne la commissaire de l’exposition.
Comment finissent-ils alors exposés dans des musées? Entre l’artiste et l’expert, se glissent les sentinelles, témoigne l’ancienne directrice de la Collection de l’Art Brut de Lausanne. «Depuis que l’appellation ‘art brut’ a été inventée par le peintre Jean Dubuffet pour désigner des œuvres conçues par des non-professionnels, elle suscite un intérêt croissant. Dubuffet inscrivait dans ses collections uniquement des personnes qui n’éprouvent pas le besoin d’être reconnues, qui ne vendent pas leurs œuvres. C’est le cas des créateurs exposés ici. Mais il y a toujours une personne, un voisin, un ami, un médecin pour indiquer leur existence. Cela a été le cas pour moi, par exemple, avec Guo Fengyi (1942-2010), une Chinoise que j’ai personnellement rencontrée.»
«En lien avec des entités spirituelles, ils leur abandonnent une partie, voire la totalité, de la paternité de leurs œuvres.»
Des passeurs entre la Terre et le Ciel
Guo Fengyi a créé sur du papier des œuvres au stylo et à l’encre. «Elle se mettait à chaque fois en état de transe pour entrer en relation avec les forces supérieures qui l’inspirent», raconte la commissaire de l’exposition. Elle pratiquait le Qigong, une gymnastique traditionnelle fondée sur le travail du souffle et de l’énergie physique et mentale. Cela déclenchait en elle des visions, qu’elle déployait ensuite, au fur et à mesure qu’elles se manifestaient, sur de longs rouleaux de papier.
Ces états de vacuité sont assez récurrents chez les artistes exposés au MIR. «Cela leur permet d’accueillir des forces occultes, supérieures. Les choses leurs sont révélées, disent-ils, et leurs œuvres sont la matérialisation de cette transcendance.» Car si ces créateurs ne cherchent pas à être exposés, créant souvent pour eux-mêmes, ils se sentent néanmoins appelés à délivrer un message. Eux à qui la société refusent souvent la parole, s’emparent de ce droit reçu d’en haut. Avec leurs œuvres, «ils disent haut et fort combien ils estiment les valeurs religieuses, combien les forces invisibles sont primordiales».
Podesta et la lutte entre le Bien et le Mal
C’est le cas de l’Italien Giovanni Battista Podestà (1895-1976). Victime de la réforme agraire, ce jeune lombard est contraint de quitter sa terre natale, puis à s’engager comme soldat à l’âge de 20 ans durant la Seconde Guerre mondiale, et enfin à travailler en usine.

«Catholique convaincu, il ne se retrouve plus dans la société. Elle est devenue bien trop matérialiste à ses yeux et a perdu de vue les valeurs religieuses. Podestà se rebelle contre la société et manifeste sa désapprobation à travers ses créations. Il livre une œuvre manichéenne, où il traduit la lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Lui aussi dit clairement qu’il n’est pas vraiment responsable de ses œuvres, que c’est Dieu qui les lui inspire. Et lui aussi ne possède rien. Il va donc travailler avec une grande ingéniosité à partir de plâtre, de sciures, de colle, de débris de miroirs.»
Une représentation du ‘Dieu Or’, responsable de la dégénérescences ambiante, emporte sous ses bras les hommes et les femmes, «toute l’humanité qui fléchit sous sa force», interprète Lucienne Péry.
Traduire le message de Dieu, telle est aussi la mission dont se sent investi l’africain-américain John B. Murray (1908-1988). Descendant d’esclaves, illettré, il vit à 70 ans une expérience mystique dans son jardin, sous une lumière irradiante. Il ne s’arrêtera plus alors de peindre des figures anthropomorphes sur toutes sortes de supports (cartons usagers, fenêtres de sa maison, tickets de caisse…), accompagnées d’écritures énigmatiques qu’il est le seul à pouvoir «lire».
Les visions d’Henry Dunant
Parmi les exposants, figure dans la quatrième salle un Suisse que l’on ne s’attendrait pas à croiser ici, Henry Dunant (1828-1910), fondateur de la Croix Rouge. Et pourtant… Entre 1877 et 1890, le prix Nobel de la Paix se trouve très isolé à Baden et rempli d’idées noires. Il est persuadé que l’Apocalypse n’est plus très loin. Il compose alors, sur des papiers d’emballages transformés en parchemins, une série de ›diagrammes prophétiques’, laissant libre cours à sa créativité et à sa vision de l’au-delà.
Ces compositions complexes, autre critère essentiel, n’ont pas pour vocation d’être exposées. Elles seront retrouvées chez lui après sa mort, consciencieusement pliées. Elles révèlent une facette intimiste du questionnement existentiel qui habite Henry Dunant. Symboles religieux, inscriptions calligraphiées, bibliques, historiques et mystiques se côtoient dans ses œuvres, dans un foisonnement et un ordre qui invitent à l’observation minutieuse.
De multiples pépites
«Voir l’invisible» recèle ainsi de multiples pépites. Côtoyer ces œuvres, c’est entrer dans la part la plus intime de ces créateurs et créatrices, celle de leur psyché, certes, mais sans doute aussi de leur âme. D’où le trouble induit par la visite. Au travers de leurs expériences mystiques, concrétisées dans ces œuvres, le visiteur est appelé à plonger dans le mystère qui habite le monde, la douleur de ne pas en percer le sens et l’espérance en un au-delà où tout s’éclairera.
Un dernier objet, impossible à contempler sans admiration et émotion, incarne tout cela à la fois. Durant dix ans, la couturière normande Jeanne Laporte-Fromage, internée elle aussi jusqu’à la fin de sa vie, confectionna une robe de cérémonie sur drap de laine, ornementée de broderies de motifs végétaux et d’oiseaux.
Un habit conçu suite au deuil de son mari, en prévision du jour où elle le rejoindra enfin dans l’au-delà. Une œuvre destinée à célébrer l’amour et à le libérer. (cath.ch/lb)