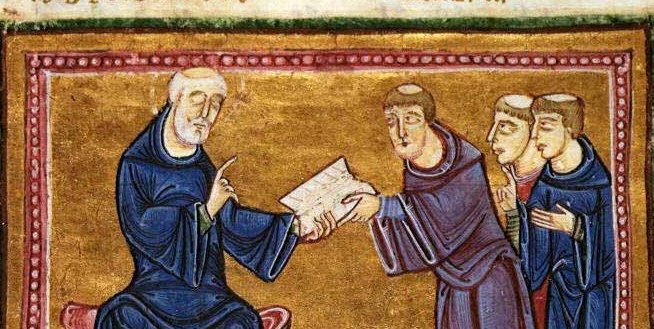Maxime Morand: «Au-delà du contrôle, l’assessment doit être un tremplin»
À l’avenir, les candidats au ministère et les futur-e-s agent-e-s pastoraux devront tous passer un assessment psychologique pour travailler dans l’Église en Suisse. Qu’est-ce qu’un assessment? Et comment pourrait-il être mis en pratique? cath.ch a posé la question à Maxime Morand spécialiste en ressources humaines.
La mise en place d’une telle mesure de prévention, prévue en 2025, pose de nombreuses questions. Plutôt que d’un outil de contrôle et de répression, Maxime Morand y voit un instrument de développement personnel et collectif.
Maxime Morand
Après avoir été moine cistercien, Maxime Morand a été ordonné prêtre diocésain en 1981. Il a quitté le ministère en 1986. Pendant plus de vingt-cinq ans, il a travaillé comme formateur de cadres dirigeants, directeur des ressources humaines de grandes banques dans le monde entier. Depuis 2012, il exerce une activité de conseils et de formations en leadership, ressources humaines et risques humains, sous le vocable de Provoc-Actions à Carouge (GE).
Le mot assessment sonne encore de manière barbare à de nombreuses oreilles. De quoi s’agit-il?
Maxime Morand: L’origine des assessment remonte à la Deuxième guerre mondiale, lorsque les alliés cherchaient à recruter rapidement des agents de renseignement. Des officiers eurent l’idée d’organiser des exercices de simulation sur plusieurs jours, afin de tester les candidats dans des situations concrètes.
Le principe est depuis resté le même. On propose aux candidats de réaliser des exercices sous le regard de plusieurs observateurs qui vont examiner non seulement les capacités à résoudre un problème, mais aussi la pertinence des arguments, les attitudes et les comportements.
«Une personne incompétente se distinguera assez vite, mais quelqu’un qui apporte des risques ne se verra pas.»
Habituellement ce travail d’évaluation se fait non pas de manière individuelle, mais par groupe de quelques candidats avec des travaux personnels et collectifs. Ainsi, il est possible d’observer des interactions ce qui est un facteur clé d’une évaluation.
A la fin de l’exercice, les évaluateurs confrontent leurs observations à partir d’une grille de critères pour remettre un rapport unique à l’assesseur principal qui détermine les conclusions et les remet à la personne responsable de l’engagement. En bonne pratique, l’assesseur n’a pas lui-même de pouvoir de décision.
Comment l’assessment peut-il être un instrument de prévention des risques d’abus?
Là dessus, je reste très prudent. Je pense qu’on peut parler de 30% de certitudes, même si certains confrères et concurrents présentent à leurs clients un taux de réussite voisin de 100% ! Un assessment va permettre de détecter assez aisément d’un côté les ‘cas’ et de l’autre les gens brillants, mais pour la masse intermédiaire c’est beaucoup moins évident. Dans ma carrière professionnelle auprès des banques, il m’est arrivé de recommander des personnes qui par la suite ont détourné des millions de francs. Une personne incompétente se distinguera assez vite, mais quelqu’un qui apporte des risques ne se verra pas.
A priori, on ne pourrait pas détecter des pervers ou des prédateurs?
Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de ce qui est ‘en dessous de la ligne de flottaison’, pour cela il faudrait consulter des psychiatres. En outre les gens peuvent modifier aussi leurs comportements au cours de leur vie. Ce n’est pas forcément à l’entrée que l’on va pouvoir déterminer les risques. Je pense à ce prêtre bien placé et apprécié qui se fait ‘attraper’ par la secrétaire de paroisse qui découvre des images pédo-pornographiques sur son ordinateur et chez qui la police débarque un beau matin.
«Aujourd’hui nous plongeons, y compris en Église, de plus en plus dans un univers de normes. C’est catastrophique.»
Vous défendez un assessment positif qui vise à développer le potentiel des personnes.
Une telle procédure devrait non seulement permettre d’évaluer les compétences et les risques, mais aussi d’identifier le potentiel des personnes. J’ai souvent constaté que ce sont les gens les plus brillants qui cherchent le plus à se développer. En fonction du résultat, on pourra leur proposer telle ou telle formation spécifique. Un assessment peut également ouvrir à d’autres horizons. Un jour j’ai recommandé à un banquier de lire la revue Études des jésuites. Il me l’a rappelé des années plus tard alors qu’il était resté un fidèle abonné.
L’enjeu est que l’assessment n’apparaisse pas comme un instrument de contrôle et de répression.
Le pape Jean Paul II a introduit un serment pour les évêques. A mes yeux, cette notion héritée du droit germanique est en fait contraire à l’idée de promesse, d’ordination pour un prêtre ou de profession religieuse. Car on entre dans le domaine du permis et de l’interdit, alors qu’il s’agit de comportement de vie.
Le respect de la norme n’est donc pas le seul critère.
Dès la Règle de saint Benoît, on peut distinguer trois éthiques: le discernement, les normes et la situation. Aujourd’hui nous plongeons, y compris en Église, de plus en plus dans un univers de normes. C’est catastrophique.
«Renoncer par principe d’être jugé par ses pairs me paraît dépourvu de sens.»
Au chapitre 40 de sa règle, saint Benoît parle des prescriptions concernant la boisson. Il commence par dire que chaque moine devrait être capable d’en discerner par lui-même. Puis il constate qu’il y a des infirmes, des malades ou des abus et donc qu’une régulation est nécessaire. Il fixe une norme d’une ‘hémine’ (une mesure de l’époque dont on ignore la contenance, NDLR) de vin par jour. Mais il continue avec l’éthique de situation: certains moines qui travaillent dans les champs ont une dépense physique qui dépasse celle de ceux qui chantent au chœur. Il leur faut donc d’avantage d’aliments. En conséquence et sans récrimination, on peut donner plus à celui qui a besoin de plus et moins à celui qui a besoin de moins. L’Abbé est l’interprète de la règle.
Comment pourrait-on mettre en œuvre cette pratique en Église?
Je suggérerais que des spécialistes externes forment en Église des personnes capables de faire ce travail d’observateurs. Au fond il s’agit d’un travail de discernement tel que le développent déjà la règle de saint Benoît ou le système jésuite. Confier cette tâche à des experts externes est une tendance lourde qu’on retrouve dans toute la société. Mais il faut éviter que cet outil soit purement externe, l’Eglise doit s’y impliquer. Renoncer par principe d’être jugé par ses pairs me paraît dépourvu de sens.
La direction de l’Eglise a été longtemps quasi exclusivement masculine. Ce qui a certainement limité sa capacité de discernement.
Je recommanderais d’intégrer des femmes dans le processus. Il m’est arrivé souvent qu’elles apportent un avis négatif, parfois sans même être capables de le formaliser verbalement. Qu’elles détectent quelque chose que j’avais été incapable de voir.
«Si on mène un assessment uniquement pour éviter les risques juridiques, on fait fausse route.»
Vous préconisez aussi une démarche collective.
Un travail en groupe permet de gagner du temps et d’éviter le sentiment de tribunal. Il offre une autre dynamique. Il peut être profitable aussi pour les observateurs et l’assesseur pour progresser dans leur pratique.
L’assessment devrait être une sorte de tremplin pour un développement personnel. Si on le mène uniquement pour éviter les risques juridiques, que l’on ne pourra d’ailleurs jamais éliminer totalement, on fait fausse route.
Enfin on peut aussi se fier à d’autres signaux classiques. Par exemple une personne qui a souvent changé de poste en peu d’années devrait attirer l’attention d’un responsable des ressources humaines.
Finalement est-ce que la question ne réside pas dans l’accompagnement et le suivi des personnes par les responsables pastoraux?
Probablement, la présence d’un superviseur, qui n’est pas le confesseur ni le directeur spirituel, peut être utile. Même si cela peut rester ambigu. On peut s’interpeller: ‘voici ce que je te recommande de continuer de faire; d’arrêter de faire; de te mettre à faire’. C’est simple direct et très efficace. Nous avons dans l’Eglise ce genre de ‘sages’ que nous devrions mobiliser pour cela.
La question de la protection de la personnalité se pose.
Oui, selon ma pratique, le candidat doit avoir accès au résultat de son assessment et pouvoir le cas échéant le commenter. Ensuite ce résultat ne doit pas faire partie de son dossier personnel légal, mais être conservé de manière séparée et confidentielle par l’employeur. Seules les personnes dûment autorisées peuvent le consulter. En outre toutes les personnes qui participent à la procédure d’assessment doivent signer un engagement à ne pas en dévoiler le contenu.
«Nous devons écouter la parabole de la brebis perdue et ne pas perdre de vue la miséricorde divine.»
Que faire avec les personnes dont l’assessment serait défavorable ou montrerait des risques?
Je pense que dans tous les cas la dignité de la personne reste le premier critère incontournable. Cela vaut bien sûr pour les victimes, mais aussi pour les coupables. Nous devons écouter la parabole de la brebis perdue et ne pas perdre de vue la miséricorde divine. Il faut aussi considérer que des relations consenties entre adultes ne sont pas un problème. Le problème est la coercition et l’emprise.
Il faudrait creuser aussi ‘l’arrière-pays’ des valeurs et des réflexes que nous transmettrons. Il n’y a pas de ‘thermomètre’ pour le respect. Le jugement dernier, au chapitre 25 de l’évangile de Matthieu, ne parle pas de sexe mais des œuvres de charité, donner à manger à ceux qui ont faim, soigner les malades, visiter les prisonniers etc. Ce sont des choses concrètes.
Dans l’évangile, on voit que Jésus s’adresse à tous sans discrimination, il renverse les choses, rappelle que le sabbat est fait pour l’homme et non l’inverse. (cath.ch/mp)
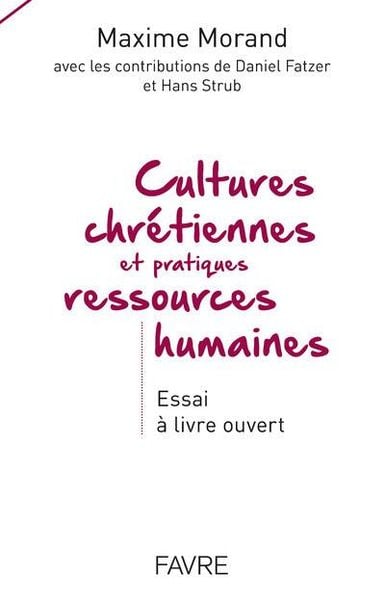
Maxime Morand a publié en 2020, avec la contribution des pasteurs Daniel Fatzer et Hans Strub: Cultures chrétiennes et pratiques ressources humaines. Ce manuel propose de poser les bonnes questions afin d’éviter de la souffrance et favoriser les pratiques inspirantes utiles et adéquates pour la gestion du personnel notamment en Église.