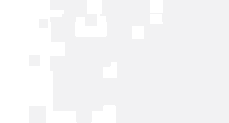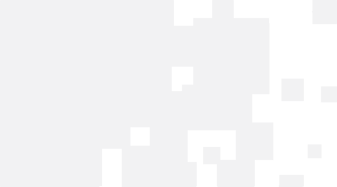problèmes actuels du mariage chrétien
Louvain-la-Neuve : rencontre sur les (030688)
Louvain-la-Neuve, 3juin(APIC/CIP) Un profond changement des mentalités et
des comportements affecte aujourd’hui le mariage comme institution et comme
sacrement. L’Abbé Gaston Candelier, spécialiste en droit canonique et official de l’évêché de Tournai, a évoqué quelques-uns des problèmes posés en
la matière, lors d’une rencontre organisée par la Faculté de Théologie, le
28 mai, à Louvain-la-Neuve.
Ce n’est pas d’abord le mariage qui a changé, mais la société et la
culture occidentales qui ont évolué. Jadis, le mariage était censé garantir
à la fois la sécurité des époux, le rôle économique de l’unité familiale,
la transmission du patrimoine, sans oublier la régulation de la sexualité.
L’amour des époux n’apparaissait pas comme la fin première du mariage, mais
plutôt comme un moyen. Et il a paru normal à la Curie romaine de préciser,
dans les documents préparatoires du Concile Vatican II, que «la fin
primaire du mariage est uniquement la procréation» et l’éducation d’une
descendance.
Vatican II a introduit, à cet égard, une véritable «révolution» dans
l’Eglise, souligne l’Abbé Candelier. A la suite du Concile, en effet,
l’Eglise parle avant tout de «la communauté profonde de vie et d’amour que
forme le couple». Elle insiste d’abord, non pas sur la procréation, mais
sur l’engagement mutuel des époux, sur «l’union intime de leurs personnes
et de leurs activités».
Amour et institution
Cette «révolution» est désormais inscrite dans la législation ecclésiale. Selon le Code de Droit canonique de 1927, le mariage était essentiellement un contrat. Dans un contrat, précise Gaston Candelier, c’est l’objet
du contrat et non la personnalité des contractants qui est déterminant. En
l’occurence, l’objet du contrat matrimonial n’était autre que la cession et
l’acceptation mutuelles entre les conjoints d’un droit personnel et exclusif sur le corps en vue des actes «aptes par eux-mêmes à la génération». Le
contrat ne portait donc pas sur l’amour conjugal. Dans la jurisprudence
ecclésiastique, le terme «amour» était d’ailleurs plutôt employé pour
désigner la relation charnelle et érotique entre un homme et une femme.
D’après le nouveau Code de Droit canonique, ce n’est plus l’objet d’un
contrat entre conjoints qui définit le mariage, mais l’alliance entre des
personnes comme telles. Le terme «contrat» ne figure d’ailleurs pas dans
les textes conciliaires, dont les rédacteurs ont voulu respecter les conceptions de l’Eglise d’Orient. Dès le premier schéma de révision du Code de
Droit canonique, le mariage était défini comme une «conjonction intime de
toute la vie entre un homme et une femme», étant entendu que cette union
est de soi ordonnée à la procréation. En échangeant leur consentement,
c’est donc un «oui» à la personne de l’autre comme tel qu’expriment les
nouveaux conjoints. C’est envers un partenaire que chaque conjoint s’engage, et non envers une institution. Le geste premier est l’engagement
réciproque par alliance entre des personnes. L’institution matrimoniale est
seconde : elle dérive de l’engagement, et non l’inverse.
Si tel est l’essentiel dans le mariage, il convient cependant de ne pas
réduire le mariage à une conception culturelle unique. Les Africains, par
exemple, ont une conception globalisante des rapports humains. Pour eux,
acte personnel et engagement communautaire s’imbriquent fortement. En Afrique, le mariage commence par une alliance entre les familles respectives
des futurs conjoints et l’engagement dans le mariage passe nécessairement
par différentes étapes, sans qu’on puisse parler pour autant de «mariage à
l’essai».
Et le sacrement ?
En élevant le mariage «à la dignité de sacrement», l’Eglise catholique,
à la différence de ce qui se passe pour les autres sacrements, n’a pas créé
une institution nouvelle : le mariage existe avant et en dehors de l’Eglise, même si le sacrement renforce les exigences et la richesse d’un
engagement qui a déjà sa propre valeur.
Or, selon le Code de Droit canonique de 1917, c’est le contrat matrimonial, à savoir l’échange des consentements entre baptisés – même si l’un
d’eux n’est pas catholique – qui instaure le sacrement, et ceci indépendamment de la présence du prêtre. Tout mariage entre baptisés, s’il est valide, est donc sacramentel.
Le nouveau Code de Droit canonique a repris à son compte cette doctrine
«communément admise», sans toutefois préciser davantage les conditions
théologiquement requises. Or, des problèmes se posent, du fait que, «de
ceux qui sont baptisés, il est requis, sous peine d’invalidité, que le mariage soit un sacrement». Si la célébration religieuse n’équivaut pas à un
mariage dans le chef d’un des conjoints, ou si, à ses yeux, le «oui» qu’il
a prononcé devant l’Eglise n’est qu’un consentement de pure formalité, on
considère aujourd’hui, jusque dans la jurisprudence romaine, que le mariage
n’est pas valide. Et comme un mariage non valide ne saurait être sacramentel, une dispense est possible pour le «cconjoint» qui, après dissolution
de l’engagement prononcée en justice, voudrait contracter un mariage sacramentel avec un nouveau partenaire.
Ces précisions sur la nature sacramentelle du mariage importent beaucoup
aux canonistes, car une fois reconnue la valeur sacramentelle d’un lien
conjugal, l’Eglise affirme bien entendu que le mariage est indissoluble. Il
existe cependant encore des cas d’espèce, ou la rupture d’un premier lien
peut donner lieu à une dispense ecclésiastique en vue d’un mariage qui soit
cette fois sacramentel. Même un mariage consommé pourrait donner lieu à une
telle dispense, s’il s’avérait que la consommation de l’union conjugale n’a
été qu’un pur viol, ou si l’un des conjoints s’opposait réellement à l’expression de la foi de son partenaire chrétien.
Enfin, il convient de noter que nombre de juges ecclésiastiques, sur la
base de leurs rencontres avec des couples en difficulté, réclament aujourd’hui de nouveaux approfondissements théologiques de la réalité sacramentelle du mariage.
La situation des divorcés remariés
Dernier problème abordé par Gaston Candelier : le malaise des divorcés
remariés et le malaise des pasteurs toujours interpellés par des situations
«personnalisées»! Alors que le divorce «survient rapidement et dans tous
les milieux», constate l’official de Tournai, les divorcés remariés demeurent attachés au principe de l’indissolubilité du mariage. En outre, le
nouveau couple qu’ils forment est souvent sans commune mesure avec le
précédent. Nons seulement celui-ci a échoué, mais on doit souvent constater
la «mort d’une relation, et d’une relation normalement structurante». En
pareil cas, continuer à tenir le premier lien, même s’il est creux, pour un
symbole de fidélité, n’est-ce pas «préférer une fiction juridique à une
réalité nouvelle», surtout si celle-ci est «pleine de vie» ?
En posant cette question, Gaston Candelier n’entend pas faire fi de
l’exigence radicale de fidélité réaffirmée par le Christ lui-même. Il se
demande seulement si cette exigence doit être uniquement comprise dans un
sens juridique et si, lorqu’une communauté conjugale est irrémédiablement
détruite, une dispense en vue d’un remariage doit rester impensable dans
l’Eglise catholique. «Faut-il cacher la miséricorde de Dieu aux divorcés
remariés», demande encore l’Abbé Candelier. Et la tolérance de l’Eglise orthodoxe à cet égard équivaut-elle à «une foi et une sainteté moins grandes»? L’official de Tournai ne prétend pas résoudre ces questions délicates. Il suggère surtout en conclusion «que la pastorale ne fasse pas fi de
la doctrine, mais que la doctrine ne soit pas insensible aux appels de la
pastorale». (apic/cip/bd)