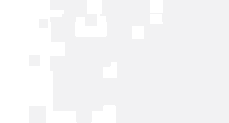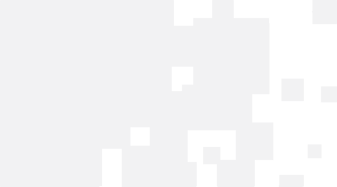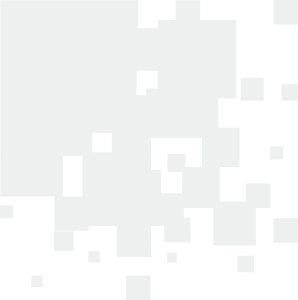Le Père Bonino dénonce les obstacles au dialogue théologique
Le dominicain Serge-Thomas Bonino, secrétaire général émérite depuis 2019 attend depuis un an la nomination de son sucesseur. Cette situation est lié à la crise sanitaire et à ses conséquences. Mais pour lui, il y a aussi le fait que la commission théologique n’est pas perçue aujourd’hui comme une priorité.
Camille Dalmas, I.Media
En 2019, la Commission théologique internationale (CTI), plus haute institution consacrée à la science sacrée au sein de l’Église catholique, célébrait ses 50 ans. Le Père Serge-Thomas Bonino doyen de l’université pontificale de l’Angelicum à Rome et secrétaire général de la CTI, dresse pour I.MEDIA un bilan de ce demi-siècle. Incompréhensions culturelles ou dogmatiques, méfiance du pape François, déclassement de la théologie: le prêtre souligne le très grand défi que représente la recherche de réponses théologiques communes dans un monde catholique éclaté.
La Commission théologique internationale, dont vous êtes le secrétaire général, a célébré en 2019 le 50e anniversaire de sa fondation (1969). Dans un récent discours, le pape François a souligné le lien qui unit cet organisme au Concile Vatican II. La CTI a-t-elle été pensée pour prolonger l’héritage du Concile ou éviter des excès potentiels qui viendraient dénaturer son esprit?
La Commission théologique internationale a été constituée pour deux raisons : la première, positive, afin de mettre en avant le rôle moteur des théologiens, dans le sillage du Concile Vatican II, et continuer à porter les ambitions intellectuelles réveillées à cette occasion.
Dans une perspective plus «négative», cette commission a aussi été voulue afin de rééquilibrer l’importance qu’avait jusqu’alors la Congrégation pour la Doctrine de la foi (CDF) – l’ex-Saint-Office. La CDF était – et est toujours – constituée en très grande majorité de professeurs romains; ce qui est normal, parce qu’elle siège à Rome, et qu’il importe que ses membres soient sur place – je suis moi-même consulteur dans cette congrégation. Mais il n’empêche que le «climat romain» est un peu spécial, qu’il s’agit d’un monde avec son fonctionnement et ses habitudes propres. Il fallait donc rééquilibrer les évaluations doctrinales de la CDF en faisant appel à des théologiens venant du monde entier.
Cela ne s’est pas bien passé dans un premier temps : la Congrégation pour la doctrine de la foi était en effet au départ très hostile à l’existence de ce corps extérieur qui s’occupait des mêmes questions qu’elle. Cependant, la situation s’est nettement améliorée par la suite, principalement parce que la CTI a été, si j’ose dire, bien «domestiquée».
La CTI n’est-elle pas hiérarchiquement sous le contrôle de la CDF?
Le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, préfet de la CDF, est aussi le président de la Commission et son rôle n’est pas honorifique. On a séparé les deux entités mais elles gardent la même tête. La CTI est indépendante; cependant, notre organisme a un rôle important pour la CDF: aujourd’hui, nous fournissons souvent des «munitions de fond» à la Congrégation, qui peut reprendre nos travaux pour rédiger ses documents, comme elle a pu le faire récemment.
La CTI a pour but de faire dialoguer des théologiens du monde entier. Mais les théologiens parlent-ils la même langue ? Dans une vidéo de présentation de la CTI récemment parue, on entend par exemple le pape Jean Paul II s’exprimer en français devant les membres de la commission. Savez-vous pourquoi?
Le français a longtemps été la langue théologique de la même façon qu’elle a longtemps été respectée comme la langue diplomatique par excellence. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. De manière générale, la langue des institutions romaines reste l’italien, mais l’anglais est un rouleau-compresseur qui gagne du terrain. Au sein de la CTI, les cinq grandes langues – anglais, français, italien, espagnol et allemand – sont utilisées pour les sessions plénières, et on a alors recours à des traducteurs. Dans les travaux en groupes plus restreints, on cherche un terrain d’entente. Généralement c’est l’italien, que parlent beaucoup de membres de la commission, parce qu’ils ont souvent fait leurs études à Rome. Cependant, la langue peut parfois être une barrière: lors du dernier quinquenium [mission de cinq ans, ndlr] un des membres, un Américain, ne parlait que l’anglais. Cela a été très handicapant pour lui et pour les autres.
Les difficultés sont-elles aussi culturelles?
Oui. Par exemple, nous avons récemment réfléchi sur la question de la laïcité. En France, c’est un terme perçu souvent comme péjoratif par les catholiques. Pour un de mes collègues indiens en revanche, la laïcité est le salut pour les populations chrétiennes de son pays, le rempart qui les protège. Nous ne parlons pas du même point de vue.
C’était le défi au départ: faire dialoguer des cultures mais aussi des perspectives théologiques différentes. Cet objectif a-t-il été rempli?
Oui, car malgré les différents réels, une culture commune nous unit, ce qui facilite les échanges. Pour l’anecdote, dans les années 2000 – à mes débuts dans la CTI comme simple consulteur – le président était alors le cardinal Joseph Ratzinger, et il animait alors les débats en latin ! Pour certains, je pense que c’était difficile, notamment pour les pays qui n’ont pas de tradition latine, comme l’Inde par exemple.
Le pape émérite Benoît XVI, qui a été un des premiers membres de la commission et son président, semble avoir laissé sa marque dans la CTI…
Oui, il a eu un rôle très important en tant que théologien puis président de l’entité de 1981 à 2005. Naturellement, il nous a honoré d’un message, en plus de celui du pape François, lors de notre 50e anniversaire. Benoît XVI a connu les débuts extrêmement difficiles de la commission, difficultés qui s’explique en partie par la qualité de la commission à l’époque. De fait, dans les années 60, il n’y avait que des «divas», si j’ose dire. Quand on pense à Yves Congar, Urs von Balthasar, Karl Rahner, Henri de Lubac, Louis Bouyer… Ratzinger a vécu cette période qui a été marquée par un climat de conflit généralisé.
Commente évite-on de transformer un lieu de débat intellectuel en un champ de bataille?
La difficulté d’être membre de la CTI est qu’il s’agit d’une ascèse: le but n’est pas de faire passer ses idées, mais d’essayer d’exprimer ce qu’est la pensée catholique commune. Cela veut dire renoncer dans certains cas, ce qui n’est pas facile pour quelqu’un qui a une synthèse théologique personnelle profonde et intéressante. Un des rôles «prophétiques» de cette commission est d’apporter du dialogue dans un monde, celui de la théologie, où il n’y en a pas beaucoup aujourd’hui. Chacun à tendance à suivre son petit chemin, dans sa tradition théologique, dans son secteur, et je le dis en m’incluant. Dans la CTI, on s’oblige, sur un point particulier, à essayer de dire ce qu’il y a en commun entre les différents membres.
Sur ce point, peut-on dire que la situation est meilleure aujourd’hui qu’hier?
Oui, mais il reste que la situation de la théologie est aujourd’hui très éclatée. C’est un fait. Il y a environ huit ans, nous avions produit un document sur la théologie catholique pour déterminer ce qui unissait tous les théologiens, et s’il y a vraiment une possibilité – voire une nécessité – de dialoguer. Il y a certes une unité institutionnelle qui est très forte. Malgré cela, nous faisons le constat de l’existence de cultures théologiques radicalement différentes.
Pendant très longtemps – je suis mal placé pour en parler [en tant que dominicain, ndlr] – il y a eu une théologie officielle : le thomisme. Aujourd’hui, on observe non seulement un pluralisme, mais aussi la disparition d’une base commune qui fait qu’il est difficile de s’entendre, car souvent on ne parle pas tout à fait le même langage théologique. Dans le thomisme, les instruments sont la métaphysique et la philosophie, là où aujourd’hui certaines théologies s’appuient sur la psychanalyse ou les sciences sociales. Certes, nous, membres, avons la même foi et le même désir de faire passer cette foi dans la culture contemporaine, mais la situation est compliquée. Et ce, à l’image de l’éclatement même du catholicisme ces dernières années.
Vatican II avait été le lieu de dialogues fructueux et animés avec la théologie protestante. Est-ce encore le cas au sein de la CTI?
Ce n’est pas le but de la commission, mais cela concerne plutôt le Conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des chrétiens. Nous sommes attentifs à cette dimension, mais notre mission est d’abord de réfléchir à des problèmes qui touchent l’Église catholique, et qui peuvent avoir un impact dans le dialogue avec les autres religions chrétiennes. De plus, il faut reconnaître que depuis quelques années, l’œcuménisme est passé au second plan par rapport au dialogue interreligieux. Ce dernier est devenu central et cela a eu pour «effet pervers» de mettre en sourdine la question œcuménique. De plus, chez les acteurs du dialogue pour l’Unité, on sent souvent aujourd’hui une forme de découragement : depuis la grande flambée des année 60-70, on a un peu bougé dans ce domaine. Et chaque communauté chrétienne a ses difficultés propres à régler. Par conséquent, on perçoit une forme de lassitude.
Le pape François a récemment mis en garde contre le risque pour les théologiens de susciter des controverses en dehors du cadre du débat intellectuel. La théologie est une affaire qui ne doit pas concerner le grand public selon vous?
C’est une préoccupation forte du pape François qui craint que les problèmes théologiques ou intellectuels viennent troubler le peuple chrétien. Lui-même en appelle plutôt à une piété populaire. Il se méfie beaucoup du monde intellectuel, et en particulier du monde théologique.
On a beaucoup entendu parler, en diverses occasions (en Allemagne ou aux États-Unis par exemple), du risque d’un schisme au sein de l’Église catholique. Au regard du pluralisme théologique que vous décrivez, s’agit-il d’un problème sérieux?
Je ne pense pas. Il y a une différence entre le constat d’une diversité dans l’éclatement de la pensée théologique au sein de l’Église et le «passage à l’acte» que représente le schisme. Cependant, il faut reconnaître que maintenir dans l’unité plus d’un milliard de catholiques est aujourd’hui un défi inimaginable, surtout dans un contexte où chacun a sa théologie et sa façon de voir la religion. Il y a heureusement des forces centrifuges très importantes, celles d’une foi et de structures communes.
Faut-il souhaiter un retour à une théologie officielle, comme l’a été le thomisme auparavant ou la diversité est-elle indispensable?
Le fait qu’il y ait une diversité de courants théologiques me semble fécond. Ce qui m’interroge, c’est la question d’un socle commun. Vatican II a repris les fondations thomistes, précisant qu’elles étaient nécessaires pour la formation, afin d’entrer d’un même pied dans la tradition catholique. On en a toujours besoin pour avoir un langage commun. Une fois acquises ces fondations, on peut en présenter les limites, les contester, mais il est important de pouvoir se comprendre.
La formation est aujourd’hui tellement diversifiée qu’on peut se demander s’il est encore possible de trouver une lingua franca pour aborder certains problèmes. Cependant, je dois par honnêteté reconnaître que les théologiens nommés à la CTI sont souvent des théologiens très classiques, ce qui limite les tensions en interne mais fausse aussi un peu le jeu.
Comment fait-on pour trancher lorsqu’un débat théologique survient au sein de la CTI?
Il y a d’importantes divergences qui sont souvent affichées. Le but n’est alors pas de trancher mais de trouver des termes qui conviennent à tout le monde. Et on évite d’aborder certains sujets qui ne peuvent aboutir à aucune entente. Par exemple, la question du péché originel ou de la définition de Dieu.
Ces questions, qui semblent centrales et décisives, ne sont donc pas débattues au sein de la Commission?
Non, parce que les désaccords existent réellement. Par exemple, il y a des personnes qui considèrent que le péché originel n’a pas de fondation dans l’écriture sainte, que c’est une invention de saint Augustin… Sur la question de Dieu, je fais référence à un événement qui s’est passé à la CTI avant mon arrivée. Les membres devaient à une époque publier un document sur l’annonce du mystère de Dieu, mais il y avait de telles divergences théologiques qu’ils n’y sont pas arrivés. C’est pourquoi on préfère généralement traiter des sujets plus faciles, plus rassembleurs.
Par exemple?
La question de la synodalité, qui sur les principes, ne divise personne. Les sujets d’ecclésiologie [sciences des structures de l’Église catholique, ndlr] en général ne sont pas à risque. Attention, ils n’en restent pas moins des sujets d’actualité théologique importants. Reste que les grandes divergences concernent dans les faits beaucoup plus la théologie dogmatique. Par conséquent, on en fait nettement moins.
Quelle est votre mission aujourd’hui?
Mon quinquenium est terminé depuis 2019. Je suis secrétaire général émérite depuis lors, et j’attends la nomination de mon successeur, qui aurait dû survenir depuis un an.
Est-ce une situation normale?
Non, c’est la première fois qu’on observe un tel délai. C’est lié à la crise sanitaire et à ses conséquences. Notamment les conséquences économiques, qui ont un impact très fort au Vatican. Rien ne pousse à organiser aujourd’hui des rassemblements internationaux coûteux et potentiellement à risque. Il y a aussi le fait, semble-t-il, que la commission théologique n’est pas perçue aujourd’hui comme une priorité.
Y a-t-il besoin d’un renouveau de la théologie aujourd’hui ?
On peut se poser la question. Récemment, nous avons fait un événement lors duquel nous nous sommes demandé : « comment se fait-il qu’il n’y a plus de grands théologiens à notre époque? » Attention, il y en a de très bons, mais plus de très grands comme Lubac ou Congar par exemple. La réponse s’explique avant tout par un nouveau contexte : les théologiens aujourd’hui ont des tâches administratives plus importantes. Et force est de constater qu’un évêque ne lâche pas un prêtre pour enseigner et étudier la théologie, comme cela se faisait avant. Il n’y a plus de cadre propice pour faire de la recherche dans de bonnes conditions. Sauf à appartenir à certaines congrégations traditionnellement vouées à ces tâches. Enfin, nous sommes dans une ère qui donne peu d’avenir à ces recherches théologiques et qui est très étrangère à l’esprit qui animait Vatican II. L’âge d’or que cette période a pu représenter pour la théologie, principalement grâce au Concile, n’existe plus, et le statut du théologien en a pâti. (cath.ch/imedia/cd/mp)