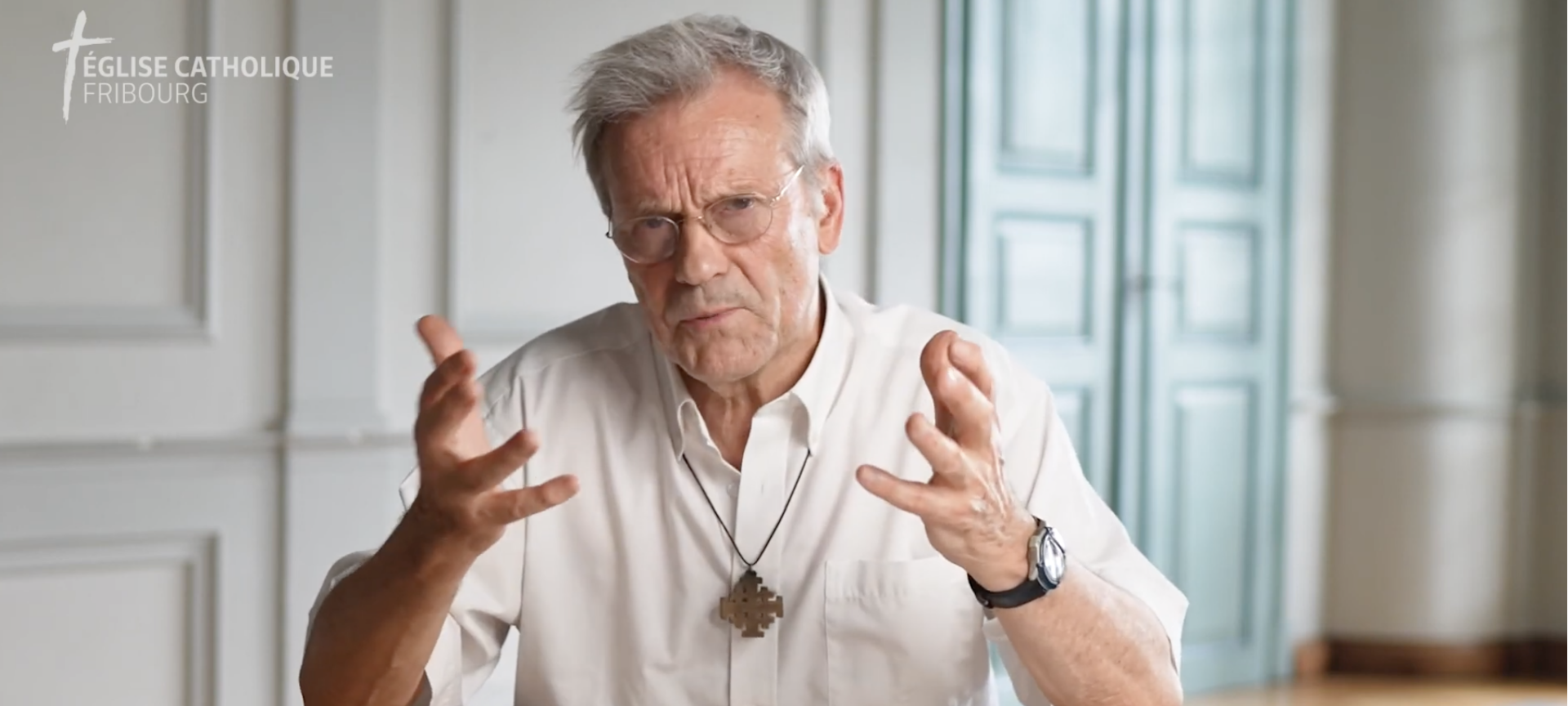La pastorale interculturelle cherche ses marques
Face à la réalité toujours plus présente de l’immigration, l’Église catholique en Suisse s’efforce depuis quelques années de développer sa dimension interculturelle. Coup de projecteur sur un chemin parsemé d’opportunités mais aussi de difficultés.
Ce jour-là, quelque chose s’est réconcilié chez Innocent (prénom fictif). Dans son Togo natal, le médecin était un catholique très pratiquant, avec une vie communautaire très riche. Arrivé dans la région fribourgeoise, il a laissé tout cela de côté, car il ne se retrouvait pas dans cette nouvelle manière de vivre et de célébrer la foi, raconte Veronica Havran à cath.ch. L’agente pastorale l’a accompagné lors de la préparation au baptême de son fils. Au fil de l’accompagnement, il s’est aperçu que quelque chose lui manquait: la dimension de la foi dans sa vie. La célébration, vécue avec l’ensemble de sa famille, a été l’occasion pour lui de renouer avec une pratique oubliée. Avec son frère, il a joué de la musique et entonné des chants togolais. Il a pu transmettre à son fils quelque chose de ses racines et de sa culture. «J’ai senti alors une renaissance chez cet homme, une forme de réunification intérieure», se souvient Veronica Havran.
La foi, un pilier pour les migrants
Pour elle, cette anecdote illustre les bienfaits pour les personnes migrantes de pouvoir vivre leur foi selon leur culture d’origine. «Avec le désir profond de s’intégrer, le danger existe de laisser cet aspect de côté. Or, la foi et la pratique religieuse sont souvent des piliers importants pour les personnes migrantes, confrontées à une multitude de choses nouvelles. C’est une source de souffrance, car personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Et la foi, si on ne la nourrit pas, risque de mourir.»

Veronica Havran, d’origine chilienne, a elle-même vécu ce dilemme. «Lorsque je suis arrivée en Suisse, je ne connaissais pas les us et coutumes du lieu. C’était la première fois, par exemple, que je voyais la communion donnée dans la main. J’ai mis quelque temps à trouver ma place dans ma paroisse. Parce qu’au Chili, comme dans beaucoup de pays du Sud, la façon de faire communauté est différente. Et donc, c’était assez difficile de vivre ma foi. Mais en même temps, j’ai très peu fréquenté la Mission hispanophone, parce que je voulais vraiment apprendre la langue, m’intégrer.»
Une «campagne» nationale
La réception des personnes migrantes dans l’Église relève donc de cette articulation entre adaptation et maintien des racines. «Si l’on doit bien sûr favoriser l’intégration, le but ne doit pas être l’assimilation», estime l’agente pastorale.
Veronica Havran a consacré provisoirement un 20% de temps de travail pour la pastorale interculturelle dans le Décanat de Fribourg. Elle a cependant dû stopper cet engagement pour assurer des nouvelles responsabilités au sein du service de la catéchèse et de la jeunesse de l’Église dans le canton. Le Décanat souhaite malgré tout maintenir les deux temps forts annuels que sont la Messe des peuples et la Messe interculturelle d’entrée en Carême, qui a eu lieu pour la première fois le 8 mars dernier, à l’église St-Pierre, à Fribourg.
Nouvelle formule: abonnez-vous pour un mois à cath.ch.
33 Fr. seulement.
Des initiatives qui vont dans le sens d’une impulsion donnée au plan national. L’interculturalité tient en effet une place de choix dans l’ordre du jour de l’Église en Suisse. En 2020, la Conférence des évêques suisses (CES) et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) ont adopté un concept global intitulé «Vers une pastorale interculturelle». Il s’agit d’élargir la compréhension de l’Église en tant que «communauté dans la diversité.»
Un concept qui continue d’évoluer
Sa mise en œuvre au niveau national a été confiée au service ‘migratio’ de la CES, dont Isabel Vasquez est la directrice. «Dans un pays où plus de 40% des catholiques sont issus de l’immigration, on ne peut ignorer cette réalité, qui maintient l’Église en vie», explique-t-elle à cath.ch.
Sur le terrain, le chantier en est encore aux fondations. Il a été notamment freiné par la pandémie et les changements de personnel. La stratégie développée comprend aussi bien des «projets internes que des mesures à long terme, comme le financement, la visibilité et la création de modèles interculturels.» Des projets ont été réalisés notamment dans le domaine de l’asile.
De manière générale, la mise en œuvre du concept «continue d’évoluer», assure Isabel Vasquez. «Nombre de ces travaux ne sont pas immédiatement identifiables, car ils nécessitent la collaboration et l’accord d’autres instances.»
«Comment signifions-nous aux personnes migrantes qu’elles sont les bienvenues?» – Veronica Havran
La responsable d’Église admet que «les différentes structures des cantons et des diocèses entraînent des défis», tout en «offrant des chances de développer des approches individuelles et de les mettre en œuvre avec succès». Les besoins et ressources disponibles au niveau local et régional sont quoiqu’il en soit dans l’équation. Dans certains endroits, les réalités interculturelles fonctionnent déjà, note Isabel Vasquez. Dans d’autres, «le processus prend plus de temps et nécessite un soutien plus concret en raison de divers facteurs.» La barrière de la langue et les différentes mentalités théologiques jouent un rôle très important.
L’écueil de l’accueil
Mais l’un des problèmes les plus complexes, selon la directrice de ‘migratio’, reste «l’absence d’une culture de l’accueil, d’une interaction au même niveau qui non seulement intègre les communautés linguistiques, mais aussi amène l’Église locale à assumer sa responsabilité en tant que société d’accueil et à créer une unité dans laquelle chacun est accepté et reçu dans sa multiculturalité.»
Un aspect confirmé par Veronica Havran. «Nous attendons toujours que les personnes migrantes viennent à nous. Mais nous devons nous poser la question: de quelle façon les accueillons-nous, comment leur signifions-nous qu’elles sont les bienvenues, avec leurs différences et leurs richesses?»
Isabel Vasquez est consciente du délicat équilibre entre diversité et universalité. «Avoir des compétences interculturelles et s’ouvrir à un processus d’intégration et d’inclusion ne doit pas signifier que l’on perd son identité. Au contraire, c’est à partir de là que nous sommes authentiques et que nous pouvons mieux interagir.»
La foi spontanée
La pastorale interculturelle a pour objectif «la possibilité de vivre sa foi pour toutes les personnes dans une situation de mouvement», rappelle la responsable d’Église.
Veronica Havran, qui a réalisé son travail de diplôme au Centre catholique romand de formation en Église (CCRFE) sur l’interculturalité, a été confrontée à ce questionnement alors qu’elle officiait dans la paroisse St-Paul de Fribourg, qui dessert des quartiers à forte population étrangère. «Je voyais des enfants africains qui voulaient applaudir ou danser lors des messes, des choses qui sont normales dans leur liturgie. Ils demandaient toujours à leurs parents s’ils pouvaient le faire. Mais personne ne devrait demander l’autorisation de vivre sa foi comme il le ressent. C’est quelque chose qui devrait être spontané!»
De l’extraordinaire à l’ordinaire
Le souhait de l’agente pastorale serait de voir plus d’événements multiculturels. Même si elle admet qu’elle ne sait pas exactement quelle forme cela pourrait prendre. «Pour l’instant, l’interculturalité se vit lors d’événements extraordinaires, comme la Messe des peuples, mais l’idéal serait qu’ils puissent se manifester dans l’ordinaire. Parfois, ce sont des choses très simples à mettre en place, pourquoi pas dans le cadre des prières universelles, ou juste en marquant la fête nationale des personnes d’origine étrangère qui forment une partie de nos communautés…»
«Ensemble, nous pouvons grandir en tant qu’Église et vivre la richesse des rites et des traditions qu’elle possède» – Isabel Vasquez
Sur le plan pratique, elle remarque les difficultés qui peuvent survenir lorsque des communautés demandent à utiliser une église, ou que des personnes issues de la migration veulent obtenir un sacrement. «Elles ne sont pas habituées au mode de fonctionnement de la société suisse et de l’Église ici, où il y a beaucoup de procédures, où tout est très codifié. Je pense que ce serait un plus d’avoir dans les entités pastorales des personnes pouvant agir comme médiatrices entre l’Église locale et les communautés étrangères.»
Pour l’instant, la préoccupation de Veronica Havran est d’élargir le cercle des communautés participantes aux messes interculturelles. Elle voudrait notamment intéresser les migrants plus tardivement arrivés, tels que les Érythréens.
Tous différents, mais unis par le baptême
«Il n’existe pas de recette universelle en la matière», note Isabel Vasquez. Pour elle, un autre défi consiste à lutter contre la peur de l’ouverture. «Ce que nous ne connaissons pas est difficile à accepter, mais dans l’Église, nous sommes tous égaux, unis par la foi depuis le baptême, n’oublions pas l’universalité de l’Église. Ensemble, nous pouvons grandir en tant qu’Église et vivre la richesse des rites et des traditions qu’elle possède.»
Veronica Havran n’est plus à convaincre des bienfaits de l’interculturalité, également pour la foi de chacun et pour l’avenir de nos communautés. Elle est toujours, notamment, impressionnée par l’attitude des femmes érythréennes lorsque elles rentrent dans une église. «Elles enlèvent leurs chaussures, se couvrent la tête, on ressent chez elles tellement de déférence. Alors que nous, nous oublions souvent que nous entrons dans un lieu sacré. Il y a dans les communautés migrantes de multiples autres comportements qui peuvent nous inspirer, nous rappeler des choses essentielles auxquelles nous ne faisons plus attention.» (cath.ch/rz)
À noter que cath.ch réalise depuis quelques années une série sur les Missions linguistiques de Suisse romande.