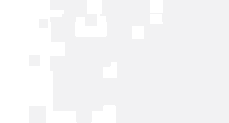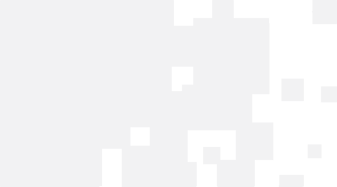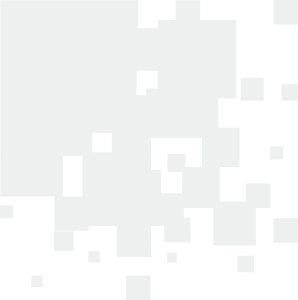J. Tricou: «Les mesures contre les abus restent très périphériques»
Un an après l’enquête sur les abus, l’Église catholique en Suisse a-t-elle posé les bonnes questions, donné les bonnes réponses face à ce fléau? Les réflexions de Josselin Tricou, sociologue des religions à l’Université de Lausanne.
Le 12 septembre 2023, les résultats du projet pilote de l’Université de Zurich sur les abus sexuels dans un contexte ecclésial provoquaient un véritable électrochoc dans l’Église et le grand public, écornant de façon encore inédite l’image de l’institution. Suite à cela, les responsables de l’Église ont entrepris un certain nombre de démarches de lutte et de prévention. Mais les réponses sont-elles appropriées? Josselin Tricou, qui a notamment travaillé pour la Commission française indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), pose sur la question son regard de sociologue.
Comment jugez-vous l’avancement des actions entamées par l’Église en Suisse depuis le 12 septembre?
Josselin Tricou : Les mesures annoncées vont, me semble-t-il, dans le bon sens. Mais on a le sentiment que cela se fait très (trop?) lentement. En partie parce que les responsables cherchent une adhésion aussi large que possible parmi les fidèles et le clergé. Ce qui est compréhensible et assez juste en un sens. Cette large adhésion peut faire en sorte que les mesures soient réellement effectives. Mais pour les personnes concernées et le public, cette lenteur est facilement perçue comme une marque de mauvaise volonté de la part de l’institution.
«Du côté des catholiques plus ‘progressistes’, ces révélations viennent renforcer l’idée qu’un changement structurel s’impose»
De plus, au vu des réactions très contrastées face aux révélations au sein des milieux catholiques, on peut se demander dans quelle mesure une large adhésion est envisageable, et par conséquent, à quel point il est réaliste de conditionner la mise en œuvre de véritables réformes à une telle adhésion.
Que voulez-vous dire?
Globalement on observe deux types de réactions: dans les milieux conservateurs, surtout, on a tendance à contester les chiffres, à dire que c’est pareil voire pire ailleurs, à nier le caractère systémique des abus, et in fine à considérer que l’Église est persécutée par un monde séculier qui lui est hostile. Du côté des catholiques plus «progressistes», ces révélations viennent renforcer l’idée déjà admise depuis longtemps que quelque chose ne va pas dans l’Église, et qu’un changement structurel s’impose.
«En France, il y a eu davantage d’abus dans l’Église catholique que dans les autres secteurs de la société»
L’Église, au niveau suisse comme à Rome, est obligée de composer avec ces deux tendances, qui traversent également ses dirigeants. Ce qui complique considérablement le processus de résilience institutionnelle.
Comment jugez-vous la réaction des évêques en Suisse?
Les mesures de l’Église en Suisse me paraissent encore très «périphériques» par rapport au problème. Mais elles reflètent ce qui se passe au niveau de l’Église universelle. On ne touche pas au cœur du réacteur, si j’ose dire. C’est-à-dire aux structures-mêmes de l’Église, celles qui ont pu faire que les violences sexuelles ont été qualifiées, par le rapport de la Ciase, de «systémiques».
L’une des principales avancées de la Ciase a été de démontrer que la fréquence du phénomène n’était pas la même dans tous les secteurs de la société. Oui, en France, il y a eu davantage de violences sexuelles sur mineurs commises dans l’Église catholique que, par exemple, dans le sport ou dans l’Éducation nationale. Le seul secteur où ces violences sont plus fréquentes est la famille. A partir de là, il s’agit de se demander pourquoi l’Église est un milieu plus «à risque».
Et pourquoi?
Ça c’est justement la question de la systémie. Des éléments de types très divers de la structure de l’Église et de la culture catholique entrent en synergie pour faciliter les abus et leurs impunités. Ces facteurs ont pu, par exemple, être situationnels. Pendant très longtemps, des clercs, notamment enseignants, ont eu accès hors de la surveillance d’autres adultes à un très grand nombre d’enfants et d’adolescents dans des lieux fermés, tels que les internats.

Ceux ayant trait à la structure et à la culture cléricale jouent un grand rôle. L’exclusion des femmes, la culture d’obéissance, notamment. Cette dernière peut mener à une infantilisation des fidèles et les rendre plus facilement manipulables et vulnérables aux abus de pouvoir. La «sacralisation» de la figure du prêtre, également, apparaît comme un facteur systémique fort, pas seulement dans le cadre de la perpétration des actes, mais aussi dans leur dissimulation. Combien de fois n’a-t-on pas entendu des récits de victimes dans lesquelles le prêtre n’a pas été inquiété parce qu’il était considéré comme au-dessus de tout soupçon, voire tout simplement intouchable quand bien même «on savait».
Et la morale sexuelle?
Cela joue également un grand rôle. Il y a une importante difficulté dans le catholicisme à simplement parler de sexualité, à définir ce que peut être une relation sexuelle éthiquement correcte – si ce n’est bonne – hors mariage hétérosexuel, à distinguer – y compris dans cette configuration seule jugée non-peccamineuse – les notions de consentement et de non-consentement.
«L’Église craint qu’en touchant aux ‘murs porteurs’, tout l’édifice s’écroule»
L’histoire de l’Abbé Pierre est à ce titre exceptionnelle mais significative. Il a plusieurs fois parlé en public de ses agissements comme des infractions à la discipline du célibat. Son inquiétude était uniquement portée sur cet aspect mais jamais sur le fait de savoir si la personne en face avait les mêmes attentes que lui. Dans cette logique, c’est la discipline qui est perçue comme la victime de ses agissements, pas la personne en face.
En ce sens, l’obligation de célibat joue, mais certainement moins comme cause des violences elles-mêmes que comme cause de confusion et de non-dénonciation des pratiques sexuelles violentes. Confusion puisque toute pratique sexuelle – consentie entre adultes ou violente – est déjà une atteinte à la chasteté à laquelle on s’est engagé. Non-dénonciation parce que cette discipline empêche le corps clérical d’aborder collectivement, publiquement et avec sérénité la question de l’existence d’une sexualité active en son sein et de faire le tri.
Pensez-vous que l’Église peut, à terme, «réduire» ces facteurs systémiques?
Certains de ces facteurs le sont assez facilement. Je pense à ceux qui sont les plus pratiques, tels que les facteurs situationnels. J’ai en revanche plus de doutes concernant les éléments qui touchent à la structure même de l’Église, à son système hiérarchique, à ses principes moraux. Il me semble que l’Église y voit un certain nombre de «murs porteurs». Elle craint qu’en y touchant, tout l’édifice s’écroule. Donc, elle s’y engage avec beaucoup de réticence. Et je n’ai pas l’impression que le Synode osera réellement s’y attaquer de front.
«Le ‘verrou romain’ fait que seul le pape peut théoriquement décider des changements structurellement importants»
Mais au niveau suisse, que serait-il selon vous judicieux de mettre en place?
Difficile de dire aux évêques ce qu’ils doivent faire, surtout dans le cadre d’une interview média. Je peux juste exprimer ici un regret en tant que chercheur qui s’est engagé sur le sujet: ils ont refusé de financer une enquête de type sociodémographique sur les abus. Depuis que je suis en Suisse, je milite pour, sans résultat. Une enquête sur archives, telle que celle menée par l’Université de Zurich, si importante soit-elle, est par principe lacunaire. Notamment parce qu’un très petit nombre de victimes se manifeste à l’institution ou la justice. Une enquête de victimation en population générale, croisée avec des entretiens intensifs, permettrait au contraire, de tracer les grands contours du phénomène indépendamment des biais inhérents à une enquête sur archives et d’en comprendre les mécanismes facilitateurs avec finesse.
Un autre avantage d’une telle enquête serait celui de la comparaison avec les autres Églises. Surtout que la Suisse, au regard de son pluralisme confessionnel, est un terrain idéal pour ce faire, ce que n’était pas la France. Dans quelles Églises ou communautés religieuses les cas sont-ils les plus fréquents? S’il y a des différences de fréquence, quels sont alors les mécanismes spécifiques en jeu? Ce sont là des questions auxquelles la science n’a pour l’instant pas assez d’éléments pour se faire une idée absolument claire, au-delà d’intuitions partagées ou d’hypothèses de travail.
Plus qu’une prise de conscience, un tel travail comparatif permettrait d’objectiver par contrastes et loin de tout fatalisme des leviers concrets pour réduire les risques dans chacune de ces Églises. Mais le débat médiatique montre bien que, d’un côté, l’invocation d’une spécificité catholique des abus sert le plus souvent l’attentisme des Églises issues de la Réforme sur la question chez elles. De l’autre, le refus d’objectiver cette probable spécificité au sein de l’appareil catholique sert à éviter toute réforme effective au profit de solutions cosmétiques.
Quels sont selon vous les principaux freins à la mise en place des réformes?
Comme je l’ai dit, c’est d’abord l’illusoire recherche d’une adhésion unanime parmi les catholiques. C’est aussi le «verrou romain», c’est-à-dire le fait que seule Rome, et même seul le pape peuvent théoriquement décider des changements structurellement importants. Mais en pratique, le pape lui-même est limité en cela par le souci de préserver l’unité de l’Église. Un exercice fort compliqué lorsque l’on sait que toute une frange des catholiques est hostile aux changements.
«L’Église doit décider ce qui fait son ADN, sa raison d’exister, et définir ses priorités en conséquence»
Au niveau suisse, les évêques sont bien sûrs conscients de cette limite institutionnelle et ils veulent respecter les règles hiérarchiques. Donc on assiste à une sorte d’exercice d’équilibriste pour savoir jusqu’où on peut aller dans les réformes locales.
La peur joue enfin certainement un rôle. En ce qui concerne l’absence d’une enquête en population générale, l’exemple de la Ciase, qui a produit une estimation de 300’000 personnes abusées mineures dans un contexte ecclésial, a créé un choc, mais a aussi suscité des rejets voire des critiques à l’égard des évêques français qui en étaient les commanditaires indirects. Je ne suis pas sûr que les évêques suisses veuillent se retrouver avec des chiffres aussi impressionnants, qui effriteraient encore plus l’image de l’Église, leur propre autorité, en interne comme en externe.
Avez-vous de l’espoir que l’Église parvienne tout de même à devenir un lieu sûr?
C’est une question qui dépasse mes prérogatives en tant que scientifique. Mais dans cette affaire, il me semble que l’Église est finalement face au choix suivant. Elle doit décider ce qui fait son ADN, sa raison d’exister, et définir ses priorités en conséquence. Veut-elle préserver sa forme, sa structure et sa culture cléricale, qui la distinguent des autres Églises chrétiennes certes, qui font historiquement sa signature et son exceptionnalité, mais qui aujourd’hui apparaissent comme une «pierre d’achoppement» à sa crédibilité? Ou choisira-t-elle de relativiser cette forme et de privilégier le fond, les principes évangéliques qui sont au cœur de son message, qui notamment enjoignent à protéger les plus faibles, au risque de décevoir ceux qui, en son sein, sont attachés à sa forme, la jugeant essentielle à son identité, plus que l’Évangile? C’est le dilemme du messager qui finit par se prendre pour le message, en somme. (cath.ch/rz)
Un an après
Un an après la sortie du rapport préliminaire sur les abus sexuels dans l’Eglise en Suisse, où en sont les promesses de réformes annoncées? Depuis un an, au moins 270 cas supplémentaires d'abus ont été signalés, presque tous anciens.
Après la libération de la parole, le jugement et l'analyse, comment la réparation et le pardon peuvent-ils être mis en oeuvre?