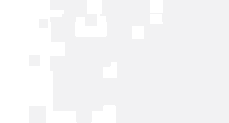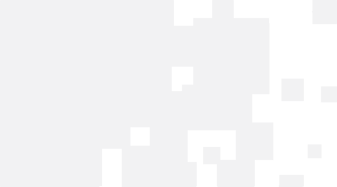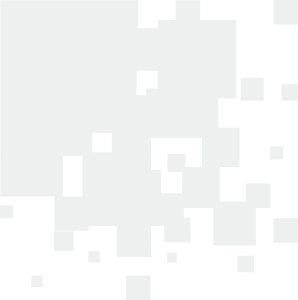Haut-Karabakh: la menace d'une crise humanitaire majeure
Alors que le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a repris depuis le 27 septembre 2020, la situation humanitaire se dégrade dans la région du Haut-Karabakh, au cœur des combats. La question des causes profondes de la guerre se pose en outre avec plus d’acuité.
«A Erevan, de nombreux civils, surtout des femmes et des enfants, sont en quête d’abri, de nourriture et de vêtements», indique à cath.ch Tatevik Baghdasarian, directrice de la Fondation Komitas Action Suisse–Arménie (KASA), dans la capitale arménienne. Alors que le froid commence à se faire durement sentir dans cette ville située à près de mille mètres d’altitude, elle avertit que les besoins sont toujours croissants. Selon Artak Belgarian, médiateur des droits civils en temps de guerre de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, la moitié de la population de la province a déjà fui vers l’Arménie, dont 90% de femmes et d’enfants.
Les Arméniens plus unis que jamais
Une situation qui devrait encore s’aggraver avec les bombardements intenses qui se sont produits depuis le 6 octobre 2020 sur Stepanakert, la principale ville de cette enclave montagneuse contrôlée par les Arméniens. «On s’achemine clairement vers une crise humanitaire», confirme Daniel Papazian, membre actif de la communauté arménienne à Genève, qui maintient de nombreux contacts sur place. Le récent bombardement de l’hôpital de Stepanakert affaiblit encore un système de soins en grave manque de moyens.
Les populations qui fuient les combats au Haut-Karabakh sont accueillies dans les grandes villes de l’Arménie, principalement Erevan. «Il y a beaucoup de solidarité, je n’avais encore jamais vu ça», confie Tatevik Baghdasarian. Les habitants de la capitale se mobilisent pour héberger les arrivants, leur acheter de la nourriture et des vêtements. La directrice du Centre KASA s’inquiète surtout pour les personnes restées à Stepanakert, terrées dans des abris précaires, sans chauffage ni sanitaires. «Mais le peuple arménien n’a jamais été aussi uni et tout le monde s’efforce de continuer à vivre».

La responsable d’ONG assure que la population n’a pas tellement peur, car elle a l’habitude de la guerre. Le maximum est fait pour distraire et rassurer les enfants. Même s’ils savent que c’est une guerre «pour la survie», elle affirme que les Arméniens ont confiance dans leur armée et leur gouvernement.
Un rapport de force en faveur de l’Azerbaïdjan
Les violences dans le Haut-Karabak (aussi appelé Nagorny-Karabakh et Artsakh par les Arméniens) ont repris fin septembre 2020, dans le cadre d’un conflit larvé vieux de trente ans entre l’Arménie, qui contrôle de facto le territoire, et l’Azerbaïdjan, qui le revendique. Si les deux côtés rapportent quelques centaines de morts, les victimes seraient en nombre beaucoup plus élevé. Sans doute de 2’000 à 3’000 dans chaque camp, affirme Daniel Papazian. Alors que le rapport de forces est de un à dix en faveur de l’Azerbaïdjan, il semble cependant que la ligne de front n’ait pas bougé significativement après 10 jours de combat.
«Il est difficile de dire qui peut l’emporter», note le Genevois. Les Arméniens «ne vont rien lâcher» pour conserver une zone montagneuse plutôt facile à défendre. Les Azerbaïdjanais ont pour eux un équipement militaire en plus grand nombre et plus sophistiqué. Leur motivation est cependant questionnable, souligne Daniel Papazian. Le fait que Bakou ait fait appel à des mercenaires syriens –des djihadistes convoyés par la Turquie – est, selon lui, le signe que l’engagement des Azerbaïdjanais dans ce conflit fait défaut.
L’argent, le moteur de la guerre
Quoiqu’il en soit, il doute que les violences puissent cesser rapidement, eu égard à ses enjeux de base: les Arméniens ne voudront jamais céder un territoire qu’ils considèrent comme leur appartenant de droit, alors que le régime azerbaïdjanais ne peut pas se contenter d’un cessez-le-feu qui lui ferait «perdre la face».
Il est probable que bien du sang soit malheureusement encore versé, déplore Daniel Papazian. «Derrière cette tragédie annoncée, le mot-clé est l’argent», révèle-t-il. Le clan Aliev, qui dirige l’Azerbaïdjan d’une main de fer, utilise ce conflit pour se maintenir au pouvoir, assure l’Arménien d’origine résidant à Genève. La chute des prix du pétrole, dont l’Azerbaïdjan est un gros exportateur, ainsi que la montée des revendications pro-démocratie à l’intérieur du pays, fragilisent le régime. Les hostilités constituent ainsi une occasion pour le clan Aliev de mobiliser la population derrière son pouvoir. Et une victoire redorerait sensiblement son blason terni par de nombreuses difficultés intérieures et la corruption massive.

La multiplicité des intérêts et des acteurs complique également une éventuelle solution. L’implication d’Ankara aux côtés de Bakou est désormais avérée. Des conseillers militaires turcs épaulent notamment les Azerbaïdjanais. Même si le conflit n’est, selon Daniel Papazian, pas fondamentalement religieux, l’Arménie chrétienne constitue une sorte d’obstacle dans les ambitions d’une «Grande Turquie» caressées par Recep Tayyip Erdogan. Le président, qui se comporte comme un «sultan» ottoman, pourrait vouloir créer un «corridor» susceptible de relier les peuples turcophones d’Asie.
Pas une guerre de religion
Pour Tatevik Baghdasarian, cette identité chrétienne arménienne est particulièrement importante en ces temps de menace. «Elle nous a aidé à surmonter plusieurs moments critiques dans notre histoire», souligne-t-elle. La directrice du Centre KASA d’Erevan affirme que ces valeurs chrétiennes dirigent les combattants du Karabakh. «Contrairement à ce que prétend l’Azerbaïdjan, nos soldats ne prennent jamais pour cible des civils». Bakou a en effet à plusieurs reprises affirmé que des zones d’habitation en Azerbaïdjan ont été bombardées par les Arméniens, notamment la ville de Ganja. «Mais c’est l’aéroport militaire de Ganja, d’où partent les avions qui bombardent Stepanakert qui était visé, non la population», assure Tatevik Baghdasarian.
Un point confirmé par Daniel Papazian, qui précise que les Azerbaïdjanais ont pour stratégie de placer des structures militaires au sein des localités. «Les forces du Karabakh ont de plus prévenu à l’avance les populations autour des cibles militaires afin qu’elles puissent partir avant les attaques». Dans l’autre sens, les Azerbaïdjanais attaquent délibérément les zones civiles, en témoignent les violents bombardements de Stepanakert des derniers jours. «Leur stratégie est celle de la démoralisation de la population, explique Daniel Papazian. Il y a le dessein de faire fuir un maximum d’Arméniens du Haut-Karabakh, afin de changer, le temps venu, l’équilibre de population dans la région».
L’ombre du génocide
Le Genevois admet que, par le passé, des combattants arméniens ont commis des exactions contre les Azéris. Notamment dans les premiers combats de 1988. «Comme souvent dans les conflits, des actes répréhensibles ont été perpétrés des deux côtés». Si Daniel Papazian déplore les massacres et les déplacements de populations commis par les Arméniens, il relève qu’ils l’ont été dans un contexte de «représailles spontanées». Alors que les pogroms anti-arméniens qui se sont produits notamment en Azerbaïdjan, notamment à Soumgaït (1988) et Bakou (1990), étaient selon lui complètement organisés et planifiés, et «dans des proportions incomparables» à ce qu’ont pu faire les Arméniens.
Pour Tatevik Baghdasarian, tous les Arméniens attendent que la guerre se termine au plus vite. Tout en assurant qu’ils ne peuvent pas eux-mêmes l’arrêter. «Sinon nous craignons de faire l’objet d’un nouveau génocide». (cath.ch/rz)
L’héritage empoisonné de Staline
Les Arméniens sont convaincus que leur cause est juste. Certes, selon le droit international, l’Artsakh se situe en territoire azerbaïdjanais. Mais, pour Daniel Papazian, il s’agit d’une absurdité juridico-diplomatique. Il rappelle tout d’abord que les frontières des Républiques soviétiques de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont été tracées dans les années 1920 par un Joseph Staline soucieux de «diviser pour mieux régner». Afin d’éviter que les peuples soient unifiés, donc plus forts et susceptibles de faire sécession, sa stratégie consistait à placer des communautés sous la domination d’autres groupes ethniques. Les habitants du Haut-Karabakh, un territoire peuplé depuis l’Antiquité en majorité par des Arméniens, fut ainsi mis sous administration de l’Azerbaïdjan.
Echec des négociations
Alors que l’URSS était sur le point de disparaître, en septembre 1991, le Parlement de l’Oblast (unité administrative) du Nagorny-Karabakh déclara son autonomie. Et dans un référendum qui suivit, 98% des habitants optèrent pour le rattachement à l’Arménie. Une démarche tout à fait légitime selon la Constitution de l’Union soviétique qui prévalait à ce moment-là.
L’Azerbaïdjan refusa cependant la décision et la guerre qui s’ensuivit (1991-1994) causa la mort de plus de 30’000 personnes. Sous l’égide du Groupe dit «de Minsk» (comprenant les États-Unis, la France, la Russie, l’Allemagne, la Biélorussie, la Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Turquie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan), un cessez-le feu a été déclaré en 1994. La province autonome n’a cependant été reconnue par aucun pays. Une politique de reconnaissance «à géométrie variable» pour Daniel Papazian, qui rappelle que la communauté internationale n’a pas toujours eu le respect absolu des frontières tracées lors de l’ère communiste. Il cite l’exemple du Kosovo, qui a obtenu la reconnaissance de nombreux pays après sa scission de la Serbie, elle-même issue de l’éclatement de la Yougoslavie. Même chose pour la division de la Tchécoslovaquie.
Mais les négociations en vue d’une solution pour le Nagorny-Karabakh, entreprises par le Groupe de Minsk, ont toujours échoué. Pour Daniel Papazian, la faute en revient à l’Azerbaïdjan et à la Turquie qui ont notamment toujours refusé que les principales intéressées, les autorités du Haut-Karabakh, soient incluses dans les discussions. RZ