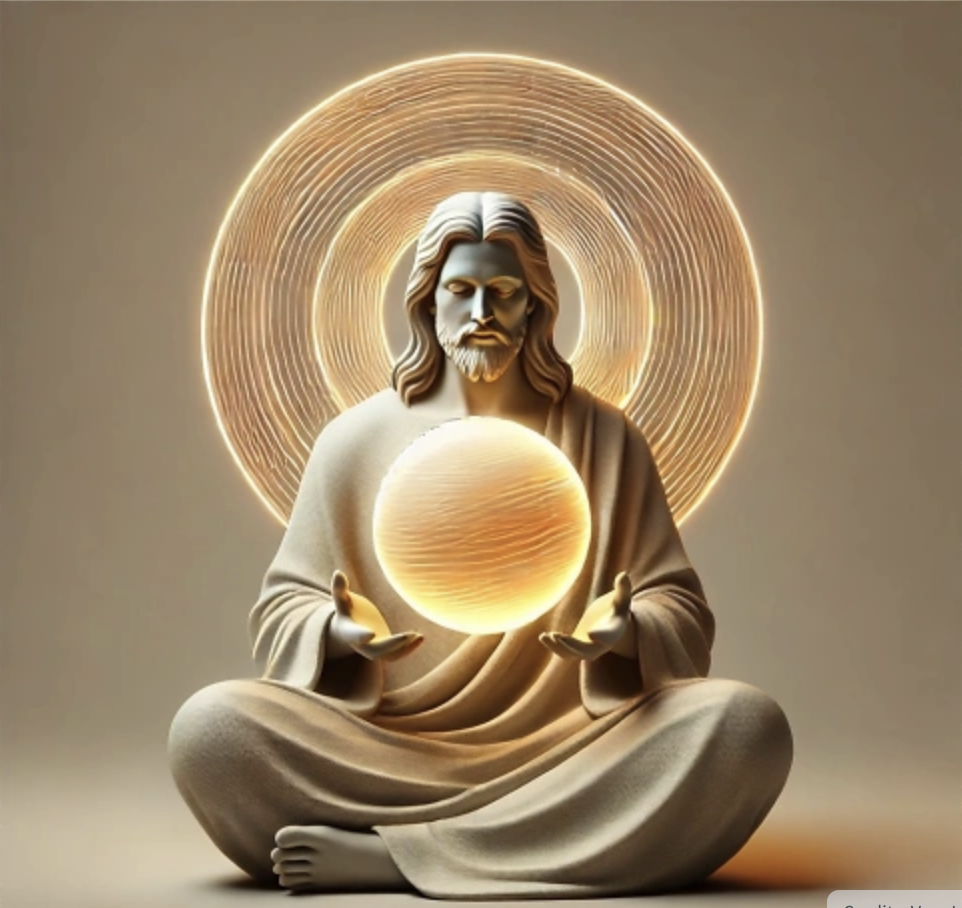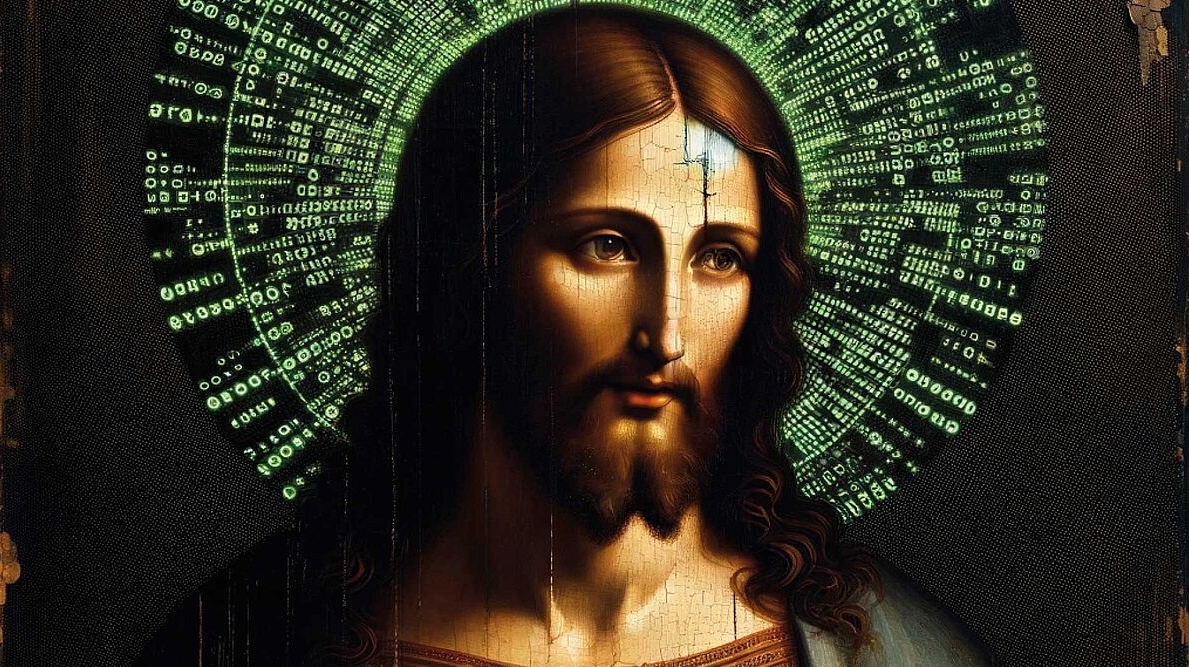Lucerne: L’Action de Carême critique l’attitude des banques suisses face à l’apartheid
En faisant le commerce de l’or sud-africain, elles ont prolongé un régime oppresseur
Lucerne, 20 septembre 2011 (Apic) L’apartheid en Afrique du Sud, «une affaire qui occupe l’Action de Carême (AdC) depuis une bonne trentaine d’années…» Antonio Hautle, directeur de l’œuvre d’entraide catholique suisse, ne mâche pas ses mots: c’est un «chapitre sombre» de l’histoire de la Suisse. Dans ses dernières années, le régime d’apartheid, complètement isolé par les sanctions de l’ONU, n’a pu se maintenir que grâce à ses ventes d’or passant par les banques suisses. Il a également reconnu que l’AdC a été hésitante sur la question de l’apartheid jusque dans les années 80.
Sans cette aide des banques suisses qui n’appliquaient pas les sanctions, le régime d’apartheid, qui a pris officiellement fin en 1994 (*), serait tombé bien plus vite. «La Suisse a beaucoup investi en Afrique du Sud, lui donnant ainsi la possibilité de survivre plus longtemps. De nombreuses vies auraient pu être épargnées», a déclaré Antonio Hautle à l’agence Apic. Le directeur de l’AdC présentait lundi 19 septembre à Lucerne les résultats de l’étude «L’Eglise catholique en Suisse et son attitude face à l’apartheid en Afrique du Sud (1970-1990)».
Il a relevé que d’influents milieux économiques, notamment des entreprises industrielles, et des instituts financiers et des banques suisses, qui ne s’étaient pas ralliés aux sanctions de l’ONU, ont en effet permis au système d’apartheid de se prolonger.
Peur d’une prise de pouvoir par les communistes
Grâce à l’intensification des liens financiers avec l’Afrique du Sud à l’époque, Zurich était devenue la première place financière de l’or, au détriment de Londres. «Pendant longtemps, l’Action de Carême a été divisée concernant la question de l’apartheid, craignant que la fin du régime de la minorité blanche signifie la prise de pouvoir les communistes. Mais dès la moitié des années 80, ses prises de positions ont été claires», lance-t-il.
Au début, le régime raciste de la minorité blanche en Afrique du Sud n’était dénoncé dans l’Eglise que par des groupes de la base, des partisans de la théologie de la libération. Dans l’atmosphère de guerre froide qui régnait encore dans le monde occidental, les évêques suisses avaient peur que si ce système tombait, les communistes prendraient le pouvoir en Afrique du Sud. Les évêques catholiques d’Afrique du Sud étaient également très réservés concernant les appels au boycott de leur pays. En 1985, la commission nationale «Justice et Paix» de la Conférence des évêques suisses (CES) déclare que le racisme – et par conséquent l’apartheid – représente un «péché contre Dieu».
Mgr Mamie, un bon connaisseur de l’Afrique, s’opposait à l’apartheid
Si la CES reste au début très prudente, «au sein de la Conférence des évêques, Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, un bon connaisseur de l’Afrique, et son auxiliaire, Mgr Gabriel Bullet, avaient une position sans ambiguïté sur l’apartheid, qu’ils condamnaient», relève Antonio Hautle. Qui souligne que des politiciens démocrates-chrétiens (PDC) liés aux banques étaient très influents auprès des évêques suisses, ce qui explique en partie aussi leurs réticences face au boycott du régime d’apartheid, que demandaient les groupes catholiques de la base.
«Les évêques suisses avaient des réserves contre les milieux prônant la théologie de la libération, sans compter que la CES avait moins de personnel, alors que la Fédération des Eglises protestantes (FEPS), plus en pointe sur cette question, disposait d’un Institut d’éthique sociale». L’historien Bruno Soliva, auteur de l’étude sur l’attitude de l’Eglise catholique face à l’apartheid, a pu avoir accès entre autres aux archives de la CES, de l’Action de Carême, de la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC), du groupe de travail Kairos, mais tant la Confédération que les banques ont refusé d’ouvrir leurs archives.
«Il y a des milieux qui contestent notre position sur le rôle des entreprises suisses dans le maintien de l’apartheid, mais s’ils veulent prouver le contraire, il faudrait pouvoir ouvrir les archives des banques et de la Confédération!», conclut Antonio Hautle.
Encadré
Alors que l’apartheid est officiellement terminé depuis 17 ans, le fossé entre riches et pauvres en Afrique du Sud est aussi profond qu’au Brésil, relève pour sa part Claudia Fuhrer, chargée du programme d’AdC pour cette région de l’Afrique. Dans ce pays de près de 49 millions d’habitants, peuplé à 79% de Noirs, 9,6% de Blancs, 8,9% de métis et 2,5% d’Asiatiques, l’espérance de vie ne dépasse pas 42 ans pour les femmes et 43 ans pour les hommes.
Certes, a relevé Claudia Fuhrer, le pays peut disposer de la Constitution la plus progressiste de toute l’Afrique, mais dans les faits, il a des difficultés à protéger et à mettre en pratique les droits de la population pauvre. Cela concerne notamment le droit de se nourrir, de se loger ou de bénéficier de la sécurité sociale. Quelque 40% de la population est sans travail et 22 millions de personnes sont assistées. La pauvreté touche avant tout les populations des campagnes, surtout les femmes et les enfants.
Les augmentations massives des prix des denrées alimentaires, de l’électricité et des transports causées par la crise économique et énergétique aggravent la situation des plus pauvres. Par conséquent les troubles sociaux et la criminalité sont en forte augmentation, de même que l’hostilité grandissante contre les migrants des pays voisins. Avec 18% de personnes infectées, l’Afrique du Sud a le plus haut taux de sida du continent.
L’Action de Carême est active dans ce pays depuis les années 70. Jusque dans les années 1990, elle n’a financé que des projets d’Eglise, avant de s’engager de plus en plus pour des projets de développement. Entre 1984 et 1994, l’œuvre d’entraide suisse s’est impliquée davantage dans la construction d’une société civile luttant contre les structures injustes de l’apartheid. Dans son programme 2011-2016, AdC s’est donné pour but de travailler à améliorer la situation alimentaire de la population, avec des méthodes de culture écologique, pour favoriser un développement durable dans les régions les plus pauvres et les plus délaissées du pays, au Nord et à l’Est de la province du Cap.
( *) Après 4 années de négociations, les premières élections multiraciales se déroulent en avril 1994, débouchant sur l’élection de Nelson Mandela, premier président noir de la République d’Afrique du Sud. (apic/be)