Des pistes pour améliorer le discours de l’Église sur les étrangers
Les élections européennes de juin 2024 ont été marquées par une percée de l’extrême droite. Élément cristallisant de cette fracture politique, la question migratoire, qui fait même vaciller l’unité de la communauté catholique. «Bisounours» et «xénophobes» se regardent en chiens de faïence. Pour renouer le dialogue entre eux, Jacques-Benoît Rauscher op invite à réexaminer la Doctrine sociale de l’Église.
Comme tous les 20 juin depuis 2001, la Journée mondiale des réfugiés, instituée par les Nations Unies, est célébrée cette année. Deux semaines avant, en France, plus de 40% des catholiques pratiquants ont voté pour le Rassemblement national (RN) et pour Reconquête, selon un sondage ifop pour La Croix.
Pour le Frère dominicain français Jacques-Benoît Rauscher,* sociologue et auteur de Les frontières d’un discours. Les papes et l’accueil de l’étranger (Cerf 2024), la tension actuelle est une opportunité de renouveler la Doctrine sociale de l’Église sur la migration.
Les appels de François en faveur d’un accueil généreux des migrants sont inaudibles, voire urticants, pour une partie des catholiques d’Europe. Qu’indique cette tension?
Jacques-Benoît Rauscher: Il faut déjà en prendre acte. Il y a un décrochage entre les propos clairs du pape et la position de certains catholiques. J’insiste sur le «certains», parce qu’il y en a qui y sont très favorables. Il faut être attentif à ne pas stigmatiser et culpabiliser les gens qui sont dans une dynamique de fermeture. Parfois on entend dire: «Ce sont de mauvais croyants, ils n’ont pas bien lu l’Évangile.» Il faut plutôt chercher à comprendre ce qu’il y a derrière leur vote et les écouter. Cela a été le point de départ de ma recherche. Qu’est-ce qui, dans la tradition de l’Église, peut les conforter dans leur propos, jusqu’à un certain point néanmoins?
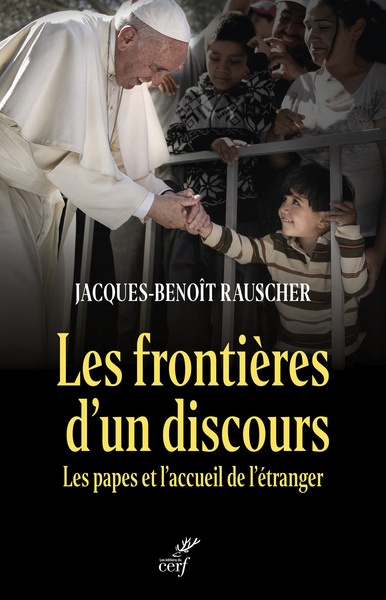
Vous montrez dans votre livre l’évolution des discours papaux sur les étrangers au cours des trois derniers siècles. Comment ils sont passés d’une préoccupation pastorale centrée sur les catholiques, avec Léon XIII, à un discours plus politisé après la Seconde Guerre mondiale, puis au discours de François d’ordre plus prophétique. Cette évolution suit-elle celle des visages de la migration?
En effet, mais elle suit aussi la compréhension que l’Église se fait de la place qu’elle joue dans la société. A la fin du 19e siècle, on pense que le pape est là pour parler d’abord à ses ouailles. Si l’Église est une des premières institutions internationales à s’intéresser à la migration, c’est parce que les Irlandais et les Italiens qui migrent vers le continent américain sont massivement chrétiens, catholiques notamment.
La deuxième phase correspond au concile Vatican II. L’Église se proclame associée aux préoccupations de ses contemporains. Les papes ne parlent plus aux seuls chrétiens, mais au monde entier. Et ils s’allient pour ce faire aux organisations internationales, notamment les Nations Unies, avec qui ils sont en parfaite symphonie concernant la question migratoire et des réfugiés. Les papes se réfèrent, du reste, au droit international.
Mais le rôle et l’autorité de ces organisations internationale se sont considérablement affaiblis. L’Église ne dispose plus de ce vecteur de transmission, alors même qu’elle continue à adresser son discours sur l’accueil de l’étranger au monde entier. Dans la troisième phase, qui correspond plus ou moins au 21e siècle, l’Église adopte ainsi un discours d’ordre plutôt spirituel.
Avec le risque de tomber dans une idéalité non praticable?
C’est un danger. On a besoin d’idéal, mais on a aussi besoin d’entendre que tout le monde ne peut pas vivre tout le temps cet idéal. Présenter un discours universel sur la migration est d’autant plus compliqué que la question migratoire s’est complexifiée. Les migrations se sont accrues en volume, leurs origines sont de plus en plus diverses et la cause climatique prend de l’ampleur. En conséquence, l’Église a un discours de moins en moins pratique, de plus en plus basé sur des grandes considérations. Cela peut inspirer à l’action, mais cela culpabilise aussi les gens qui ne rentrent pas dans cet idéal … et n’honore pas le registre à proprement parlé politique.
«On a besoin d’idéal, mais on a aussi besoin d’entendre que tout le monde ne peut pas vivre tout le temps cet idéal.»
Le pape François pourtant se réfère souvent au discernement personnel et invite l’Église à accompagner chacun là où il se trouve. Parallèlement, il indique clairement que l’Église n’est pas séparée du monde et des responsabilités politiques. C’est le premier pape, par exemple, à s’être rendu au sommet au G7. Peut-on vraiment lui reprocher de ne pas être ancré dans la réalité?
C’est un vrai paradoxe que vous évoquez. François a énormément insisté sur le discernement dans le cadre de la morale familiale et sexuelle, notamment dans son exhortation Amoris laetitia. Il indique qu’il y a toujours un idéal, à prendre comme une norme, mais il considère aussi le chemin que les personnes peuvent faire pour l’atteindre.
Je suis surpris qu’il ne propose pas cette même approche pour les questions politiques et sociales. Son discours et celui de ses prédécesseurs encouragent le chrétien soit à distribuer de la soupe à des migrants soit à décrire ces derniers comme signe de l’humanité à venir. On est dans le très concret ou le très spirituel. Cela ne fournit pas suffisamment de critères de discernement aux votants ou aux décideurs politiques.
Je ne pense pas forcément au président de la République mais, par exemple, au maire d’une commune du nord de la France qui reçoit beaucoup de migrants qui cherchent à rejoindre l’Angleterre. Comment l’Église peut-elle l’aider à prendre des mesures concrètes pour répondre à la fois aux besoins des migrants et aux inquiétudes de ses administrés?
Est-ce le rôle de l’Église de donner des directives pratiques?
Il ne s’agit pas de proposer un programme politique applicable tel quel. Il y a de l’espace entre énoncer des principes généraux et donner des directives. Le discours social de l’Église s’adresse toujours aux membres d’une collectivité, où chacun évolue à un stade différent, une réalité dont les décideurs doivent tenir compte.
«Il ne s’agit pas de proposer un programme politique applicable tel quel. Il y a de l’espace entre énoncer des principes généraux et donner des directives.»
Si l’Église se contente de désigner l’idéal, elle devient comme un guide de montagne qui montre le sommet à son groupe et le laisse se débrouiller pour l’atteindre, sans nuancer entre les plus aguerris et les autres.
Vous avez participé à l’accueil de demandeurs d’asile à Calais, puis à Strasbourg. Qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans cette expérience concrète?
Le décalage entre les réalités des pays non démocratiques, pauvres, et les nôtres. On le sait théoriquement, mais quand on rencontre des gens qui viennent de pays où ils ont été torturés, où ils ne pouvaient pas manger au quotidien, on relativise sérieusement «l’impossibilité» de leur venir en aide. Cela donne une autre dimension à nos discours sur l’accueil de l’étranger.
Vous vous référez dans votre livre à des distinctions morales établies par saint Thomas d’Aquin qui pourraient être revisitées par la Doctrine sociale de l’Église afin de lui permettre d’être mieux entendue. Pourriez-vous en donner un exemple?
On interroge trop peu aujourd’hui la notion du «nécessaire», alors que Thomas d’Aquin le faisait. On entend souvent dire que nos pays d’Europe ne peuvent accueillir plus de migrants, car nous n’en aurions pas les moyens. Prendre du recul, c’est se remémorer que nos pays sont parmi les plus riches du monde. Est-ce que ce serait vraiment catastrophique si nous nous privions un peu? De quels biens matériels avons-nous besoin pour mener une bonne vie en société?
Vous montrez aussi que les discours des papes sur l’étranger sont sous-tendus soit par la question de la propriété privée, comprise comme droit naturel, soit par celle de la destination universelle des biens. Quelle équation proposez-vous?
Qu’est-ce que ça veut dire posséder une terre? L’Église a oscillé dans la réponse à cette question: en posant le principe de la propriété comme droit naturel … ou en relativisant ce principe au nom, toujours, du droit naturel. Dans un cas comme dans l’autre, on est dans le registre du permis/défendu au nom d’un principe supérieur. Une tentation de l’Église contemporaine est d’enfermer les débats dans ce type d’alternatives pour être audible.
Une réponse claire, c’est un peu ce que réclament néanmoins beaucoup de chrétiens…
Cela ne s’exclut pas forcément. Il y a des principes absolus sur lesquels on ne transige pas, par exemple celui de l’urgence dans le domaine des migrations. Quand la vie est menacée, le chrétien n’a pas à réfléchir: il ne peut tout simplement pas renvoyer la personne en lui disant «on n’a plus la place pour t’accueillir».

Mais à part ces situations extrêmes, toutes les déclarations ne sont pas absolues, comme l’Évangile le montre. Des questions concrètes sont posées à Jésus: «dis à mon frère de partager avec moi l’héritage que notre père nous a laissé» (Lc, 12,13) ou «que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle?» (Mt 19,16). Jésus refuse systématiquement d’y répondre. C’est très marquant. Il aime parler en paraboles pour orienter ses interlocuteurs, et il laisse les personnes trouver les réponses au fond d’elles-mêmes. Il ne faudrait pas que l’Église, sous prétexte d’être entendue par ses fidèles, adopte une manière de parler différente de celle de Jésus.
L’Église accorde une importance fondamentale à la famille. En même temps, sa Doctrine sociale repose sur la notion de bien commun comprise dans une acceptation plus large. Est-ce immoral de vouloir défendre les intérêts de sa famille d’abord, puis ceux de sa communauté religieuse ou de sa nation, avant de penser au reste de l’humanité?
Chrétien ou non, on n’appartient pas de façon abstraite à l’humanité, mais toujours à travers une culture particulière. Le chrétien se tient sur deux jambes: une ouverture toujours plus large à l’universel et un ancrage dans un lieu singulier. Jésus est appelé Jésus de Nazareth, mais il passe sa vie à parcourir la Galilée, à la rencontre de peuples différents.
Cependant, proclamer une charité qui serait trop universelle serait prendre le risque qu’elle ne soit plus exercée concrètement auprès de gens que l’on côtoie. Ce n’est pas anormal de se préoccuper d’abord de sa famille, de son peuple… Mais je pense que poser la question en termes d’opposition entre protéger sa famille ou servir l’humanité biaise la manière d’y répondre. Il conviendrait plutôt de se demander: comment est-ce que je sers le bien? Est-ce que ma famille tend vers le bien si elle accueille ou est-ce que cela va l’empêcher à tendre vers ce bien car elle est en proie, par exemple, à des difficultés ponctuelles?
La figure de l’étranger dans les deux Testaments est reliée à celle de Dieu. Jésus dit notamment: «J’étais un étranger et vous m’avez accueilli» (Mt 25,35). L’étranger est enfant de Dieu, à accueillir comme tel donc?
Oui, l’étranger est une figure de Dieu, mais cela peut inspirer et non dicter un comportement politique. Imaginer qu’on est déjà dans le Royaume de Dieu peut-être une tentation pour le chrétien. A la fin des temps, dit la Bible, toutes les nations, toutes les catégories de personnes et toutes les cultures seront rassemblées dans la Jérusalem céleste. Nous n’y sommes pas encore, juste en chemin. (cath.ch/lb)
*Le Frère Jacques-Benoît Rauscher est depuis février 2024 docteur en théologie de l’Université de Fribourg. Sa thèse porte sur «L’accueil de l’étranger, frontière de la Doctrine sociale de l’Église». Il est actuellement Régent d’études de la Province de France des dominicains.





















