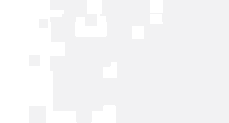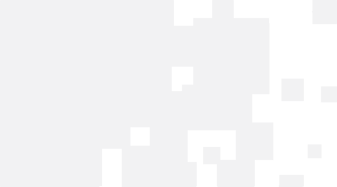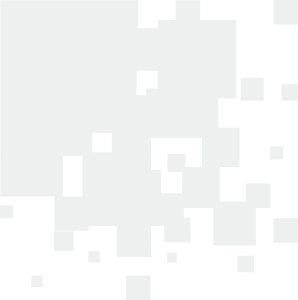Cardinal Filoni: «Le Saint-Siège n’abandonne pas les pays en conflit»
Le cardinal Fernando Filoni, 76 ans, était nonce apostolique en Irak au moment de la guerre de 2003. Demeuré à Bagdad malgré les bombardements massifs de la coalition menée par les États-Unis, le cardinal italien témoigne, à travers son expérience, du rôle spécifique joué par le Saint-Siège dans les relations internationales.
Propos recueillis par Hugues Lefèvre/I.Media
Le cardinal Filoni est resté en Irak en 2003 après l’éclatement de la guerre. Alors que le conflit s’éternise en Ukraine, il explique le rôle diplomatique du Saint-Siège dans les cas très délicats de conflits armés, où «l’Église n’est pas comme un État qui pourrait évacuer ses ressortissants et ensuite désigner un pays comme un adversaire».
Le Saint-Siège dispose d’un des plus importants réseaux diplomatiques au monde malgré des moyens limités. Mais en temps de guerre, sa diplomatie «désarmée» peut-elle être «désarmante»? La fragilité du Saint-Siège fait-elle sa force?
Card. Fernando Filoni: La force du Saint-Siège réside en effet dans le fait de ne pas défendre d’intérêt politico-militaire. Même si vous faites la guerre, moi je reste ici, je ne m’en vais pas. L’Église ne s’en va pas, elle reste au milieu des gens. Elle peut avoir des victimes en son sein, comme en Afrique, mais elle ne s’en va pas. Elle ne suit pas la logique des armes, mais la logique du dialogue, de la justice, du respect des autres, car pour résoudre les problèmes il faut un dialogue.
Concernant la guerre en Ukraine, voyez-vous des similitudes entre votre action à Bagdad et celle du nonce à Kiev actuellement?
La présence active du nonce à Kiev, sur le plan de l’encouragement à la paix, me paraît fondamentale. En Irak, nous avions reçu beaucoup d’aide, et les organismes du Saint-Siège sont aussi actifs pour l’Ukraine. Il faut d’abord aider les gens, ceux qui souffrent directement de la guerre. Et ensuite tous les dialogues sont possibles. La présence du nonce montre que le Saint-Siège n’abandonne jamais les pays en conflit.
«L’Église n’est pas comme un État qui pourrait évacuer ses ressortissants et ensuite désigner un pays comme un adversaire.»
Avez-vous l’espoir de voir des canaux plus réguliers s’établir avec la Russie?
Il y a différents niveaux de dialogue, d’abord sur un plan culturel et anthropologique, puis sur le plan ecclésial, car l’Église catholique a une présence en Russie, même si elle est minime. C’est une situation complexe. Nous ne pouvons pas nous trouver dans la situation d’un parent qui renierait l’un de ses deux fils après qu’il ait fait un mauvais choix dans une dispute.
L’Église n’est pas comme un État qui pourrait évacuer ses ressortissants et ensuite désigner un pays comme un adversaire. Il y a des catholiques en Russie, en Ukraine et partout. Le Saint-Siège doit tenir compte de cette réalité complexe: le pape ne peut pas s’exprimer comme d’autres gouvernements.
Je suis convaincu que si le pape le pouvait, il irait à Kiev et à Moscou, si l’autre partie le permet. Mais en temps de guerre, la logique de l’Église doit être différente de celle des États, elle se situe sur un temps différent. Le pape Jean-Paul II avait été empêché de venir en Irak, à Ur, en l’an 2000. Mais François s’y est finalement rendu, 21 ans plus tard. Si lui-même ne fait pas ce voyage en Ukraine et en Russie, un autre pourrait le faire…
Quand vous étiez nonce en Irak, de 2001 à 2006, vous avez vécu ce moment de bascule d’un pays vers la guerre. Au moment de votre nomination, l’Irak était déjà un pays paria et isolé. Dans quel état d’esprit Jean-Paul II vous a-t-il envoyé?
Le Saint-Siège n’a jamais pris l’initiative d’une rupture des relations diplomatiques, avec aucun pays. Il l’a parfois subie, mais il n’en n’a jamais pris l’initiative. Même en Irak, malgré les problématiques que ce pays vivait à cette époque avec les tensions et les sanctions que les Nations Unies avaient instaurées après la première Guerre du Golfe, le Saint-Siège a toujours maintenu un nonce apostolique.
Quand le pape Jean-Paul II m’a nommé évêque puis nonce en Irak, j’étais invité à m’insérer dans la vie de l’Église locale, et aussi à maintenir une bonne relation avec les autorités civiles du pays.
«Le Saint-Siège n’a jamais pris l’initiative d’une rupture des relations diplomatiques, avec aucun pays.»
À cette époque, même Saddam Hussein appréciait le fait que, contrairement aux autres nations, nous n’avions pas d’intérêts à défendre, mais seulement le respect des personnes, des institutions. Et surtout l’aide à l’Église locale. On peut faire beaucoup de choses pour les communautés locales, dans la mesure où les autorités civiles et militaires le permettent: certaines les restreignent, d’autres les aident.
Le 11 septembre 2001, comment la population irakienne a-t-elle réagi aux attentats survenus aux États-Unis?
J’étais en Irak, et à ce moment-là les communications dans le pays n’étaient pas faciles. En interne, les informations étaient contrôlées par le régime. Mais nous, les ambassadeurs, nous avions des nouvelles par la voie satellitaire.
Le 11 septembre 2001, j’étais dans une paroisse irakienne, et j’ai dû rentrer à la maison pour comprendre ce qui se passait, mais seulement à partir de ces vagues informations dont je n’avais pas une perception claire. J’ai vécu ce moment avec un décalage par rapport à la grande consternation ressentie dans le monde occidental, mobilisé dans la recherche des responsables.
Saddam Hussein fut suspecté d’être un des possibles commanditaires. En vérité, je me souviens très bien qu’il n’avait rien à voir avec cela. Mais la suspicion, l’accusation est toujours restée. Elle a été portée pour justifier la guerre, avec la possession d’armes bactériologiques, chimiques et nucléaires, qui ne fut jamais prouvée. Même le Premier ministre britannique Tony Blair a reconnu par la suite que ces accusations étaient fausses.
Aviez-vous des échanges avec les Britanniques et les Américains pour les avertir ou les questionner sur la véracité de ces accusations?
Nous n’étions pas directement impliqués, mais en tant que nonciature nous suivions ces évènements. La guerre que l’on percevait comme proche suscitait beaucoup de préoccupations aussi de la part de Saddam Hussein et de son gouvernement, et la proximité de la guerre devenait une évidence.
Quelques mois auparavant, Saddam Hussein avait envoyé un émissaire pour demander ce qui devait être fait pour éviter la guerre. Il était évident que tout l’arsenal militaire déployé par les Américains dans le Golfe n’était pas seulement là pour effrayer.
Il était très difficile d’empêcher cette guerre, et puisqu’il n’y avait pas de dialogue entre les protagonistes, la seule possibilité était de montrer que les accusations étaient infondées. Et j’ai porté cela à la connaissance des émissaires à Bagdad et en Jordanie.

Du côté irakien, on m’a demandé quels gestes je pouvais conseiller, et j’ai répondu que, politiquement parlant, je n’avais pas de compétence pour répondre à cette question. Mais j’ai dit que, face aux accusations de détention d’armes de destruction massive, le gouvernement pouvait faire une déclaration ou une loi renonçant à ce type d’armement.
Deux ou trois jours plus tard, Saddam Hussein a fait cette déclaration, en convoquant tous les chefs de tribus. La réaction en Occident fut qu’on «ne pouvait pas croire ce menteur». La guerre devenait donc inévitable.
Saddam Hussein ne pouvait pas accepter l’humiliation. Dans le monde arabe, le chef peut être mis de côté, mais il ne doit jamais être humilié. C’est une logique culturelle: ce n’est pas comme dans une démocratie où le chef peut quitter le pouvoir après une défaite aux élections.
Après le 19 mars 2003, comment avez-vous agi comme nonce dans un pays en guerre?
Je suis resté à Bagdad, en ayant donc la connaissance de ce qui se passait sur le terrain et j’en informais le Saint-Siège. Nous vivions comme tout le monde, nous n’avions pas de protections, de soi-disant refuges… Nous espérions qu’aucun des missiles dont nous entendions le sifflement ne nous tombe dessus.
«Des gens, chrétiens et musulmans, allaient parfois dormir dans les églises, les séminaires, où ils se sentaient en sécurité.»
Je visitais les paroisses avec des évêques chaldéens, mais les communications étaient difficiles car les bombardements avaient frappé les centrales téléphoniques. Nous allions voir si les communautés parvenaient à survivre. Aucune religieuse, aucun religieux, aucun prêtre n’a fui le pays à ce moment-là.
Les pasteurs ont partagé la réalité de leur peuple. Je visitais donc les paroisses, avec l’évêque auxiliaire, dans les zones frappées par les bombes. Des gens, chrétiens et musulmans, allaient parfois dormir dans les églises, les séminaires, où ils se sentaient en sécurité. L’Église menait donc aussi à travers cela une œuvre de soutien à la population.
Quelle était l’attitude des chrétiens vis-à-vis de Saddam Hussein? Était-il perçu comme un protecteur, dont ils seraient nostalgiques?
Saddam Hussein était très respectueux des autorités religieuses, il respectait beaucoup le patriarche chaldéen. Mais cela ne signifie pas qu’il était un «protecteur des chrétiens». Il restait un leader musulman, attentif à sa communauté sunnite, alors que la population chiite était plus difficile à contrôler. Mais il était aussi conscient qu’en Irak, qui était né comme pays en 1920 sur les décombres de l’Empire ottoman, il y avait tout un ensemble de religions, de tribus et d’ethnies différentes. Il y avait une présence très consistante des chrétiens au début du pays, puis elle a diminué au fur et à mesure car il y avait toujours des guerres, aussi à l’intérieur de l’Irak.
Les rapports entre les Kurdes au nord et les sunnites et les chiites, au sud, étaient toujours conflictuels. Les chrétiens des villages du nord, dont la présence remontait au temps de la première évangélisation, se trouvaient toujours en zone de conflit, entre deux feux: «Si tu es avec les Kurdes, tu es contre Saddam. Si tu es avec Saddam, tu es contre les Kurdes.» Dans ces conditions, les chrétiens se sentaient contraints de migrer vers le sud ou vers l’étranger.
«Saddam Hussein était très respectueux des autorités religieuses. Mais cela ne signifie pas qu’il était un «protecteur des chrétiens»»
Dans les années qui ont suivi l’invasion américaine, aviez-vous des contacts avec les Américains et les Britanniques?
Les soldats américains armés sont arrivés devant notre bâtiment et je leur ai demandé de déposer leurs armes en disant que cette maison était une ambassade, l’ambassade du pape, et que j’étais là s’ils voulaient venir parler. Mais je n’étais pas un interlocuteur direct des autorités américaines en Irak, qui devaient entrer en contact surtout avec les chefs chrétiens locaux.
L’Église en Irak est dominée par les chaldéens, qui représentent environ 70% des catholiques. Le patriarche chaldéen est donc en quelque sorte un leader pour l’ensemble des communautés chrétiennes. Après la chute de Saddam, le gouverneur américain a parfois demandé l’avis du patriarche chaldéen.
Mais ce sont deux mentalités très différentes, ils n’arrivaient pas à se comprendre. On ne peut pas «apporter la démocratie» dans un pays qui n’a pas de culture démocratique, qui ne peut pas assimiler ce concept. La démocratie est toujours difficile, y compris dans les pays démocratiques: elle se construit avec les lois, avec la culture, progressivement.
Et concernant l’offensive de 2003, on peut se souvenir que le pape s’est toujours opposé aux guerres «préventives». L’Histoire et l’opinion publique lui ont donné raison. (cath.ch/imedia/cv/hl/bh)

Fernando Filoni
Fernando Filoni est né le 15 avril 1946 à Manduria, dans la région des Pouilles en Italie. Il est entré au séminaire et a fait un doctorat en philosophie et en droit Canon en 1978. Il est ordonné prêtre pour le le 3 juillet 1970. Il rejoint les services de la diplomatie vaticane et le 17 janvier 2001. Il est nommé nonce apostolique en Irak et en Jordanie par le pape Jean Paul II.
Il occupe ce poste délicat au cours de la guerre d’Irak, restant, un temps, le dernier diplomate résidant à Bagdad. Le 25 février 2006 il est transféré à la nonciature aux Philippines.
À peine un an plus tard, le 9 juin 2007, Benoît XVI le rappelle à la Curie et fait de lui le substitut pour les affaires générales de la Secrétairerie d’État et le 30 octobre suivant, il est nommé comme consultant pour cinq ans de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le 27 novembre, il devient membre du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement.
Le 10 mai 2011, Benoît XVI le nomme préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples en remplacement du cardinal Ivan Dias qui se retire. Il est créé cardinal par Benoît XVI le 18 février 2012. Le 8 décembre 2019, François le nomme grand maître de l’ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. BH