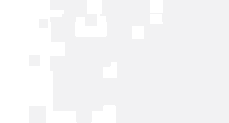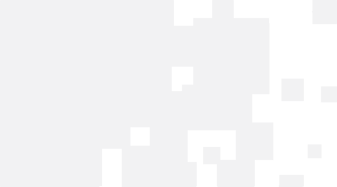L’Evangile est de retour sur les bords de l’Euphrate
APIC Reportage
Rencontre avec Naaman Rawik, «missionnaire du désert»
Jacques Berset, agence APIC
Raqqa/Lac Assad (Syrie) APIC Reportage, en Syrie, … après une éclipse de dix siècles due aux invasions mongoles. Grâce au programme de grands barrages des années 60, des chrétiens se réinstallent dans la région de Raqqa, à 200 km à l’est d’Alep. Au cœur de cette «réévangélisation» en terre musulmane, un missionnaire de 42 ans au visage cuivré par le vent du désert, le Père Naaman Rawik.
Au volant de son bus VW délabré, le Père Naaman nous guide au milieu d’étendues de sable et de steppes entrecoupées de terres cultivées grâce à un imposant système d’irrigation. Par endroits affleure la salinité du sol. Voici que des musulmans le saluent et le désignent à leurs enfants comme «le papa des chrétiens». «C’est plutôt gentil et respectueux», reconnaît-il. Depuis 18 ans, le jeune archimandrite grec-catholique est seul pour desservir un vaste territoire de 2’500 km2. Sur 600’000 personnes habitant en aval du Lac Assad, seul 11’000 sont chrétiens. «Qu’ai-je fait au Bon Dieu pour mériter cela ?», plaisante, mi-figue mi-raisin, le jeune missionnaire à la barbe poivre et sel et au front déjà dégarni. A l’évocation de son nom, il se remémore le personnage biblique de Naaman le Syrien, chef de l’armée du roi d’Aram, guéri de la lèpre dans le Jourdain. Grâce à sa foi au Dieu d’Israël.
La construction sur l’Euphrate du grand barrage de Thawra (Révolution), de 1966 à 1975, a indirectement permis la renaissance de l’Eglise. Elle a amené sur place une population bigarrée venant de tous les coins de Syrie, composée essentiellement de techniciens et d’ouvriers, attirés par les places de travail créées par l’irrigation et la bonification des terres. Chez les chrétiens, on rencontre beaucoup d’ouvriers, mais aussi des commerçants, des ingénieurs ou des médecins.
Les barrages sur le «Nahr Al Furat», l’Euphrate, artère nourricière des grande civilisations mésopotamiennes (Les missions archéologiques occidentales ont exploré Tell Hariri, à Mari et Doura-Europos, «Pompéi de l’Orient» près de la frontière irakienne) font revivre la région. Disparu depuis les 9ème et 10ème siècle de ces contrées islamisées, le christianisme est revenu. Il renaît en particulier dans les deux villes nouvelles de Raqqa et Tabqa, au pied de l’imposant barrage de Thawra, long de 2500 m. Derrière son mur épais de 512 m à la base, un lac de retenue d’une capacité de 11 milliards de m3! A une trentaine de kilomètres au sud du fleuve, nous arrivons à Résafé, une ancienne place forte romano-byzantine vidée de ses habitants il y a huit siècles par le Sultan Baybars.
Résafé, ancien évêché devenu «ville morte»
La soutane couleur sable du Père Naaman se fond dans les tons ocres de la «ville morte» de Résafé. Toute la population déportée à Hama, la ville longtemps prospère – elle fut élevé au rang d’évêché – retourna au silence du désert. Avant son abandon forcé, cet ancien lieu de pèlerinage était connu dans tout l’Orient sous le nom de Sergiopolis, en l’honneur du martyre de saint Serge. Officiers romains convertis au christianisme, Serge et Bacchus, son compagnon, furent mis à mort pour avoir refusé d’abjurer leur foi. Serge était l’un des saints les plus populaires parmi les Arabes chrétiens, et la ville recevait une foule de pèlerins.
Au milieu des dunes, se détachant de l’imposante ceinture de remparts restée debout malgré la morsure des sables, surgit la silhouette de l’imposante ruine de la basilique byzantine Saint-Serge. Les pierres de gypse diaphane de la cité endormie à jamais brillent au soleil. Après tout ce temps d’abandon, le premier prêtre à revenir dans la région fut le Père Abdallah Barnouty, un petit frère de Jésus. Pendant 15 ans, tout en travaillant comme traducteur pour les compagnies étrangères construisant le barrage de Thawra, il a posé les premiers fondements de la communauté chrétienne locale. «Après 10 siècles, c’est lui qui a ramené le christianisme ici», témoigne Naaman Rawik, qui a pris sa relève.
«Le code de droit canon, c’est mon cœur!»
Prêtre melkite catholique, Naaman Rawik est au service de l’ensemble de la diaspora chrétienne. Il baptise, confesse, marie et célèbre l’eucharistie pour les fidèles d’une dizaine de rites chrétiens différents. Fidèles grecs-catholiques, grecs-orthodoxes, arméniens-orthodoxes, arméniens-catholiques, assyriens, syriaques-orthodoxes, syriaques-catholiques, maronites, latins, chaldéens, sans compter deux ou trois familles protestantes, il accueille tout le monde à bras ouverts. A Raqqa, sa cure est un simple immeuble abritant l’église à l’étage, dans un quartier d’habitation aux rues poussiéreuses défoncées par les chantiers. Dans le salon trône un portrait du «raïs», le président syrien Hafez el-Assad. Sur la chaîne TV 5 allumée dans le salon défile le paysage verdoyant d’une campagne française.
Quelques femmes vêtues d’une tunique bleu ciel et coiffée d’un voile – «c’est le costume de Marie, que certaines portent en cette période en l’honneur de la Vierge» – se rendent à la prière. Avec elles des dames âgées au chef couvert d’une mantille noire brodée récitent des invocations mariales dans la chapelle de l’Annonciation, Saïdet al-Bishara. Des enfants sont là, quelques hommes, également des femmes vêtues à l’occidentale, parées de couleurs chatoyantes. Toute la diversité de cette communauté hétérogène mais fervente.
Notre «missionnaire de choc» passe indifféremment du français à l’arabe, en finissant par le syriaque (araméen). «Que mes fidèles soient orthodoxes ou catholiques, les sacrements que je dispense sont les mêmes pour tous: baptême, mariage, communion… Cela ne pose pas de problèmes, parce que je suis seul. Il n’y a pas de concurrence, les différents rites reconnaissent nos sacrements.»
«Si j’en restais au droit canon, je commettrais une grande faute, lance-t-il dans un grand éclat de rire; c’est l’amour qui doit nous guider… C’est connu des évêques, peut-être pas du Vatican. Moi, je parle avec mon cœur, c’est le droit et le canon!»
A Pâques cette année, le cheikh musulman de Raqqa, le plus haut dignitaire religieux de la ville, est venu à l’église présenter ce que dit le Coran de Jésus et de Marie. Les fidèles l’ont bien accueilli et trouvé que cette «première» était une bonne idée. «En effet, les musulmans ici n’ont d’ordinaire pas l’habitude de dialoguer avec les chrétiens. Le chef de la police nous a demandé de répéter cette action exemplaire, auquel cas il ferait venir la télévision».
Les musulmans rendent visite au curé
A entendre le curé de Raqqa, l’ambiance est plutôt œcuménique, et les relations interreligieuses sont bonnes. La façade de l’église, où s’inscrit une grande croix, marquée par des jets de pierre ? «Ce sont des enfants du quartier qui ont fait cela, rien à voir avec le fondamentalisme islamique!», rassure-t-il. Les voisins musulmans aiment bien les chrétiens: ils passent pour des gens sérieux et travailleurs. «Ici, en ville, personne ne nous insulte comme cela peut arriver parfois dans les villages…Je vis avec les gens, donnant un témoignage d’amour. Je me promène toujours en soutane, avec la croix, sans jamais rencontrer d’hostilité.»
D’ailleurs tous les jours, des musulmans rendent visite au Père Naaman, qui est pour eux le «chef des chrétiens» sur le plan local. Ils viennent notamment solliciter des commentaires théologiques sur l’Evangile. Le prêtre catholique s’est rendu il y a quelques années dans les villages musulmans pour présenter les Evangiles. Le public était venu nombreux.
Des Kurdes de diverses confessions chrétiennes, vivant dans le désert sans prêtres depuis des lustres, avaient fini par faire appel à leurs voisins musulmans pour les enterrements. Peu à peu, ils ont adopté leurs coutumes et se sont mariés avec eux. Aujourd’hui, avec le retour de l’Eglise dans la région, ils retrouvent leur identité chrétienne perdue. Cette année, Naaman Rawik a baptisé neuf jeunes Kurdes de 15 à 16 ans du village d’Aïn el Arab, près de Raqqa.
Pour arriver à Tabqa, au pied du barrage de Thawra, le parcours est d’une cinquantaine de kilomètres. «Mon problème, c’est ma vieille voiture, je roule 2’000 km par mois sur des routes pas toujours très carrossables. Je prie à chaque fois Dieu qu’elle marche.» Affairé dans le jardin entourant l’église de Tabqa à cultiver fleurs et légumes, le P. Rawik explique qu’il y vient chaque jour, après la messe. «C’est mon sport à moi, pour l’équilibre.» La journée du prêtre, partagée entre les deux villes, est intense. A midi, visite au directeur du barrage, pour voir s’il y a des problèmes avec les soldats, les ouvriers. L’après-midi, visite aux familles de Thawra en compagnie des sœurs. Le soir, prière à la chapelle de Tabqa.
Petite et vétuste, la chapelle ne paie pas de mine. Pourtant, juste à côté, à Thawra, une belle église de style byzantin presque achevée garde ses portes désespérément closes. L’archevêché melkite catholique d’Alep a bien participé au financement de la nouvelle église, mais le terrain est propriété de l’Eglise orthodoxe. L’évêque orthodoxe n’ayant pas de prêtres pour s’en occuper, l’église nouvelle reste fermée.
A Tabqa, le Père Rawik voudrait bien trouver un peu d’argent pour réparer sa chapelle délabrée. Faute de moyens, il a peint lui-même l’iconostase, des icônes de style russe s’inspirant de l’Ecole St-Georges de Meudon. Pour payer la peinture, il a organisé une loterie, dont le premier prix était une croix en nacre… «Les gens d’ici sont assez pauvres, vous savez», dit-il, pour s’excuser de la modestie des lieux.
«Que faire ? Inch Allah, comme on dit en arabe! Nos fidèles se sentent un peu abandonnés. Pour le moment, je suis leur père. J’aimerais bien qu’un autre prêtre vienne me seconder, car nous vivons une situation d’urgence.» Pas question, pourtant, de laisser tomber: «Travailler avec des orthodoxes, des catholiques, des protestants, au milieu des musulmans, j’ai beaucoup de chance! C’est ma mission, elle me remplit de joie!» (apic/be)
Inde: La misère et les coutumes poussent à l’infanticide
APIC – Reportage
Cent bébés-filles sont tuées chaque mois dans le sud du pays
Le péché de naître fille
Par Pierre Rottet, de l’Agence APIC
Le problème de l’infanticide s’aggrave en Inde. Le péché de naître fille
coùte chaque mois la vie a quelque 100 bébés-filles dans le sud du pays.
Mais la pratique s’étend au pays entier. Impossible à chiffrer. Une horreur
qui s’ajoute à la misère. Notre reportage.
«J’ai mélangé le lait et le suc de la baie mortelle. Le bébé a bu, crié 15
minutes. Puis il est mort». Terrible témoignage d’une mère indienne qui
vient de tuer son enfant nouveau-né. Dont le seul tort a été de naître fille. La dot coûte cher en Inde. La misère et l’ignorance y vont de leur
poids dans le drame de cette société. Qui veut que la femme soit considérée
inférieure à l’homme. Au point d’assassiner ses enfants-femelles.
A l’aube du XXIe siècle l’infanticide reste une pratique répandue
partout en Inde. Et en particulier dans les districts du sud, où 100 bébésfilles sont en moyenne tuées chaque mois. Terribles chiffres. Que nous confirme à Madurai, dans l’Etat du Tamil Nadu, Sebastian James, Frère des écoles chrétiennes et responsable du Centre «Nanban» pour les enfants travailleurs et les gosses de la rue de cette cité du sud de l’Inde, connue pour
son industrie textile.
Six Etats se partagent le triste privilège de figurer au hit-parade de
l’horreur: le Tamil Nadu, le Rajhasthan, l’Orissa, l’Andra Pradesh, le Karnataka et le Bihar, dans l’est du pays. Mais seul le Tamil Nadu a reconnu
que l’infanticide existe, nous dit-on à Madurai.
Prête à tuer encore
Les méthodes pour tuer les bébés sont toutes plus barbares et violentes
les unes que les autres. «Dans les campagnes, dit Frère James, on utilise
le suc d’une baie particulièrement toxique, ailleurs on les étouffe avec du
paddy, un riz non décortiqué, ou encore les bébés-filles sont brûlées vives, voire dans certains cas enterrées vivantes. D’ordinaire, ces bébés ne
vivent quère plus de 10 heures après leur naissance».
La voix de Frère James n’en finit pas de s’indigner… Son témoignage
recueilli par l’APIC rejoint ceux contenus dans un reportage de la BBC.
Terribles images. Terribles aveux, d’une mère qui, après avoir eu une première gamine, a accouché d’une seconde fillette, alors qu’elle espérait un
garçon. «On se bat pour survivre. Nous ne voulions pas une autre fille.
Alors nous l’avons tuée». Une besogne que la mère de la «jeune maman» a accompli. Tristement, avoue-t-elle, mais accompli tout de même. Les bellesmères sont souvent à l’origine du geste fatal.
Geste fatal? Cette autre mère l’a répété par deux fois déjà, en pressant
une serviette mouillée sur le visage de ses deux fillettes. Jusqu’à
l’étouffement. A nouveau enceinte, elle se dit prête à recommencer, et à
recommencer encore jusqu’à mettre au monde l’enfant-mâle attendu, voulu,
lui. «Nous ne la garderons pas. Nous n’avons pas de quoi acheter notre
riz». Sur le point d’accoucher, cette autre femme, très jeune encore, ne
fait preuve d’aucune émotion particulière. Si c’est une fille? «J’ai tout
prévu. Je lui donnerai des grains de riz, les lui enfoncerai dans la gorge… jusqu’à ce qu’elle étouffe».
De tels aveux, frère James en a entendus par dizaines. «Même des parents
avec un certain niveau d’éducation ont recours à l’infanticide des filles
par peur de devoir faire face aux demandes exorbitantes en matière de dot
le jour où elles seront «bonnes à marier». Dans de nombreuses communautés
rurales la rumeur veut que si une fille est tuée, le prochain bébé sera un
garçon». Selon notre interlocuteur, l’infanticide est également considéré
comme un service rendu à la société… Et un acte de charité qui épargnera
à l’enfant les duretés qu’elle aura à affronter dans la vie. «Les filles,
disent les parents et tout ce qui gravite autour, sont des fardeaux. La
pression sociale est grande. C’est pour cela qu’on les tue».
La dot mangeuse de fille
Derrière l’inqualifiable misère, l’ignorance voire les croyances, les
coutumes n’en finissent pas d’apporter leur concours complice. Selon Gillian Wilcox, porte-parole de l’UNICEF, une des principales raisons à se désastre porte le nom de dot: le système veut qu’une fille coûte cher à marier. Les frais du mariage, s’additionnant à ceux de la dot, peuvent s’élever à plus de 35’000 dollars (42’000 francs), alors qu’un fonctionnaire
moyen ne gagne que le dixième de cette somme en une année. Et combien moins
un agriculteur ou un employé agricole du sud de l’Inde, dont le salaire
mensuel moyen n’excède guère 40 dollars. Lorsqu’il trouve de l’embauche.
En Inde, mettre au monde un bébé de sexe féminin est synonyme de cérémonies obligatoires coûteuses. Qui commencent dès la naissance ou presque
avec le percement des oreilles. Sans compter le prix des saris. La dot ruine les familles, convient Frère James. Elle peut représenter jusqu’à 10 ans
de salaire: «Aujourd’hui donner naissance à une fille est pour une famille
pauvre le commencement de ses malheurs».
Il manque 50 millions de femmes
Epouvantable réalité. D’autant plus inacceptable que le problème de
l’infanticide des filles s’aggrave en Inde, affirme pour sa part l’UNICEF.
Selon qui la population de ce vaste pays de près de 935 millions d’habitants (statistiques de 1994) devrait compter quelque 50 millions de femmes
de plus qu’il n’en a aujourd’hui. Alors que dans le monde on compte 105
femmes pour 100 hommes, en Inde, il n’y a plus que 93 femmes pour 100 hommes, peut-on lire dans un récent rapport. Or, précise celui-ci, «seules les
sociétés qui se livrent à une discrimination spécifique et systématique
contre les femmes en arrivent là».
Les dizaines de millions de femmes qui manquent à l’appel en Inde n’ont
pas toutes été tuées à la naissance. Les techniques modernes se sont chargées de la besogne avant. En 1991, à quelque jours de la présentation du
projet du ministre de la Santé, M.L. Fotedar, sur la réglementation de la
pratique des tests prénatals, on estimait que 45% des 6 millions d’IVG annuelles en Inde se décidaient dès l’annonce du sexe féminin du bébé porté
par la mère.
«Les techniques des ultra-sons et de l’amniocentèse sont de plus en plus
utilisées pour détecter les foetus de sexe féminin dans le but de provoquer
des avortements. Des familles qui normalement ne tueraient pas une fille le
font maintenant avec l’aide de la technique», avance G. Wilcox. En Inde,
dit-elle, court un dicton selon lequel élever une fille, c’est comme arroser une plante dans le jardin du voisin».
Dans l’Etat du Bihar, limitrophe du Népal, une sage-femme gagne l’équivalent de 0,90 cts pour aider une petite fille à venir au monde. «Elle
prend le double pour la faire disparaître». En 1994, l’Inde a voté l’interdiction de l’amniocentèse. Comme elle avait interdit en 1870 le meurtre des
nouveaux-nés. Sans résultat. L’amniocentèse enrichit plus que jamais ceux
qui la pratiquent. Et à ce jour, personne en Inde n’a fait de prison pour
infanticide.
Phénomène lié au sous-développement?
Une étude de l’ADITHI, une ONG qui oeuvre dans le Bihar, menée conjointement avec la «Community Service Guild», dans le Tamil Nadu, tend à démontrer que les villages où sévit l’infanticide des filles sont moins développés dans les domaines des liaisons avec l’espace urbain.
Le district de Salem, au nord de Madurai tient le record en Inde en ce
qui concerne les tueurs de filles. Pour 1’205 hommes, on compte 1’000 femmes à peine. Sur 1’250 femmes interviewées en 1992 pour les besoins de
l’étude en question, 1’238 déclaraient appartenir à la religion hindoue et
la plupart à la caste des «Gounders». Ces derniers, qui sont en général des
travailleurs agricoles, présentent le plus bas pourcentage de femmes par
rapport aux hommes dans tout le pays. Si 476 d’entre-elles avouaient vouloir commettre un infanticide si elles avaient encore des filles, seuls 111
admettaient en avoir commis un au cours des deux années précédentes. Avec
les «Gounders», d’autres castes pauvres comme les «Theavers», les «Maravers», les «Pellars» ou encore les «Dalits» s’acharnent sur les bébés-filles. En toute impunité.
Plutôt la tuer que la donner
Le compteur de la population indienne enregistre une naissance chaque
seconde. Combien de meurtres de bébés dès leur naissance? Combien d’avortements par discrimination de sexe? Impossible à savoir, à tenter de déterminer, assure Frère James. Dans certaines cliniques du sud de l’Inde, on murmure cependant que 4 petites filles sur 10 sont tuées. L’Etat du Tamil Nadu
a certes commencé une campagne pour combattre ce fléau, notamment en offrant de 20’000 à 25’000 roupies par fille qui atteint l’âge de 10 ans (entre 800 et 1’000 francs). «Mais il n’y a pas de baguette magique pour faire
disparaître ces pratiques».
Dans le but de combattre ces crimes où tout au moins de donner le change, le gouvernement a récemment pris des mesures. Dont l’une d’elle consiste à placer un berceau à l’entrée des villages. A la nuit tombée, les femmes peuvent y abandonner leur bébé. Un échec total, assure le Frère lasallien. «La plupart des mères refusent de donner leur enfant. Angoissée de
savoir que sa fille grandit… la mère préfère la tuer elle-même. Plutôt
que de la voir vivre les souffrances endurées par ces femmes». Le Centre
«Nanban» (»Ami» en tamil) qu’il a fondé dénonce périodiquement ces pratiques dans la presse ou ailleurs. «Le gouvernement continue pourtant à nier
cette réalité. Les juges et la police, eux, ils ferment habituellement les
yeux».
Vaincre les obstacles, y compris culturels et religieux
Riche ou pauvre, la société indienne n’accorde à la femme qu’un rôle de
second plan. Sinon moins. Dont la fonction principale est de mettre au monde des rejetons, mâles autant que possible, écrivait en 1991 «Eglises
d’Asie».
Dans les hôpitaux du sud de l’Inde, en particulier, on assure que la
différence du nombre d’admissions de bébés mâles par rapport à celles des
filles est énorme. Neuf bébés sur dix sont des garçons, affirme-t-on. «Ce
n’est pas que les filles tombent moins malades. On les laisse simplement à
la maison. Jusqu’à ce qu’elles meurent».
Aux yeux de Frère James, la solution se trouve quelque part dans des
programmes micro-économiques pour aider les femmes à se former, à trouver
du travail et à les soutenir dans leur éventuelle quête de ne plus se montrer totalement dépendante de l’homme. Mais il faudra auparavant vaincre
des obstacles culturels et religieux. «Car la religion – et cela vaut aussi
pour la communauté chrétienne du pays – considère les femmes comme des personnes de deuxième classe». (apic/pr)
ENCADRE
L’Asie a peur à ses filles
La pratique de l’infanticide est loin d’être une réalité exclusivement
indienne. En Chine aussi, plusieurs millions de femmes manquent également à
l’appel. Au cours de l’été 1991, un rapport des Nations Unies sur «Les femmes dans le monde» montrait que parmi les pays où le nombre des femmes est
inférieur à celui des hommes figuraient l’Afghanistan (94,5 pour 100 hommes), le Bangladesh (94,1), le Bhoutan (93,3), le Népal (94,8), le Pakistan
(92,1), la Papouasie-Nouvelle Guinée (92,8), la Turquie (94,8). Selon A.
Sen, un économiste de Harward, il manque actuellement 100 millions de femmes dans le monde. «Des millions de femmes sont mortes simplement parce
qu’elles étaient des femmes», constatait de son côté Sharon Capeling-Alakja, de la Fondation pour le développement de la femme, des Nations Unies.
Contrairement à l’Asie, l’Afrique et l’Amérique n’ont pas recours à l’infanticide. (apic/pr)
ENCADRE
Le Taj Mahal ne fait plus rêver
Pour pouvoir payer la dot de leur fille, les agriculteurs du Tamil Nadu,
pour ne citer que cet Etat, vont jusqu’à hypothèquer voire à se dessaisir
de leurs biens, animaux domestiques, terres cultivables. Et même jusqu’à
l’emprunt. A des taux assassins. Dans une société qui cultive le mépris de
la condition de la femme, les «maris» et les «belles-familles» n’ont souvent aucune peine à se surpasser pour réduire la femme à l’esclavage. A se
surpasser dans l’odieux. Telle femme ouvertement haïe ici et privée de
nourriture, battue là et parfois jusqu’à la mort. Telle autre encore répudiée… au point de devenir à nouveau une charge. Pour le père et la mère
qui avait pourtant consenti au sacrifice de la dot. Le Taj Mahal ne fait
décidémment plus rêver en Inde. (apic/pr)