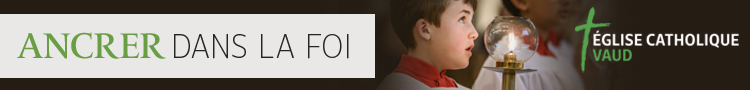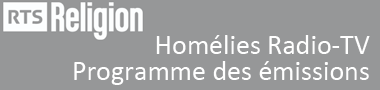Fribourg: Jean Paul II s’est déjà rendu en Suisse il y a 20 ans
Apic dossier
Le mois de juin est celui des visites du pape en Suisse
Bernard Bovigny, de l’Apic
Fribourg, 2 juin 2004 (Apic) La venue de Jean Paul II à Berne, les 5 et 6 juin prochain, intervient 20 ans presque jour pour jour après sa dernière visite en Suisse. Un pape en grande forme avait sillonné le pays, dans un marathon ininterrompu en 9 villes-étapes. Paul VI en 1969, Jean Paul II, dans son projet avorté de 1981, en 1984 et en 2004, ont tous choisi le mois de juin pour se rendre en Suisse.
«La visite de Jean Paul II est celle d’un pasteur qui tient à connaître et à rencontrer des croyants et des hommes de bonne volonté», avaient appelés les évêques suisses, au terme de leur assemblée du 4 au 6 juin 1984 à Pfäffikon (Schwyz), quelques jours avant la venue du pape en Suisse. Cette visite, du 12 au 16 juin, avait suscité plusieurs réactions, dont certaines «regrettables» à en croire la Conférence des évêques suisses, «sans parler de l’exploitation de l’évènement à des fins commerciales».
C’est que l’événement était de taille. La dernière visite pastorale d’un pape remontait alors à 550 ans. Paul VI s’était bien rendu à Genève, le 10 juin 1969, mais uniquement au siège du COE. La venue de Jean Paul II était déjà prévue en 1981, du 31 mai au 5 juin, mais avait été reportée en raison de l’attentat dont il a été victime le 13 mai de cette même année.
Le voyage-marathon à travers la Suisse
C’est un pape en forme olympique, malgré les suites de l’attentat qui l’a touché trois ans plus tôt, qui était accueilli le 12 juin 1985 à 9h sur la tarmac de l’aéroport de Kloten/Zurich par le président de la Conférence épiscopale suisse, Mgr Henri Schwery, devenu plus tard cardinal, et par le président de la Confédération Léon Schlumpf.
Vers 10h45, Jean Paul II se trouvait déjà à Lugano, au stade du Cornaredo, pour la 2e étape de ce voyage-marathon. Le passage en terre tessinoise est essentiellement marqué par la célébration de l’eucharistie. Au terme du repas de midi, et d’un rapide repos à l’évêché, le pape s’envole pour Genève, la cité de Calvin. Il arrive déjà vers 17h au siège du Conseil oecuménique des Eglises, où l’accueille le secrétaire général du COE, le pasteur Philip Potter. Ce dernier a notamment souligné la contribution de l’Eglise catholique à la promotion de «l’unité visible en une seule foi et en une seule communauté eucharistique dans le culte et la vie commune en Christ». Il a également rappelé le «Drame des divisions à l’intérieur des Eglises et entre elles» et a appelé à intensifier les efforts «non seulement pour rechercher la justice et la paix, mais aussi pour surmonter les tensions et les divisions qui apparaissent lorsque les chrétiens s’opposent sur les moyens d’instaurer à la fois la paix et la justice».
Engagement irréversible de l’Eglise catholique dans l’oecuménisme
Une prière et une célébration commune ont rassemblé autour du pape les personnalités et le personnel du COE. Au cours d’une allocution, le pape avait confirmé que «l’engagement de l’Eglise catholique dans le mouvement oecuménique était irréversible et que la recherche de l’unité était une de ses priorités pastorales». Jean Paul II s’est ensuite rendu au Centre orthodoxe de Chambésy pour un échange de paroles avec le métropolite Damaskinos.
La journée de Jean Paul II ne s’était pas terminée dans la cité du bout du Lac Léman. Tard dans la soirée, après un bref arrêt du train à Lausanne, le pape arrive à Fribourg la catholique. Cette étape, le lendemain 13 juin, sera marquée par une multitude de rencontres. Jean Paul II chantera les laudes avec les religieuses et religieux de Suisse romande à l’église des Cordeliers et leur prononcera une homélie. Plus tard dans la matinée, il rencontrera 2’000 à 3’000 étudiants de l’Université. Avant de devenir pape, il s’y était déjà rendu en 1975 en tant que conférencier à un symposium. Jean Paul II entend le discours d’accueil du recteur Augustin Macheret, puis celui de plusieurs professeurs, avant de prononcer une allocution sur le rôle du théologien, qui «éclaire les questions, nouvelles ou anciennes, en ouvrant le regard à la lumière de Dieu». La matinée se termine avec un mot d’encouragement aux malades de l’hôpital cantonal, situé près du séminaire diocésain où a logé le pape.
La grande forme malgré le programme chargé
L’après-midi du 13 juin sera consacrée à la messe dans le Parc de la Poya, en compagnie de près de 30’000 participants, puis la rencontre avec la Fédération suisse des Communautés israélites à l’évêché. Malgré un important retard accumulé durant la journée, c’est un Jean Paul ponctuel et en grande forme qui retrouve les jeunes de Suisse romande le soir à la patinoire St-Léonard, pour entendre leurs messages, prier en leur compagnie et leur adresser des mots d’encouragement. Quelques jours plus tard, Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, se rappellera que le pape était «capable de récupérer de ses fatigues en s’isolant quelques minutes», comme il l’a fait après le rapide souper à l’évêché. Lui-même et son auxiliaire, Mgr Gabriel Bullet, avaient de la peine à suivre le rythme imposé par le programme de cette journée interminable.
Le lendemain, 14 juin, la première partie de la matinée a été marquée du sceau de l’oecuménisme, au niveau national cette fois. C’est à Kehrsatz, près de Berne, que Jean Paul II rencontre les représentants des autres Eglises chrétiennes de Suisse dans un Centre oecuménique. A 11h, le pape se retrouve à Berne devant le Conseil fédéral in corpore, où il prononce un discours soulevant des problèmes éthiques actuels. Il invite la Suisse à s’ouvrir toujours davantage: «Il devient nécessaire de ne plus considérer seulement la neutralité comme le moyen de se protéger des turbulences de la grande politique».
Après la pause de midi à la nonciature, le pape se rend en hélicoptère au Flüeli pour célébrer la messe dans le village natal de Saint Nicolas de Flüe, patron de la Suisse.
Près de 10’000 fidèles amassés à Einsiedeln
C’est à Einsiedeln, le plus important lieu de pèlerinage de Suisse, que Jean Paul II passera la journée du 15 juin, d’abord en compagnie de la conférence des évêques suisses, pour un échange de deux heures, et des représentants du clergé.
L’après-midi de ce même jour sera consacré à la rencontre des conseils pastoraux, des mouvements d’apostolat des laïcs et des oeuvres d’entraide missionnaire. L’église de l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln était comble, et une grande foule était massée sur le parvis, pour la célébration de l’eucharistie à 15h30. Près de 10’000 fidèles y ont pris part, ainsi que plus de 20 évêques, de Suisse, France, Allemagne et Autriche. La célébration a également vu la participation du pasteur Philip Potter, secrétaire général du COE, et du prélat orthodoxe Emilianos.
La journée n’était pas pour autant terminée. Jean Paul II s’est encore entretenu avec quelque 80 représentants des médias audio-visuels et écrits, avant de se rendre à l’hôpital régional d’Einsiedeln, où il visitera les patients dans leur chambre.
Avant-dernière étape du périple: Tribschen, près de Lucerne, rejoint le samedi 16 juin en hélicoptère. Le pape a rendez-vous avec les étrangers de Suisse. Ils sont près de 10’000, catholiques ou autres, dont beaucoup en costume national, à acclamer Jean Paul II dans le parc de la villa de Richard Wagner. L’après-midi, une foule de 40’000 fidèles est assemblée à l’Allmend de Lucerne pour la messe destinée aux Suisses allemands, auxquels se sont joints de nombreux germanophones des pays voisins.
Ordination de neuf prêtres à Sion
La dernière journée passée par Jean Paul II sur sol helvétique, le 17 juin 1984, s’est déroulée à Sion en Valais. Elle a été concoctée par l’évêque du lieu, Mgr Henri Schwery. Le matin, la messe célébrée sur l’aérodrome, avec plus de 45’000 participants, a été ponctuée par l’ordination de neuf nouveaux prêtres. Durant l’après-midi, le pape visite la cathédrale de Sion, dédiée à la Vierge. Il reçoit les skieurs valaisans, le champion Pirmin Zurbriggen en tête, qui fêtent ce jour-là le 50e anniversaire de l’Association valaisanne des clubs de ski, et bénit leur drapeau.
Une cérémonie d’adieu ponctuera la venue en Suisse de Jean Paul II dimanche 17 juin à 17h. Le pape a souligné lui-même «le rythme intense de rencontres variées» de cette visite.
De retour à Rome, le pape a désigné son périple comme «un grand voyage dans un petit pays avec des problèmes typiquement helvétiques». Lors du vol de retour, il a exprimé devant des journalistes sa «satisfaction quant au succès de la visite pastorale à Genève et des rencontres avec les Eglises non-chrétiennes de Suisse». Quelques jours plus tard, autant le COE que le métropolite Damaskinos, du Centre orthodoxe de Chambésy, ont souligné la contribution positive du voyage du pape au dialogue oecuménique. Durant les six jours de sa visite, Jean Paul II a parcouru neuf villes et prononcé 34 discours.
Note: la plupart des discours et interventions prononcées lors de la visite du pape en 1984 sont regroupés dans l’ouvrage «Jean Paul II en Suisse» aux Editions St-Paul et St-Augustin, d’où sont tirés la plupart des informations contenues dans ce dossier.
(apic/bb)
France: Eglises évangéliques et pentecôtisantes et lutte contre les sectes
APIC – Dossier
Victimes «d’une chasse aux sorcières»?
Paris, 6 juillet 1999 (APIC) Des Eglises françaises évangéliques et pentecôtistes se disent victimes d’une chasse aux sorcières. La question divise: sectes ou pas sectes. Tant il est vrai que dans certaines «Eglises» du moins, on s’autoproclame pasteur un peu facilement. La confusion est grande. Au niveau de la mission interministérielle sur les sectes on parle d’une vigilance nécessaire. Alors que du côté de la Fédération protestant de France la tendance est à la minimalisation du phénomène pourtant grandissant.
Des Eglises évangéliques, s’estimant soumises à la pression des associations anti-secte, parlent de chasse aux sorcières. Alain Vivien, président de la mission interministérielle sur les sectes, préfère pour sa part parler de vigilance et s’en tient au principe républicain de liberté religieuse. Comme le révèle «Le Christianisme au XXe siècle», cela n’empêche pas «certains dérapages». Un pasteur du Sud-Ouest a notamment été mis en garde-à-vue suite à une plainte pour «manipulation mentale». Le statut d’association cultuelle est mis en cause.
En mars dernier un pasteur d’une Eglise évangélique du Sud-Ouest de la France sort de chez lui. Deux voitures de gendarmerie s’arrêtent; et le cauchemar commence: perquisition au domicile du pasteur et dans les locaux de l’Eglise. La secrétaire, la trésorière, un ancien conseiller de paroisse et le pasteur sont emmenés manu militari, escortés par six véhicules de gendarmerie. S’en suivent plus de cinq heures de garde-à-vue, pendant lesquelles les gendarmes traquent les supposés secrets des ordinateurs de l’Eglise, feuillettent la littérature saisie et épluchent les comptes.
Manipulation
Quel crime avaient-ils donc commis? Ce que de nombreuses Eglises évangéliques se voient reprocher régulièrement: un ex-membre estime soudainement avoir été «mentalement manipulé» et s’être fait escroquer. Une plainte a en effet été déposée par une jeune femme qui avait demandé de l’aide quatre ans auparavant, lors du divorce de ses parents: manipulation mentale, non-assistance à personne en détresse et, pour faire bonne mesure, détournement de fonds. L’Eglise en question revendiquant des pratiques pentecôtisantes (prière pour les malades, délivrance), l’interrogatoire a porté sur ses «pratiques de sorcellerie».
Dans la foulée, le pasteur et ses collaborateurs ont dû s’expliquer sur le fonctionnement et l’utilisation de la «taxation financière» des membres. En effet, les Eglises évangéliques fonctionnent le plus souvent grâce aux dîmes et aux offrandes. Mais le pasteur en question n’est venu au ministère que sur le tard. Retraité, il vit donc de sa retraite civile et non des deniers de l’Eglise. Deux mois plus tôt, un autre pasteur évangélique de la région avait eu droit au même traitement. Dans l’affaire qui nous concerne, le tribunal s’apprêterait à rendre un avis de non-lieu, le juge ayant même déclaré le dossier «grotesque».
«Lucrative entreprise familiale»
A plusieurs centaines de kilomètres de là, une autre Eglise évangélique est régulièrement contrôlée et taxée de secte tant par de mauvais plaisants que par certains services de l’Etat. Le Centre Roger Ikor contre les manipulations mentales n’hésite pas à qualifier de «lucrative entreprise familiale» «La Mission du Plein Evangile – La Porte ouverte chrétienne», à Mulhouse, dont les pasteurs ne gagnent que 7’000 francs français de salaire mensuel (chiffres vérifiés par l’administration fiscale), sans voiture ni logement de fonction.
Que reproche-t-on aux cadres de cette Eglise? De s’être autoproclamés pasteurs. De fait, les fils et les gendres du fondateur ont été placés aux postes clés. Jean Peterschmitt, toujours président de l’assemblée évangélique qu’il a créée il y a une trentaine d’années, a décidé de remanier son organigramme pour éviter les procès d’intention. Cette assemblée est devenue une église fréquentée. Installée dans un ancien supermarché, elle réunit près de deux mille personnes tous les dimanches et assure l’instruction religieuse de 500 enfants environ. En fait d’embrigadement, elle baptise – par immersion – les convertis qui en font la demande, cependant «il faut attendre une année après le baptême pour pouvoir devenir membre de l’Eglise», explique Samuel Peterschmitt, fils du fondateur. Quant aux dîmes et offrandes, contrairement à ce qu’affirme le Centre Roger Ikor, aucun appel de fonds n’est fait.
Statut des associations cultuelles à revoir
En France, diverses associations anti-sectes se sont créées ces vingt dernières années. Selon Samuel Peterschmitt, celles-ci fondent leurs accusations sur les témoignages des déçus ou des proches choqués par le choix de leur parent ou ami. L’Etat n’est pas en reste, avec des groupes parlementaires travaillant sur la question, et avec la création de la Mission interministérielle sur les sectes. Or cet organe est présidé par Alain Vivien, ancien président du Centre Roger Ikor contre les manipulations mentales. Il n’en faut pas plus pour que les Eglises évangéliques crient à la discrimination religieuse. Quant aux autres Eglises chrétiennes, elles ne connaissent de difficultés qu’en matière de réforme fiscale des associations. Selon des observateurs, les tracasseries proviennent du statut bâtard des associations cultuelles fonctionnant sur le droit associatif de 1901. Ce statut des associations cultuelles est attribué par le ministère de l’Intérieur si toutes les conditions d’honorabilité sont remplies, c’est-à-dire s’il n’y a pas de troubles à l’ordre public, pas d’escroquerie, pas de manipulation mentale…
Certaines Eglises évangéliques, quant à elles, invoquent l’Arrêt du Conseil d’Etat qui stipule que le «fait cultuel» est établi par les statuts de l’association. Aux yeux de Alain Vivien, le débat est ailleurs: «Nous devons nous montrer vigilants devant la recrudescence des groupes qui se déclarent à but religieux alors que ce motif semble masquer d’autres activités à but bassement commercial comme la formation professionnelle et les thérapies. De même les Témoins de Jéhovah, qui ont saisi 40 juridictions pour faire établir la réalité de leur objectif cultuel, ont peut-être eu gain de cause en première instance. Mais ils ont perdu tous les procès en appel. Le Conseil d’Etat a en effet rendu un avis en 1977 qui établit que, pour être considérée cultuelle, l’association doit faciliter l’exercice d’un culte, ne pas se livrer à des activités commerciales, respecter l’ordre public, c’est-à-dire l’ensemble des lois qui réégissent un Etat».
La protection de l’enfant
Et A. Vivien de renchérir: «Dans ces conditions, il n’y a pas un tribunal administratif qui donnerait raison aux Témoins de Jéhovah en raison de leur refus de respecter le service national, même par le biais de l’objection de conscience, et leur refus de certains soins médicaux pour leurs enfants. Leur interprétation des textes qu’ils invoquent les regarde. Le suicide n’est pas interdit en France. En revanche, il est interdit d’attenter à la vie des enfants. En cela, je ne vois pas pourquoi la République serait suspecte de persécuter les Témoins de Jéhovah».
En ce qui concerne les Eglises évangéliques, Alain Vivien récuse tout parti pris: «Il nous arrive fréquemment de renvoyer des gens qui viennent nous voir pour mettre en doute l’honorabilité d’une association cultuelle suite à une rupture familiale. Nous ne sommes pas là pour nous immiscer dans des affaires sentimentales. En matière de religion, c’est la règle républicaine qui doit s’imposer. Il n’est pas qustion de porter le moindre jugement sur les croyances des uns et des autres. Tant que je présiderai cette Mission, il en sera ainsi».
Alain Vivien souligne qu’il a parfois dû rappeler aux maires qu’ils n’ont pas le droit d’interdire l’installation d’un groupe religieux sur le territoire de leur commune si le plan d’occupation des sols le permet et si aucune des nuisances invoquées n’est motivée. Et de rappeler que la Mission interministérielle n’est pas limitée à recevoir les doléances de ceux qui s’estiment victimes d’une secte. «En cas de problèmes: il ne faut pas hésiter à appeler la Mission interministérielle. Les Eglises évangéliques peuvent venir nous voir».
Divergence?
La Fédération protestante de France (FPF), par Christian Seytre, son secrétaire général, donne son interprétation de la divergence entre le Ministère de l’Intérieur et le Conseil d’Etat à propos du statut d’association cultuelle:
«Dans Le Monde du 1er août 97, le ministre de l’Intérieur Chevènement disait qu’il était «seul habilité à reconnaître une association cultuelle». Tandis que le Conseil d’Etat considère que ce sont les statuts d’une association qui lui donnent son caractère cultuel.
Est-ce que le fait, pour une Eglise, d’appartenir à la FPF, permet de lever toute ambiguïté? «Si une association a des statuts de 1905, le fait d’être a la FPF la met effectivement à l’abri d’être qualifiée de secte. Par contre, le rôle de la Fédération n’est pas de donner un «label», comme le voudraient les autorités politiques. La FPF n’est pas mandatée pour cela. Tout groupe qui respecte la loi de 1905 doit être reconnu comme une Eglise conformément à la loi, qu’il soit membre ou non de la Fédération. Toute Eglise qui adhère a la FPF doit le faire dans un souci de communion, en acceptant pleinement sa charte. Il s’agit d’un pacte fédératif, et non de se mettre seulement à l’abri d’être qualifié de secte».
«Mon sentiment à la suite de la parution du rapport de la Commission parlementaire d’enquête sur la situation patrimoniale et financière des sectes? «Il y a un réel problème avec tel ou tel groupe qui se qualifie d’Eglise et ne l’est pas, telle la Scientologie, relève Christian Seytre. Mais ce rapport pose d’autres questions: sur quels critères, par exemple, des Eglises évangéliques ont-elles reçu le questionnaire permettant d’établir le rapport? Pourquoi des groupes, auxquels on ne donne pas la possibilité de se défendre, se retrouvent-ils dans des listes qui circulent partout, et même dans les services des impôts? Cela est indigne d’un Etat de droit. On ne peul pas, au nom de la préservation de la liberté de personnes fragiles qui risquent de tomber dans des sectes, remettre en cause la liberté de conscience et la liberté de religion, qui sont un «droit sacré» dans une démocratie». (apic/spp/pr)