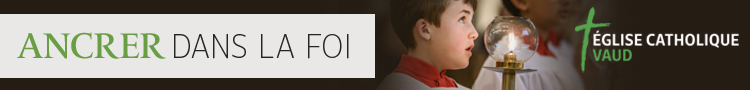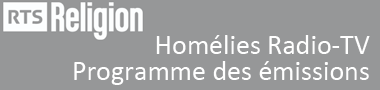«A quoi sert un évêque?»
Fribourg: Rencontre œcuménique en prévision de la Semaine de l’unité des chrétiens
Fribourg, 13 janvier 2012 (Apic) La semaine de prière pour l’unité des chrétiens, célébrée traditionnellement du 18 au 25 janvier, donne lieu à de nombreuses initiatives, dans les pays occidentaux, pour évaluer le chemin parcouru en vue du rapprochement oecuménique. Mais l’unité s’acquière également en exprimant et en écoutant les différents points de vue des communautés chrétiennes.
Ainsi, les Eglises catholique romaine, réformée et orthodoxe de la région de Fribourg ont convié leurs agents pastoraux, le 13 janvier, à une rencontre sur le thème «A quoi sert un évêque?». Une vingtaine de prêtres, pasteurs, diacres, religieux, religieuses et autres permanents laïcs se sont retrouvés à la salle Ste-Thérèse pour échanger leur point de vue sur la fonction de l’évêque.
«Nous avons choisi ce thème avant la nomination du nouvel évêque catholique à Fribourg. Ce n’est donc pas lui qui est directement visé», a précisé Noël Ruffieux, de la communauté orthodoxe, président de la Commission œcuménique de Fribourg et environs, en introduction des trois conférences qui ont cerné la fonction de «l’épiscope» dans les différentes traditions chrétiennes.
Donner des impulsions nouvelles dans le diocèse
Le prêtre valaisan François-Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale à l’Université de Fribourg, a repéré 7 facettes de la mission de l’évêque dans la tradition catholique:
– Veiller à ce que l’Eglise reste fidèle à sa mission de manifester l’amour du Christ;
– Stimuler la participation de tous, sans quoi la mission de l’Eglise est impossible;
– Discerner et reconnaître les charismes qui se manifestent dans l’Eglise, ce qui implique notamment d’accueilli également «dans l’humilité et la joie les surprises de l’Esprit»;
– Coordonner la diversité des charismes qui se manifestent au service de l’unité de l’Eglise;
– Maintenir une Eglise en communion avec les autres Eglises et avec les autres confessions chrétiennes, ce qui est un ministère de «faiseur de liens»;
– Donner des impulsions nouvelles dans son diocèse et opter pour des orientations pastorales (»Eviter que chaque secteur aille dans un sens différent et empêcher ainsi la dispersion», conseille l’abbé Amherdt, ancien vicaire épiscopal du diocèse de Sion);
– Agir en respectant un équilibre complexe entre autorité personnelle de l’évêque (principe hiérarchique), assemblée synodale où chaque baptisé apporte sa contribution (principe synodal) et recherche de communion au sein de l’Eglise locale et avec l’Eglise universelle (principe communionel).
«LEglise n’est ni une monarchie, ni une oligarchie, ni une démocratie, mais une forme singulière d’exercice de gouvernement», a lancé le professeur Amherdt, en affirmant que la tension entre les trois pôles de l’exercice de l’autorité était «indispensable», en vue d’éviter «soit l’autoritarisme, soit la dictature de la majorité, soit le centralisme d’uniformisation».
Introduire le ministère de l’évêque chez les réformés?
Le pasteur Daniel de Roche, président du Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg, a présenté la conception protestante de l’évêque. «Ce thème, pour diverses raisons, est un sujet brûlant depuis quelques années, y compris dans les Eglises réformées», a-t-il prévenu. La réflexion sur les ministères dans l’Eglise a été largement influencée, du côté réformé, par le «Document de Lima», édité il y a 30 ans par la commission «Foi et Constitution» du Conseil œcuménique des Eglises (COE). Destiné à susciter la réflexion, il proposait d’introduire «le triple ministère de l’évêque, du presbytre et du diacre». Mais de nombreux obstacles et résistances n’ont pas permis de faire aboutir cette réflexion. La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) a fait remarquer, lors du processus de consultation, que «la forme synodale est également une expression légitime de l’épiskopè, notamment en ce qui concerne son service de l’unité».
Il existe cependant une certaine diversité au sein du protestantisme, a rappelé Daniel de Roche. Ainsi, on trouve des évêques dans des Eglises réformées, en Roumanie et en Hongrie par exemple, pour des motifs historiques (»Les souverains ne voulaient s’adresser qu’à des évêques»). Mais dans tous les cas, selon la conception protestante, l’autorité s’exerce dans l’Eglise «selon une responsabilité partagée et non exclusivement par les évêques». «En conséquence, les Eglises de la Réforme ne considèrent pas que l’Eglise soit fondée sur l’épiscopat», a affirmé le conférencier.
Un évêque élu par les prêtres et les fidèles
Portant un regard orthodoxe sur la fonction de l’évêque, Noël Ruffieux a d’abord rappelé que «selon les témoignages du Ier siècle après les apôtres, l’Eucharistie est le cœur de l’Eglise, où se trouve l’évêque». Reprenant les lettres envoyées en l’an 115 par Ignace d’Antioche aux Eglises traversées lors de son voyage vers la captivité à Rome, le conférencier a notamment souligné que pour ce Père apostolique, ni l’évêque, ni le prêtre n’exerce un pouvoir. «De par l’Esprit saint et l’appel de l’Eglise, il a une autorité: une capacité de faire grandir dans la foi prêtres, diacres, catéchistes, moines, fidèles, fidèles engagés ou spectateurs, confessants ou consommateurs, ceux qui vivent dans l’Eglise et ceux qui sont en dehors».
Selon Cyprien de Carthage, vers l’an 250, «l’évêque est le plein responsable de son Eglise. Aucun autre évêque ne peut intervenir dans son diocèse. Il est en principe élu par son Eglise avec la participation des prêtres et des fidèles», souligne Noël Ruffieux, en constatant, parmi les «lacunes» dans la pratique actuelle de l’Eglise orthodoxe, que «le mode d’élection de l’évêque ne correspond pas toujours à la Tradition. Dans la plupart des Eglises, c’est le patriarche avec son synode qui nomme les évêques». Le conférencier a également relevé que «les diocèses sont souvent trop grands et ne permettent plus un contact régulier et étroit avec prêtres, diacres et fidèles». Sans préciser toutefois si ces interpellations concernaient aussi l’Eglise catholique …
Encadré:
– Jeudi 19 janvier à 18h à l’église réformée à Fribourg: Soirée œcuménique en allemand sur le thème «Wir werden alle verwandelt durch den Glauben an Jesus Christus».
– Vendredi 20 janvier à 19h30 à l’église paroissiale de Marly: Célébration œcuménique de l’Unité pastorale.
– Vendredi 20 janvier à 20h au Centre Ste-Ursule, Place Georges-Python à Fribourg: Conférence du pasteur Antoine Reymond sur le récent document du Groupe des Dombes «Vous donc, priez ainsi: Notre Père».
– Samedi 21 janvier à 17h30 au Monastère de la Visitation, rue de Morat à Fribourg: Célébration des Vêpres avec les moniales.
– Dimanche 22 janvier à 17h au Temple réformé de Fribourg: Célébration oecuménique et bilingue pour tous les chrétiens de la région de Fribourg, avec les représentants des Eglises et le Chœur œcuménique.
– Mardi 24 janvier à 15h30 à la Villa Beausite, rue St-Nicolas de Flue 30 à Fribourg: Temps de prière.
– Mercredi 25 janvier à 17h30 à la Cathédrale St-Nicolas: Vêpres avec les chanoines à l’occasion du 500e anniversaire du chapitre.
Note aux médias: Des photos des trois intervenants peuvent être commandées à apic@kipa-apic.ch. Prix pour diffusion: 80 frs la première, 60 frs les suivantes.
(apic/bb)