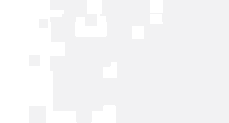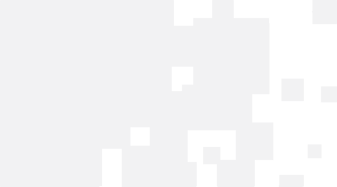Consistoire pour la création de 44 cardinaux: dans les coulisses d’un magasin spécialisé
APIC reportage
Histoire et évolution du «trousseau» des cardinaux
De Rome, Antoine Soubrier, agence I.Media
Rome, 19 février 2001 (APIC) 44 nouveaux cardinaux seront créés par le pape Jean Paul II au cours du consistoire ordinaire qu’il tiendra mercredi 21 février à 10h 30 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le lendemain jeudi, fête de la Chaire de saint Pierre, le pape présidera l’eucharistie solennelle, Place Saint-Pierre, avec les nouveaux cardinaux auxquels il remettra leur anneau.
Reportage à Rome, sur les habits des cardinaux, sur l’évolution de leur «trousseau» dans l’histoire, mais aussi pleins feux sur un magasin romain spécialisé en la matière, et sur les prix pratiqués. Evocation enfin des légendes qui circulaient naguère, lorsqu’à la mort d’un cardinal, son chapeau était accroché au bout d’un fil sur la voûte de sa cathédrale. La croyance populaire disait volontiers que l’âme du cardinal montait au ciel le jour où le chapeau tombait de sa voûte. Problème: à la cathédrale de Bourges, en France, deux chapeaux de cardinaux y sont encore et toujours suspendus…
Le jour du consistoire, le 21 février 2001, les futurs cardinaux revêtiront pour la première fois la couleur rouge, qui les différencient des évêques couleur rose. Pour se procurer ces nouveaux habits, les futurs cardinaux doivent se rendre avant le consistoire dans des magasins spécialisés qui n’existent qu’à Rome. Facilement reconnaissables à leurs vitrines décorées de rouge et de noir pour l’occasion, quatre de ces magasins sont situés dans le vieux centre de Rome. Euroclero, le plus connu, est situé en face de la congrégation pour la doctrine de la foi, à quelques pas de la Place Saint-Pierre.
La salle du tailleur
Accueillant d’ordinaire des prêtres, des religieux ou des religieuses, les employés du magasin tous des laïcs -, ont préparé l’événement à leur manière. Une grande salle, appelée la «salle du tailleur», a été ouverte au premier étage, où sont directement conduits les futurs cardinaux qui entrent dans la boutique pour la constitution de leur «trousseau».
Une centaine de soutanes noires, rouges et blanches pendent le long des murs. Cousues grossièrement, elles sont ce que l’on appelle une «preuve», une sorte de patron constitué après la prise des mesures et qui servira par la suite à tailler les autres soutanes. Quelques jours avant le consistoire, le cardinal devra repasser pour essayer cette «preuve» pour que le tailleur puisse faire les finitions.
Les soutanes rouges sont utilisées pour les grandes cérémonies. Elles sont toujours portées avec la mosette rouge par-dessus équivalent d’une soutane arrivant à la poitrine. Les soutanes noires filetées de rouge boutons et coutures rouges -, quant à elles, sont «à usage quotidien», au même titre que les soutanes blanches également filetées de rouges, qui servent aux cardinaux africains.
Des essayages à la «preuve»
Une étiquette portant le nom du propriétaire est accrochée à chaque soutane pendue dans la «salle du tailleur». En y regardant de plus près, on découvre les noms des futurs cardinaux inscrits sur chacune d’entre elles: Louis-Marie Billé – archevêque de Lyon en France -, José da Cruz Policarpo – patriarche de Lisbonne au Portugal -, Severino Poletto – archevêque de Turin en Italie -… Elles sont récupérées quelques jours avant le consistoire, afin de permettre au tailleur d’arranger les finitions au cas où la «preuve» n’aurait pas été à la bonne taille.
Pour les évêques qui ne peuvent pas se déplacer pour faire les «essayages», il leur est possible de passer la commande par téléphone. Mais ils doivent cependant passer pour l’étape des finitions.
Outre les soutanes, le trousseau «cardinalice» compte une dizaine d’éléments. Parmi eux, les boutons en soie rouge «qui permettent de faire la différence entre un évêque et un cardinal lorsqu’ils rentrent chez nous», explique un employé d’Euroclero. Quant aux chaussettes, rouges également, il y en a en laine et d’autres en coton, suivant la saison. Il y a également les mitres, parmi lesquelles les futurs cardinaux peuvent choisir la qualité, bien qu’elles doivent toutes avoir la même forme (celle d’un pignon de pomme de pin, d’où le nom de mitre «pignon»). Parmi les autres accessoires indispensables, il y a la ceinture en pure soie moirée, le cordon or et rouge pour la croix, ainsi que la calotte et la barrette de même tissu.
Quant au rochet sorte d’aube blanche arrivant au genou et se mettant par-dessus la soutane rouge et sous la mosette , les cardinaux ont le choix entre deux modèles. Le modèle «Vatican», tout d’abord, simple, avec quelques décorations discrètes dans le bas, mais identique pour tous. Il est utilisé pour les grandes cérémonies romaines, et se met donc avec la soutane rouge. L’autre modèle, dit «normal» utilisé en temps ordinaire -, est plus compliqué, avec ces dentelles «fait main», et des décorations.
Question de prix
La barrette, quant à elle, dont la taille se prend en centimètres (55 à 61) est identique pour tous. Elle est remise aux évêques le jour même du consistoire. Longtemps, elle a été le symbole du passage de l’épiscopat au cardinalat, au moment où le pape la pose sur la tête du nouveau cardinal. Petite toque carrée à trois cornes dont l’ancêtre était un simple chapeau mou recouvrant les oreilles et la nuque, et dont l’objectif était purement pratique -, les cardinaux n’ont cependant presque jamais l’occasion de la porter.
Souvent accompagnés par une religieuse ou un prêtre, il arrive aux futurs cardinaux de passer plusieurs heures dans le magasin au moment de la taille de la «preuve». Quant au paiement, il se fait une fois les soutanes récupérées par leur propriétaire. La communauté ivoirienne présente à Rome, par exemple, s’est cotisée pour offrir au futur cardinal Bernard Agré, archevêque d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, tout son trousseau. Le futur cardinal Jean-Baptiste Re, préfet de la Congrégation pour les évêques, de son côté, se verra offrir sa calotte par les membres de sa Congrégation.
Il faut compter entre 20’000 francs français (5’800’000 lires) et 35’000 FF pour un trousseau complet. Les prix varient en fonction des goûts de chaque cardinal (le rochet en dentelle, plus ou moins «chic», varie de 1000 FF à 14’000 FF; la mitre, également, existe à différents prix), mais aussi en fonction de l’endroit d’où ils viennent. Par exemple, un cardinal africain peut se procurer, en plus des soutanes rouge (6’300 FF) et noire (3’500 FF, la soutane blanche filetée de rouge, dont le prix est sensiblement identique à la noire. Quant à l’anneau, il est offert par le pape qui le leur remet officiellement lors de la cérémonie du consistoire.
Les chapeaux des cardinaux et leurs âmes
La manière dont s’habille un cardinal aujourd’hui a beaucoup évolué, notamment depuis que Paul VI a minimisé l’importance des «règles d’habillement et de bienséance», en 1969, pour mettre l’accent sur «la valeur spirituelle» de la fonction. Au cours des siècles, l’aspect symbolique a également changé.
Au 13ème siècle, Innocent IV avait instauré le large chapeau de cardinal, le «galero», simplement pour des questions de commodité. En effet, les cardinaux se déplaçant à cheval, il fallait trouver un système pratique pour les protéger de la pluie et du soleil. Ce chapeau permettait par ailleurs de tenir la «capa magna», une grande cape qui recouvrait à la fois le cardinal et la croupe du cheval. Cette même cape a été raccourcie par Pie XII, puis supprimée par Paul VI.
Quant au chapeau, il tenait à l’aide d’un cordon qu’ils serraient autour du cou à l’aide de «glands» qui sont devenus, plus tard, le symbole de la hiérarchie cardinalice. A la mort d’un cardinal, le chapeau était accroché au bout d’un fil à la voûte de sa cathédrale, la légende populaire disant que l’âme du cardinal montera au ciel le jour où le chapeau tomberait. A la cathédrale de Bourges en France, par exemple, deux chapeaux de cardinaux sont ainsi toujours pendus à la voûte.
Au 15ème siècle, le pourpre, couleur jusqu’alors réservée aux empereurs romains, est devenu la couleur officielle des cardinaux. Le pape lui-même était habillé de pourpre. La couleur blanche est arrivée avec Pie V, qui avait voulu garder l’habit de l’ordre des moines dominicains, dont il était issu. Il faisait ainsi sienne la tradition selon laquelle seuls les cardinaux originaires d’ordres monastiques mendiants (franciscains, dominicains, carmes, et bénédictins) avaient l’autorisation de porter leur habit monastique. Ils devaient toutefois porter la calotte, la barrette et le chapeau rouges.
Quand le pourpre passe au rouge vif
D’autres couleurs devaient par ailleurs être portées, suivant le temps liturgique – violet pendant le carême et l’avent, rose pour certaines fêtes. Ce n’est que beaucoup plus tard vers le 19ème siècle – que le pourpre est passé au rouge vif et que sa signification en a été modifiée pour finalement symboliser la fidélité qui leur est demandée, et qui doit aller jusqu’au martyre.
Au moment de l’instauration de la couleur pourpre, vers la moitié du 15ème siècle, les premiers cardinaux de rite byzantin étaient créés. La couleur pourpre étant le privilège de l’archevêque de Chypre privilège qu’il a toujours, et qui lui donne notamment le droit de signer en rouge -, ces cardinaux ont refusé de la porter, par respect pour l’archevêque de Chypre. Depuis, aucune tenue particulière n’a été fixée pour les cardinaux de rite oriental.
Privilèges
Par tradition, ils sont issus d’ordres monastiques, car en Orient, seuls les moines sont tenus de rester célibataires. La plupart des cardinaux de rite oriental étaient donc vêtus de leur habit. Depuis le premier cardinal oriental 15ème siècle -, des habits très différents ont ainsi vu le jour. Entre ceux qui conservaient leur habit monastique et ceux qui utilisaient des vêtements liturgiques de leur rite mais de couleur rouge, aucune règle n’a été établie.
Cette question a été posée une nouvelle fois dans les couloirs du Vatican ces derniers jours, avec la création prochaine de deux nouveaux patriarches – le patriarche Ignace Moussa I Daoud, préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales, Syrien, et le patriarche égyptien Stéphanos Ghattas, patriarche d’Alexandrie des Coptes. Une note a proposé notamment que ces derniers conservent leur habit monastique afin de garder leur caractère propre -, «pour des raisons œcuméniques», tout en essayant de trouver une certaine cohérence entre eux. (apic/imed/pr)
Le langage de la terre
APIC – Reportage
…pour parler au ciel
Des messes en patois de A à Z pas tristes dans le Jura. Un cas unique
Par Pierre Rottet, de l’Agence APIC
Les messes en patois attirent chaque fois la foule dans le Jura. Pas étonnant… Ils sont nombreux les groupements patoisants à défendre la langue
de leurs ancêtres. Sa défense est de plus inscrite dans la Constitution
cantonale. Inculturation façon jurassienne, le patois, depuis plusieurs années, s’est fait complice de la transmission de la foi. Au cours d’une messe qui remplit chaque fois les églises. APIC – Reportage, en quelque
sorte, pour parler au ciel…
Le cas du Jura est unique. Contrairement aux cantons de Fribourg et du
Valais, où seuls des passages de la messe sont célébrés en patois, l’office
jurassien a été traduit de A à Z, y compris la prière eucharistique. Et
jusqu’à l’»Amen» de circonstance. Messe vivante, observe-t-on dans le Jura.
On s’en étonne à Fribourg. Le ton est à la franche désapprobation du côté
du Valais. Notre reportage.
«A nom di Père, di Bouebe è peu di Saint-Echprit. Que l’Bon Dûe feûche
aivô vos». Une ou deux fois l’an, l’abbé Yves Prongué et le chanoine Jacques Oeuvray commencent en ces termes l’office du dimanche. «Au nom du Père…» Rien de plus normal pour une messe. Le premier est curé de Boncourt,
le second de Delémont. Ils ont en commun d’être Jurassiens. D’origine
«ajoulote». Et d’avoir «traduit» de A à Z la messe en patois. Une langue
qu’ils cultivent avec cet accent franc des gens du terroir.
«Les derniers des Mohicans»
Le patois se meurt. Et les patoisants, qu’ils soient Fribourgeois, Valaisans ou Jurassiens, notamment, passent aujourd’hui volontiers pour «les
derniers des Mohicans» de la langue de nos grands-parents. Situé à la frontière des langues d’oc et d’oil, le Jura connaît des patois issus des deux
langues. Dont la défense est inscrite dans la Constitution du nouveau canton et pour laquelle des cours à option sont donnés dans les écoles. Environ 5% de la population, entre jeunes… et plus âgés surtout, le parle
couramment. Principalement en Ajoie, en Haute-Ajoie, dans la Courtine
franc-montagnarde, ou dans le Val Terbi du district de Delémont. Là où la
terre se travaille. Depuis des générations, à faire ployer sous le nombre
n’importe quel arbre généalogique.
Pas étonnant dès lors que rubriques, chroniques, pièces de théâtres, essais, livres ou autres études se suivent. En patois. Dont de nombreux
écrits par des prêtres. Pour marquer le retour aux sources que cette langue
symbolise. En même temps qu’elle affirme une identité. Pas étonnant non
plus que depuis près de huit ans maintenant, la messe en patois soit célébrée à tour de rôle une ou deux fois l’an dans les districts des FranchesMontagnes, de Porrentruy et de Delémont. Dans des églises combles. Grâce à
la complicité des abbés Nicoulin et Rebetez, Ajoulots eux aussi, à l’instar
des curés Prongué et Oeuvray.
Des «èrtlieulons» à se faire pardonner
L’expérience est extraordinaire. «Je ne pense pas qu’on prêchait en patois par le passé, à une époque où cette langue était encore «le» moyen
usuel de communication. J’ai cherché, demandé dans les bibliothèques si on
avait des recueils de sermons en patois. Introuvables. Il n’en existe aucun. Pas davantage qu’on a de mémoire d’homme souvenir d’une homélie en
patois». assure Jacques Oeuvray.
Jusqu’au jour où une poignée de prêtres en décida autrement. Il y a une
dizaine d’années… Mais seuls l’accueil et l’homélie se disaient alors en
patois», confie le chanoine. Tout est désormais traduit. Les lectures de la
Bible, les prières, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique… Sans oublier l’homélie, «qui donne souvent lieu à de gros éclats de
rires». «Il suffit d’annoncer une messe en patois pour ne plus trouver une
place dans l’église. Les curieux, mais surtout les patoisants y viennent en
nombre, avec leurs chorales pour animer la célébration».
Le patois est une langue savoureuse. Une expression culturelle, une philosophie, une manière de vivre. Pauvre en vocabulaire. Simple et terrienne.
«Le patois n’est pas une langue qui s’apprend. On grandit avec. Il y a
beaucoup de bon sens dans ce parler. Avec un mot, vous exprimez un état
d’âme. Un sentiment. C’est vrai, nous sortons de l’homélie traditionnelle»,
reconnaît de son côté le curé Prongué.
Silence… Le temps d’une lueur goguenarde dans ses yeux… «Les gens
pouffent volontiers de rire. Parce que vous utilisez des mots qui font naturellement rire. Tenez, lorsqu’on se prépare à l’Eucharistie et qu’on reconnaît nos «èrtieulons», nos bêtises littéralement, ou encore nos «arbours», nos «erboe», en un mot nos crasses. Quand on demande au «Bon Dûe de
nos paidjenaie» pour «nos èrtieulons dains not vie», c’est-à-dire qu’on demande à Dieu de pardonner pour nos «bêtises». C’est peut-être pas très recueilli, comparé aux autres célébrations. Mais alors quelle chaleur. Et
quelle fabuleuse ambiance».
Ni Rome, ni Bâle
«La sauvegarde de cette langue nous est apparue importante, et pas uniquement au niveau culturel ou de son parler quotidien, mais aussi dans la
transmission de la foi. Et comme les patoisants sont généralement des gens
issus de milieux ruraux très catholiques…» En patoisants convaincus, le
chanoine Oeuvray et le curé Prongué sont allés jusqu’au bout de leur idée.
«Si on donnait à analyser nos textes de la liturgie traduite en patois mais qui veut les analyser? lance, moqueur, Jacques Oeuvray -, peut-être y
trouverait-on des erreurs théologiques. Personne à Rome ou à Bâle n’est cependant en mesure de dire: là il y a une faute». «Il est vrai que nos traductions ne passeraient jamais la rampe auprès d’une Commission liturgique,
avance l’abbé Prongué. La messe en patois de temps en temps, c’est l’exception…» Une fois par mois? «On ne nous le permettrait sans doute pas».
L’évêque? «Aucun n’a pour l’instant assisté à une telle célébration. Est-il
seulement au courant de son existence?». «Il n’y comprendrait de toute façon rien», renchérit Jacques Oeuvray, visiblement heureux du «bon tour».
Traduttore, traditore – traduction, trahison…
Traduttore, traditore. Et à plus forte raison lorsqu’il s’agit de passages de la Bible, d’oraisons, des évangiles et des épîtres. En un mot, de
l’ensemble de la liturgie, y compris la prière eucharistique. «On essaie de
garder le sens, même si on doit ’trafiquer’ un peu le texte. On peut être
plus ou moins fidèle avec un passage comme «Pour lui, avec lui et en lui»,
qui devient «Poi lu, aivõ lu et an lu». Mais allez traduire ’Amen’!». Un
Amen devenu pour le prêtre comme pour l’assistance un «Que s’feûche dinche!». Pas moins. Plutôt plus. Lorsqu’en sus il est chanté. Et repris par
le choeur et l’assistance.
Bien sûr, une messe en patois se prépare. Et plutôt deux fois qu’une.
«On écrit tout. Parce qu’il faut penser et repenser les textes dans
l’esprit du patois. On ne le traduit pas en français comme on le ferait entre le français et l’allemand. Les curés de Boncourt et de Delémont ont recours à un parent. A la maman ou à la tante pour les passages difficiles,
délicats. Gosses, tous deux entendaient leurs parents s’exprimer dans cette
langue. Presque uniquement dès lors que la conversation se déroulait entre
le père et la mère. Entre le père et les amis du conseil communal. Entre
collègues de la terre.
«Ma tante, qui a 94 ans, pense encore en patois», évoque l’abbé Prongué.
«Lorsqu’il a fallu traduire la messe, les premières fois, je lui lisais un
texte de l’évangile pour ensuite lui demander de me le conter en patois.
Elle me racontais alors ce qu’elle avait compris, de cet évangile, avant de
me le relire, mais alors en patois. C’était du vrai, de l’authentique». Une
démarche que ne renie pas le chanoine Oeuvray. «Combien de fois ma mère ne
m’a t-elle pas expliqué le sens d’une expression? Combien de fois ne m’a-telle pas conseillé dans la traduction?»
Pas triste, le sermon du curé
Des anecdotes où l’assemblée n’a pu contenir l’hilarité qui la gagnait
peu à peu, le chanoine Oeuvray en a plus d’une à conter. Comme celles des
«baibourates» ou de la «baîchatte» – la fille – d’un coin d’Ajoie qui s’en
revenait de Paris. Plus que l’histoire, les mots surprennent. Spontanés,
vivants, imagés, oh combien!
Un ange passe. Dégrisant. «Le patois est riche en proverbes. Je me souviens de l’un deux, glissé dans mon sermon, enchaîne le chanoine Oeuvray,
où il était question de Jésus qui reprochait à ses disciples de savoir lire
les signes du ciel, mais de ne pas connaître le temps de la visite de Dieu.
Or, le patois utilise le mot «babourate» pour désigner ces petites mouches
qui annoncent la pluie, parce qu’elles volent et qu’on les «prend» dans les
yeux les jours d’orage. Alors bien sûr, lorsque j’ai imagé mon propos en
racontant: «Ai y è des baibourates, en an r’çi piein les eûyes, laî pieûdje
ât bïntôt li».
Eclats de rires encore, au cours d’un sermon plus coloré encore que les
autres, racontant, en patois toujours, l’histoire d’une jeune fille qui, à
l’instar «de beaucoup de nos jeunes alors obligés d’aller travailler dans
les grandes villes au début du siècle parce qu’il n’y avait pas de boulot
dans le Jura, avait trouvé de l’embauche à Paris. Comme fille d’étage dans
un hôtel».
De retour à la ferme des parents, auréolée d’un accent parisien chèrement acquis mais loin d’être maîtrisé, elle est interpelée par son père en
ces termes: «E dâli ei fsai bon ai Pairis?». Suprême honte. C’était bien la
peine de monter dans la ville lumière pour s’entendre demander en patois
s’il faisait bon à Paris. Et la jeune fille de rétorquer, hautaine, jalouse
de sa culture nouvelle: «Parlez-moi donc en français, je ne comprend plus
cette langue». Or, poursuit le chanoine, arriva le temps des foins. Un râteau traînait dans les champs, notre «baîchatte» marche dessus et le reprend en pleine figure: ’Sacré crevure de rété, qu’elle breuyé!» (Saloperie
de rateau, qu’elle braille. – Elle avait retrouvé sa langue.
Et le chanoine «d’oser» la comparaison: «ç’ât cment tchi nôs tiaind nôs
djûnes vaint ai Lausanne ou bïn ai Genève, ai n’vint pu an lai mâsse. Cment
l’âtre aivait predju sai langue, ç’ât ïn pô cment s’ait l’aivïnt predju lai
foi. Main, tiaïn ai r’veniant an l’hôta, ai lai r’trôvant to contant!» En
d’autres termes: «C’est comme chez nous. Quand ils vont à Lausanne ou à Genève, nos jeunes ne vont plus à la messe. Comme l’autre avait perdu sa
langue, c’est un peu comme s’ils avaient perdu leur foi». Jusqu’à leur retour au bercail. Car dès qu’»ils reviennent au village, ils la retrouvent
tout de suite…»
Les fidèles n’assistent pas à la messe… ils la vivent
Pas étonnant que les églises soient combles. Les fidèles, jeunes et
moins jeunes causent volontiers entre eux. Commentent ce qui a été dit, expliquent une expression peu usitée à l’un ou l’autre voisin moins féru de
patois. «Parfois même, ils en rajoutent entre eux. Pour pouffer de rire de
plus belle. Tout juste s’ils n’interpellent pas le prêtre. Cela met de la
vie». Le curé Oeuvray en est certain, les gens communient plus. «ils sont
plus présents… Les fidèles n’assistent pas à la messe, ils la vivent.
Parce que c’est leur culture».
La liturgie, dit-il, «doit aussi être un moment où s’expriment les gens.
Où l’homme est en dialogue avec Dieu. Ce qui se vit avec le patois pourrait
servir d’exemple. C’est tellement nouveau d’entendre parler de sa foi dans
cette langue jamais entendue dans un cadre où elle n’était jamais entrée.
C’est pas que c’est plus sincère ou plus profond… Les gens sont passionnés, simplement, ou surpris des expressions utilisées pour dire la foi. Je
suis persuadé que tout ce qui est figé fait fausse route».
Le privilège du Jura
Des réticences sur la célébration d’une messe en patois? «Au début, certains prêtres, confie le curé Prongué. Ils auraient voulu que cela s’arrête
au sermon et à l’acueil. En un mot d’introduction. Aujourd’hui, tel n’est
plus le cas. Et aucun prêtre, à ma connaissance, n’a émis un avis
défavorable. Question organisation pastorale ou ouverture, il faut dire que
nous sommes privilégiés, dans le Jura».
Une inculturation bien avant l’heure en somme. «Tout-à-fait. Nos ancêtres ont parlé religion en patois, mais jamais cette langue n’avait été
présente dans la liturgie. On en a fait sans le savoir, en répondant à une
attente, à une demande de gens dont l’ambition consistait et consiste encore à sauvegarder le patois. La langue et donc la mémoire de nos ancêtres».
(apic/pierre rottet)
ENCADRE
Fribourg: des messes en patois, mais en partie seulement
Deux ou trois fois l’an, l’abbé Henri Murith, ancien curé de Saint-Nicolas,
à Fribourg, actuellement auxiliaire pour le secteur de Châtel-Saint-Denis,
célèbre lui aussi la messe en patois. Mais en partie seulement. Dans un patois d’origine franco-provençal.
«On a également traduit la prière eucharistique, dans le Jura?», s’étonne-t-il. «Moi, poursuit le prêtre fribourgeois, je fais l’introduction et
l’oraison en patois. Je lis également l’épître dans cette langue. L’Evangile, en revanche, je le proclame en français, parce que beaucoup de gens n’y
comprendraient pas grand-chose sinon».
Depuis l’offertoire et jusqu’à la communion, la messe de l’abbé Murith
se déroule ensuite en français. La dernière oraison ainsi que l’envoi étant
en patois. «C’est vrai que depuis Vatican II, il est maintenant possible de
présider une messe tout en patois».
Les messes en patois, dans le canton de Fribourg? Lors de la poya, la
montée à l’alpage, le deuxième dimanche de mai. «J’en célèbre ensuite une
le dimanche le plus proche de l’Assomption, à Vounetz, près de Charmey, à
l’attention des patoisants. Des gens d’autres cantons y participent, en
particulier des Valaisans et des Vaudois». A signaler la messe radiodiffusée de Semsales, en octobre prochain, qui sera célébrée en partie en patois par l’abbé Murith. (apic/pr)
ENCADRE
Le Valais prudent: Et la permission de Rome?
Du côté du Valais, on se déclare plutôt scandalisé par le fait qu’une messe
puisse être dite de A à Z en patois. «Il faut une autorisation particulière
de l’évêque. Et de Rome. Il faudrait de plus tout un missel en patois», affirme le Père Zacharie Balet, capucin à Sion et patoisant à ses heures.
«Moi, pour célébrer l’ordinaire de la messe en patois, – le Kyrie, le Gloria, le Sanctus et l’Agnus – j’ai obtenu la permission de Mgr Nestor Adam,
prédécesseur du cardinal Schwery sur le siège de Sion, à qui j’ai présenté
la traduction».
Même si c’est pour une fois l’an? «On n’a pas le droit de dire le canon
en patois», insiste, désapprobateur, le Père Zacharie. «On ne peut pas manipuler les textes de la messe. C’est sacré», relève-t-il encore. Interloqué.
Deux ou trois fois l’an, le capucin valaisan célèbre la messe en patois
pour les patoisants… L’ordinaire uniquement. Qui est chanté. «Le reste
est en français. Ou en allemand». (apic/pr)
Des photos peuvent être obtenues auprès de l’Agence CIRIC, à Lausanne.