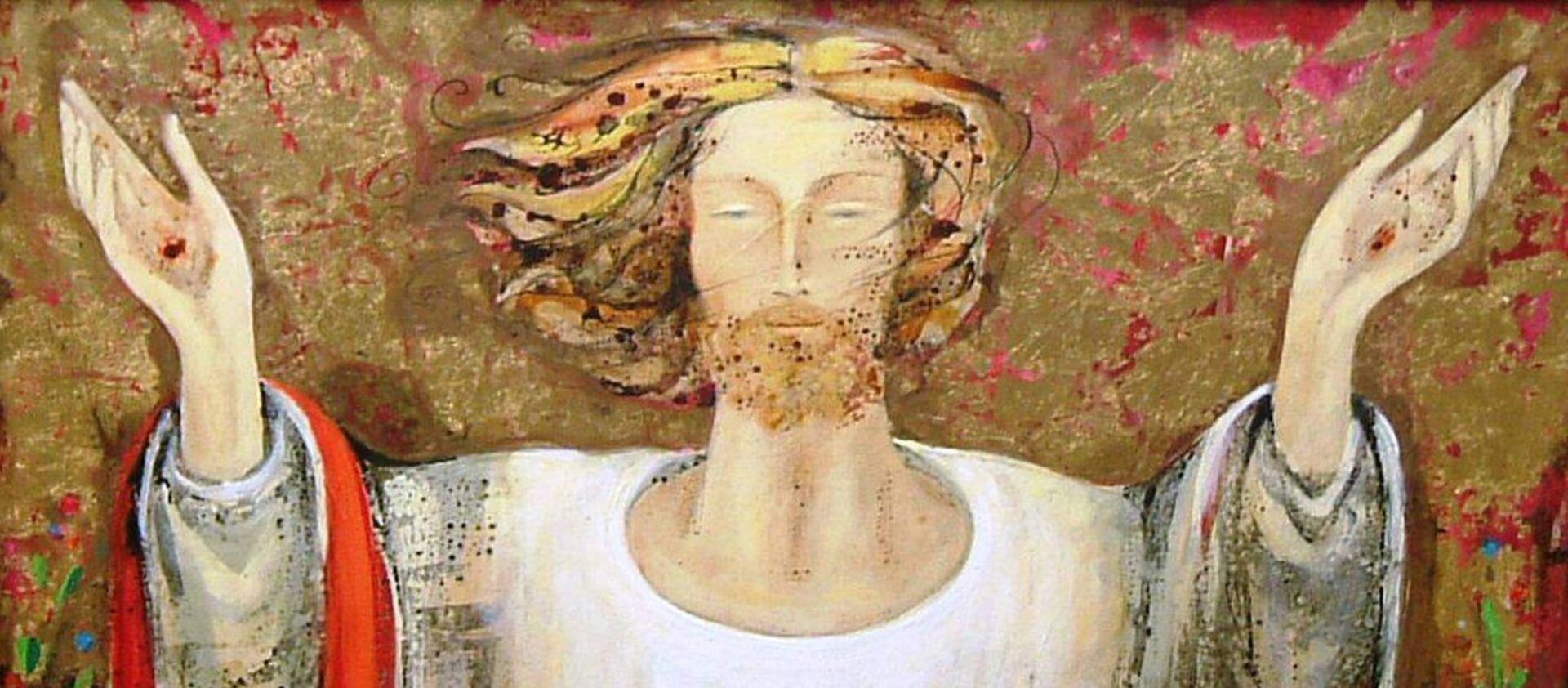«La crucifixion de Jésus est un indice très fort de son existence historique»
La Passion du Christ ne cesse de fasciner. Professeur de Nouveau Testament, Andreas Dettwiler a enquêté d’un point de vue historique sur la crucifixion de Jésus et sur la façon dont le christianisme a assimilé sa fin tragique.
Laurence Villoz / Adaptation: Carole Pirker
A quelques jours de Pâques, le bibliste et théologien protestant, qui donne, avant sa retraite, son dernier semestre de cours à la Faculté de théologie de l’Université de Genève, revient sur les résultats de la recherche qu’il a menée sur la crucifixion de Jésus au temps de l’Empire romain.
Brièvement décrite dans les Évangiles, cette pratique était utilisée pour exclure le condamné de la société et démontrer la puissance de Rome. À l’instar de La passion du Christ, de Mel Gibson (2004), les films sont légion à raconter la crucifixion de Jésus. Le spécialiste nous en explique les enjeux et l’impact.

Quelle est l’importance d’une telle mort?
Andreas Dettwiler: Elle est très grande, car elle est selon moi une preuve de l’existence historique de Jésus. Il est inconcevable que le christianisme ait inventé ultérieurement cette mort atroce, car celle-ci a tout de même posé un problème important pour le christianisme. En effet, une lecture antijuive et plus tard antisémite a attribué à tort la responsabilité juridique et politique de la crucifixion de Jésus aux autorités juives de Jérusalem et au peuple juif, ce qui a eu une répercussion catastrophique dans l’histoire du christianisme. Cette atrocité de la mort est selon moi un signe qu’il s’agissait d’un fait historique. C’est indice extrêmement fort que Jésus a effectivement existé.
La crucifixion est-elle une pratique courante dans l’Antiquité?
Oui, très courante durant toutes les périodes de l’Empire romain (de 340 av. J.-C. jusqu’à la chute de l’Empire romain, en 476 après J.-C., ndlr). Les sources qui nous le prouvent sont très variées et nombreuses. Les évangiles en attestent, bien sûr. Ceux de Matthieu et de Marc rapportent que Jésus a été crucifié, alors que celui de Jean décrit la mort de Jésus sur la croix. Mais une documentation historiographique, littéraire et les comédies populaires de l’époque nous l’indiquent aussi.
Moins connues, il y a également les inscriptions en latin ou en grec qui montrent tel ou tel aspect de la crucifixion. Enfin des sources archéologiques existent, comme l’ossuaire d’un jeune homme juif crucifié, découvert en 1968 à Jérusalem, avec l’os du talon percé par un clou. C’est à ma connaissance la seule preuve archéologique antique de la crucifixion.
Pourquoi utilise-t-on ce type de mise à mort?
Le but principal de la crucifixion est de se débarrasser du crucifié, mais aussi de l’exclure du monde de la civilisation et de lui retirer toute protection du droit romain. Le lieu d’exécution se trouve en dehors de la cité, c’est-à-dire symboliquement en dehors de l’espace civilisationnel où règne le droit. C’est aussi un lieu public fréquenté, souvent à la croisée des grandes routes, choisi pour traumatiser et démontrer la puissance écrasante de l’Empire romain. Celui qui est condamné à la crucifixion agonise durant des heures.
Dans l’imaginaire collectif de l’époque, c’est une mort infâme, indigne et honteuse, contrairement à la belle mort du guerrier. Lors de sa mort, un crucifié ne se trouve pas non plus en lien avec la terre et il n’entre pas dans le séjour des morts. On lui interdit d’être en paix, car son cadavre est laissé pendu à la croix jusqu’à ce qu’il soit dévoré par des animaux sauvages. Cette mutilation, symboliquement atroce, signifie qu’il ne s’agit pas simplement de détruire physiquement la personne, mais aussi son honneur, une valeur fondamentale dans la culture antique.
«Dans l’imaginaire collectif de l’époque, c’est une mort infâme, indigne et honteuse»
Quel était le statut juridique et social des personnes qui se faisaient crucifier?
Fondamentalement, la crucifixion est considérée comme un supplice pour les esclaves. Ils constituent une part importante de la société romaine et n’ont pratiquement aucun droit. Le pater familias, soit l’autorité sociale et juridique d’une maisonnée, a un droit de vie et de mort sur eux. Si un esclave commet une infraction, il lui est très facile de s’en débarrasser par crucifixion.
Hormis les esclaves, pour quel délit se font crucifier les citoyens romains?
C’est souvent pour haute trahison, ou si la paix romaine est en danger, mais cela peut aussi être pour du brigandage, un incendie criminel ou le vol d’un esclave. Il y a de nombreuses raisons qui permettent de se débarrasser ainsi de quelqu’un. Il ne faut pas oublier que notre idée d’une jurisprudence, qui traite tout le monde de manière égale devant le juge, est une vision très moderne. Elle n’existe pas dans l’Empire romain, qui pratique la logique juridique de classe: pour un même délit, le membre d’une classe supérieure sera puni différemment.
Les Évangiles sont très sobres par rapport au moment précis de la crucifixion de Jésus. Que savon-nous finalement de sa mort?
Il ne faut pas oublier que leurs auteurs ne sont pas intéressés à se perdre dans la description des détails, car tout le monde sait à cette époque comment se déroule une crucifixion. Ils se concentrent davantage sur son interprétation religieuse. Cela dit, du point de vue historique, c’est l’autorité romaine, Ponce Pilate en l’occurrence, dont l’historicité est attestée, qui porte la responsabilité politique et juridique de la condamnation à mort de Jésus. C’est lui et non les autorités juives de Jérusalem ou le peuple judéen ou juif.
Jésus a été crucifié au Golgotha, une ancienne carrière en dehors des murs de Jérusalem, et cela me paraît plausible, historiquement. Les récits parlent ensuite de flagellation, bien attestée dans la littérature, tout comme la durée de son agonie. Il a donc été condamné à mort par Ponce Pilate un vendredi matin et il est mort le soir du même jour, avant le shabbat. Cela dit, son cadavre n’a pas été laissé sur la croix. Il a eu le «privilège», si on peut dire, d’être enterré, comme en attestent les différents récits de la Passion. Mais là s’arrête l’enquête de l’historien, car la question de savoir si son tombeau est vide ou non, lui échappe…
«Jésus a été crucifié à Golgotha, une ancienne carrière en dehors des murs de Jérusalem, et cela me paraît plausible, historiquement»
Et sait-on exactement pourquoi Jésus a été condamné à mort?
Il l’a été, non pour des raisons religieuses mais politiques, en tant que roi des Juifs, donc prétendant messianique. Or, et c’est tout le problème, Jésus n’a pas de prétention politique. Par exemple, il n’interdit pas de payer les impôts pour les Romains et sa prédication renferme un pacifisme et une éthique de la non-violence. Mais il est perçu capable de remettre en question la souveraineté politique des Romains. L’avènement du royaume de Dieu, qu’il proclame en réunissant autour de lui les douze apôtres, est perçu comme une forme de contestation indirecte du pouvoir politique. C’est aussi le cas de sa critique à l’égard des marchands du Temple de Jérusalem, que Jésus chasse pour avoir transformé ce lieu de prière et d’adoration de Dieu en maison de commerce. À mon avis, cette critique à l’égard du Temple a joué un rôle important dans le drame des derniers jours de Jésus Nazareth.
Peut-on finalement dire que le christianisme est né d’un processus de deuil?
Oui, initialement, il est né d’un processus de deuil, mais on considère sa mort comme une étape intermédiaire, que l’on essaie de contrebalancer très vite par la résurrection. Selon moi, cette vision fait qu’on n’a pas très bien compris l’impact dramatique de sa mort sur les premières communautés chrétiennes. Celle-ci est en effet perçue comme une invalidation du projet religieux de Jésus de Nazareth: l’avènement du Royaume de Dieu, d’un royaume de justice, de liberté et d’amour.
Retrouvez l’interview de Andreas Dettwiller dans l’émission radio Babel,
précédemment diffusée en avril 2022,
en podcast ou via l’App Play RTS, sur smartphone.
D’un point de vue théologique, quel impact a la mort tragique de Jésus?
Le christianisme va repenser son imaginaire et sa représentation de Dieu. Dans la tradition juive, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, est un Dieu de la miséricorde et de la justice. C’est un Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage égyptien. Ces récits fondateurs marquent l’identité du judaïsme. Néanmoins, avec Jésus, ce Dieu d’Israël doit être repensé par le biais de cette figure du Christ, qui devient centrale. Le christianisme va ainsi repenser les représentations traditionnelles du divin et de la transcendance, car Dieu est désormais intrinsèquement lié au destin de Jésus.
Qu’est-ce qui vous a frappé dans cette recherche?
J’ai réalisé que parmi les dizaines de milliers de personnes crucifiées durant cette longue période de l’Antiquité, on connaît à peine vingt d’entre elles, dont l’histoire a préservé le nom et la mémoire. Jésus de Nazareth n’était pourtant pas victorieux ou très paradoxalement, seulement victorieux ultérieurement, mais on a préservé son souvenir. Ainsi, honorer les victimes du passé comme du présent signifie aussi ne pas les oublier. Si on les oublie, c’est comme si on les condamnait encore une fois. Cette culture de la mémoire me tient à cœur, car elle a une dimension éthique et morale importante. (cath.ch/lv/cp/bh)
Scandale ou salut, comment comprendre la mort de Jésus, sous la dir. de Frédéric Amsler et Simon Butticaz, Ed. Labor et Fides, 2023, 176 p
Un spécialiste du christianisme primitif
Andreas Dettwiler, né le 16 septembre 1960 à Soleure, est un bibliste et théologien protestant suisse, professeur de Nouveau Testament à l’Université de Genève. Son domaine de recherche comprend notamment les épîtres de Paul, l’Évangile selon Jean et le christianisme primitif dans l’Antiquité gréco-romaine. Il prendra sa retraite en juin et donnera sa leçon d’adieu le mardi 20 mai, à 18h15, dans la salle Phil 201 du bâtiment des Philosophes, boulevard des Philosophes 22 à Genève. CP