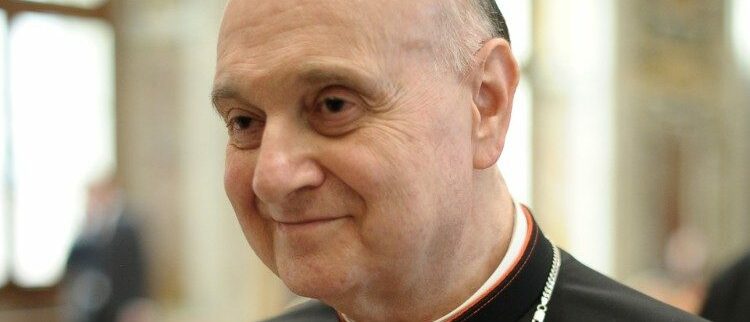Comment les autres chrétiens fêtent-ils Pâques?
En 2025, le hasard du calendrier fait que les grandes Églises chrétiennes fêteront Pâques à la même date, le 20 avril. L’occasion de jeter un coup d’œil sur les traditions pascales de communautés non-catholiques en Suisse romande.
La coïncidence des dates de Pâques a amené des personnalités engagées dans le dialogue œcuménique, notamment le pape François, à réitérer les appels à une date commune perpétuelle. Une avancée qui pourrait favoriser les célébrations interconfessionnelles. En attendant, cath.ch s’est renseigné auprès de représentants non-catholiques de Suisse romande sur la façon dont ils fêtent le sommet de la vie liturgique.
L’Église orthodoxe byzantine, des ténèbres à la lumière
Chez les orthodoxes, qui utilisent habituellement le calendrier julien, la Semaine sainte commence, comme pour les catholiques, avec le dimanche des Rameaux. Pendant cette période, «il y a des offices presque tous les jours dans les paroisses d’une certaine importance», explique Tikhon Troyanov, de la paroisse Sainte-Catherine de Chambésy.
Les offices orthodoxes sont habituellement plus longs que les catholiques, pouvant durer plus de trois heures. C’est notamment le cas de l’office des Douze Évangiles ou office des Saintes Passions. Cette célébration fait mémoire de la trahison, de la Passion, du procès, et de la crucifixion de Jésus-Christ, à travers la lecture de douze passages des Évangiles répartis tout au long de l’office. Il se déroule le soir du Jeudi saint.

Le Vendredi saint, les paroissiens participent à l’office de la Mise au tombeau. Ils commémorent l’ensevelissement du Christ, en anticipant déjà le mystère de la Résurrection. Lors de la cérémonie, une grande icône du Christ au tombeau est sortie, pour être offerte à la vénération des fidèles.
«Le Samedi saint représente l’un de mes souvenirs d’enfance les plus frappants», souligne Tikhon Troyanov. Ce jour-là, l’église et les habits du clergé passent des couleurs sombres (noir, violet…) au blanc. Afin de signifier le passage des ténèbres à la lumière.
La paroisse du responsable orthodoxe, fondée il y a cinquante ans, est francophone. Elle fait partie du complexe de Chambésy. Le lieu est occupé par quatre paroisses relevant du Patriarcat de Constantinople: outre la francophone, on y trouve une grecque, une roumaine, et une géorgienne.
Dans la banlieue genevoise, les quatre paroisses fêtent Pâques en partie en commun. Le Samedi saint au soir, l’office commence vers 23h. La proclamation se fait sur le parvis de l’église principale du Centre orthodoxe. «Il y a beaucoup de monde à ce moment-là sur le parvis, car cet office est très important pour les orthodoxes», commente Tikhon Troyanov. Le clergé des quatre églises et les fidèles se réunissent ensuite dans l’édifice, où des chants sont entonnés et des bougies allumées.
Les diverses communautés se rendent ensuite dans leurs locaux respectifs pour commencer un office d’environ trois heures. Vers 2h du matin, les fidèles sont invités à un buffet pascal. «Les traditions de Pâques sont assez semblables dans les diverses églises orthodoxes, relève Tikhon Troyanov. Elles se fondent sur le même canevas, mais dans des langues différentes.» La paroisse francophone célèbre tout en français, ce qui est relativement nouveau. Alors que les grecs, notamment, célèbrent en grec ancien.
L’office de la nuit pascale est le principal pour les orthodoxes, même si certaines paroisses proposent une célébration également le dimanche matin.
Église évangélique réformée, les prieurs de l’aube
«Les traditions entourant les fêtes de Pâques chez les réformés sont assez similaires à celles des catholiques, indique Virgile Rochat. Le pasteur de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) ayant officié à la paroisse Chailly-La Cathédrale à Lausanne est aujourd’hui à la retraite. «Même si la fête de la résurrection du Christ est bien sûr la plus importante de l’année aussi pour nous, nous considérons en fait tous les dimanches comme Pâques», remarque-t-il. Cette période prend toutefois un aspect bien plus festif.
Virgile Rochat souligne que les traditions réformées sont assez diverses selon les paroisses, et qu’elles ont évolué au cours du temps. Historiquement, la Semaine sainte a toujours eu une dimension particulière. Des recueillements sont proposés chaque jour dans le canton de Vaud, et le jour des Rameaux voit la confirmation de catéchumènes, ce qui donne à ce dimanche une dimension festive particulière.

Le soir du Jeudi saint, certaines paroisses célèbrent la Cène selon les codes de la Pâque juive. Les participants lisent des passages bibliques correspondants à ce que Jésus avait fait et partagent le vin et le Matzot, un pain non levé, consommé pendant par les juifs à l’occasion de Pessa’h. «Il s’agit de replacer la Cène dans son contexte originel», explique le pasteur. Le pain et le vin peuvent être gardés pour le Vendredi saint et le dimanche de Pâques.
Le jour commémorant la crucifixion est vécu de façon assez différente des catholiques. Il y a insistance sur la gravité et l’intériorité de ce jour, et la Cène est célébrée. Le jeûne n’est pas à l’ordre du jour, au contraire, la tradition prévoit à la suite du culte un grand repas familial, où la viande est de mise. «Historiquement, cela a pu être une forme de pied de nez aux catholiques» pour qui ce jour est dépourvu de célébration de l’Eucharistie précise Virgile Rochat, mais ce n’est plus le cas.
Pour le jour de Pâques, les protestants célèbrent dans la matinée un grand culte joyeux et festif. Mais depuis quelques décennies, à l’instar des catholiques qui le vivent lors de la veillée pascale lors de la soirée du samedi, une «vigile» se déroule à l’aube de Pâques. Les réformés affectionnent de se réunir pour accueillir l’aurore et le retour de la lumière, signe de la victoire de la vie sur la mort.
«Au fil du temps, nous nous sommes peu à peu rapprochés, en traditions, à la fois des juifs et des catholiques», explique le pasteur.
L’Église érythréenne Tewahedo, une influence de l’islam
L’Église orthodoxe érythréenne orthodoxe, dite ‘Tewahedo’, est une Église chrétienne orientale pré-chalcédonienne. Les membres de cette Église sont pour la plupart récemment arrivés en Suisse d’un pays où vit une importante population musulmane. Ils suivent de manière générale une religiosité fervente et intense, également influencée par les pratiques islamiques.

«La Semaine sainte, nous devons prier et jeûner toute la journée», explique ainsi à cath.ch Atakilti Estifanos, diacre de l’Église Tewahedo de Lausanne. Toute la semaine, les fidèles sont invités à ne rien manger ni boire depuis le matin jusqu’à 18h. Un jeûne absolu, rappelant le Ramadan, qui peut même durer jusqu’à 20h le Jeudi et le Vendredi saints.
Une démarche qu’ils pratiquent traditionnellement en commun, raison pour laquelle ils doivent réserver une salle ou une église durant toutes ces journées. La communauté emprunte encore les locaux de la paroisse réformée de Chailly-La Cathédrale. Mais ils pourront à l’avenir pratiquer ces activités dans leur propre église, encore en construction, qui devrait ouvrir en décembre 2025, à Lausanne.
De nombreuses personnes participent au culte du Jeudi saint, lors duquel le prêtre lave les pieds de tous les fidèles. «Vendredi saint est un jour particulièrement sombre», explique Atakilti Estifanos. Les fidèles qui le peuvent ne vont pas au travail ce jour-là, mais passe leur journée à l’église, à prier chacun de leur côté. Ce jour-là, «même les Érythréens non pratiquants respectent le jeûne total», assure le diacre.
Vers 18h, le vendredi soir, la communauté commence cependant à célébrer. «Le Samedi nous évitons toujours de manger, bien que cela dépende des personnes. Moi je mange le vendredi quand c’est autorisé, à l’église, et le samedi, je ne mange pas toute la journée», précise le jeune Érythréen. Il ne rompt le jeûne que le samedi à minuit.
Les fidèles Tewahedo passent toute la nuit du samedi au dimanche à l’église. Normalement, pendant les 40 jours précédant Pâques, ils ne mangent aucun produit venant d’un animal. Mais à partir de minuit le Samedi saint, ils se mettent à manger de tout ce qui était interdit. «Sauf du porc», précise le diacre, puisque c’est un animal qu’ils ne mangent jamais, à l’instar des musulmans.
«Toute la nuit est passée à chanter, nous allumons des bougies. Et à un certain moment, les prêtres et les diacres commencent à tourner autour des fidèles en priant, tout le monde applaudit.» Vers minuit, le prêtre autorise les participants à embrasser le crucifix. Ils sont ensuite conviés à un culte qui dure deux heures, se terminant vers 4h du matin. Les gens rentrent ensuite chez eux pour fêter en famille. Il arrive qu’à cette occasion, les enfants reçoivent des cadeaux. (cath.ch/rz)
Si les chrétiens célèbrent (d’habitude) Pâques à une date différente, c’est à cause de Jules César. Le calendrier qu’il a créé 45 ans avant la naissance du Christ calcule une année trop longue de onze minutes. Le décalage est devenu si grand qu’en 1582, le pape Grégoire XIIII a réformé le calendrier en supprimant dix jours. Alors que le nouveau décompte des jours a fait foi pour les Églises occidentales, les orthodoxes ont décidé de garder le julien. RZ