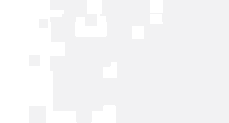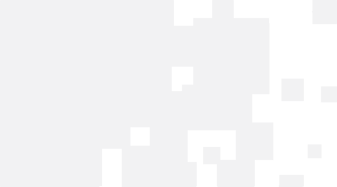L’envers du décor de la «valeur partagée»
Le principe de la responsabilité des grandes entreprises envers leurs fournisseurs, directs et indirects est largement acceptée surtout quand ces derniers sont petits et économiquement fragiles. Cette problématique avait été abordée par l’initiative dite des multinationales responsables qui a échoué de peu en votation populaire en 2020. Elle est aussi présente dans la directive européenne sur le devoir de vigilance adoptée par le Conseil de l’UE en mai dernier. Ce thème figure aussi dans les Principes directeurs élaborés par l’OCDE pour guider les multinationales vers une gestion plus responsable de leurs environnements économiques, sociaux et naturels. La version révisée de ces principes a été publiée au printemps 2023.
La chaine de valeur, appelée aussi chaîne d’approvisionnement, est une manière schématique de saisir les rapports entre les fournisseurs – directs et indirects – et l’entreprise, souvent de taille mondiale, qui assemble les divers éléments et composantes pour en faire un produit fini qu’elle achemine ensuite – seule ou avec d’autres – vers le consommateur final. C’est dans la chaine de valeur que se construit au fil des transactions la valeur ajoutée du produit final. Cette dernière correspond au prix payé par le consommateur final. C’est donc au sein de la chaîne de valeur que se définissent les prix et les conditions d’achat des composantes, c’est là que s’exprime le plus clairement le sens concret que les grandes entreprises donnent dans le quotidien des affaires au principe général de responsabilité envers les fournisseurs.
Au début des années 2010, la notion de « valeur partagée » a été mise en circulation pour mettre en évidence l’importance des « effets collatéraux » positifs que pourrait dégager pour les parties prenantes de l’entreprise une gestion responsable de la chaîne de valeur. La notion de valeur partagée a été élaborée par un des gourous du management, Michael Porter. Elle a été très rapidement reprise par Nestlé, qui depuis l’utilise comme marque de fabrique notamment pour intituler ses rapports sur la durabilité.
Nestlé: un commerçant éthique?
La livraison de juin du magazine Pubilc Eye consacre deux articles au cas des producteurs de café mexicains qui, il y a une quinzaine d’années, avaient opté pour un programme de mise à niveau de leur exploitation mis à disposition par Nestlé. Grâce à ce programme de reconversion vers la culture du café robusta (utilisé pour le Nescafé) en lieu et place de la traditionnelle me arabica, les exploitants devaient recevoir des plantes à plus haut rendement, donc augmenter, voire doubler, leurs revenus. Cette reconversion devait se faire sans soutien financier de Nestlé et sans aucune garantie ni sur les volumes ni sur les prix d’achat. Après quelques bonnes années, la conjoncture a tourné. En dépit de la bonne qualité des productions, les acheteurs – dont la majorité travaille pour Nestlé – font la grimace ce qui contraint les producteurs à brader leurs récoltes, de crier leur misère et de monter aux barricades tout en reprochant à Nestlé l’absence d’éthique. Selon les auteurs des articles, Nestlé se refuse à tout commentaire sur ce cas précis, tout en vantant dans ses rapports annuels les vertus de la « valeur partagée ».
Des promesses ou de simples conseils?
La situation décrite par Public Eye pose la question des limites de la responsabilité envers les fournisseurs. Nestlé aurait-il dû s’abstenir de prôner la reconversion des exploitations, sachant mieux que quiconque que les marchés sont instables par nature et que les risques pour les petits exploitants deviennent rapidement existentiels, donc vitaux ? L’entreprise aurait-elle péché par un excès d’optimisme dans sa communication auprès d’une population qui aurait pris ses conseils pour des promesses ? Aurait-elle dû donner des garanties de recettes à moyen ou long terme, sachant d’une part il faut beaucoup de temps pour que les nouvelles productions et nouvelles manières de faire s’enracine dans les terroirs, et sachant d’autre part que le café brut ne représente qu’une petite fraction de la valeur ajoutée (du prix final) payée par le consommateur. Le risque financier était sans doute envisageable, mais cela aurait pu être vu comme un précédent dangereux susceptible de s’étendre à l’ensemble des chaines d’approvisionnement de l’entreprise.
Conclusion : pour que la valeur soit véritablement partagée dans la durée, il faut que les risques le soient aussi. Cet engagement-là est visiblement inacceptable pour la logique de l’actionnaire qui règne à Vevey n’en déplaise aux chartes et principes.
Les droits de l’ensemble des contenus de ce site sont déposés à Cath-Info. Toute diffusion de texte, de son ou d’image sur quelque support que ce soit est payante. L’enregistrement dans d’autres bases de données est interdit.